Ecriture : certainement pas. Le petit jeu qui consiste à proposer trente-sept premières pages intégrales de romans divers à des lecteurs « lettrés » ( je pense surtout à mes profs stagiaires qui, pour une part importante, sont titulaires d'une licence ou d'une maîtrise de lettres ) est révélateur. Si l'écriture permettait de faire la distinction, la première page étant souvent révélatrice, il n'y aurait, ni tant de mauvaises réponses, ni tant de gens vexés à l'annonce des résultats.
Thèmes : y a-t-il dans la littérature jeunesse actuelle un seul thème adulte qui n'y soit pas aussi exploité ?
Vocabulaire : certains textes font effectivement preuve de complaisances ou de facilité sur ce terrain, mais la proportion n'est-elle pas identique chez les textes adultes ? Mais combien d'autres utilisent le vocabulaire précis employé par le monde des adultes ?
Cependant, on sent bien qu'il existe une différence.
A mon avis, il faut bien plus la rechercher dans la stratégie d'écriture et le point de vue que va adopter l'auteur pour conduire sa narration. Il me semble que, ayant la volonté de s'adresser à des lecteurs jeunes, l'auteur, dès le départ, sent plus ou moins confusément qu'il doit ( peut ) ou non éclairer son récit en utilisant tel ou tel levier.
Quel auteur jeunesse se risquerait à raconter une histoire en s'appuyant exclusivement sur la nostalgie ? Sans doute ne s'agit-il pas d'autocensure de la part de l'auteur jeunesse, mais d'une intuition qui l'amène à sélectionner des leviers que possèdent ses lecteurs — du moins en est-il persuadé au moment où il fait ses choix... intuitifs.
Pour moi, c'est d'abord dans ce point de vue que réside la différence entre un texte jeunesse et un texte qui s'adresse à des adultes.
Pour répondre à des contraintes, j'ai réécrit certains contes initialement rédigés pour des adultes à destination d'enfants. Le thème était le même et je n'ai pas l'impression d'avoir utilisé un vocabulaire ou une forme d'écriture différents. Par contre, le point de vue adopté l'était manifestement.
























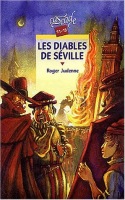
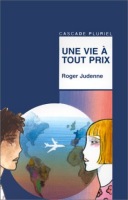
 Page précédente
Page précédente
