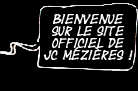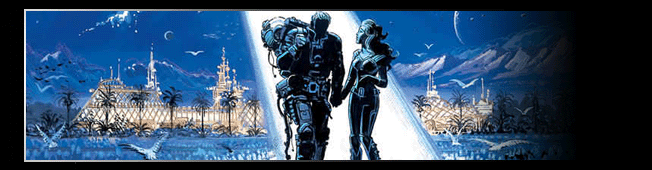

ARTICLE
|
Angoulême  Il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans le succès, jamais démenti, du Festival d'Angoulême depuis sa création. Car enfin, que vient-on y faire ? A un festival de cinéma, on découvre des films inédits. A un festival de théâtre ou de musique, on communie dans un spectacle, on vénère des interprètes. A un Salon du livre ou une exposition d'art contemporain, on sacrifie aux mondanités et on fait des affaires. Mais à Angoulême, l'immense majorité des bandes dessinées proposées à la vente, à la réflexion, à l'exposition, sont déjà connues, et parfois même très bien connues, de visiteurs qui sont généralement des lecteurs et souvent des fans. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans le succès, jamais démenti, du Festival d'Angoulême depuis sa création. Car enfin, que vient-on y faire ? A un festival de cinéma, on découvre des films inédits. A un festival de théâtre ou de musique, on communie dans un spectacle, on vénère des interprètes. A un Salon du livre ou une exposition d'art contemporain, on sacrifie aux mondanités et on fait des affaires. Mais à Angoulême, l'immense majorité des bandes dessinées proposées à la vente, à la réflexion, à l'exposition, sont déjà connues, et parfois même très bien connues, de visiteurs qui sont généralement des lecteurs et souvent des fans. Le mystère s'épaissit encore si l'on veut bien admettre que rien ne prédisposait Angoulême à accueillir des foules parfois turbulentes. Charmante cité, certes, mais qui sentait davantage son Chardonne, Charentais « romancier du couple », que le Marsupilami de Franquin ou le Tarzan de Hogarth, pour s'en tenir à deux grands mythes forestiers et deux grands noms du premier Salon, en 1974.
« La ville n'en voulait pas, de ce Salon », rappelle aujourd'hui Pierre Pascal, qui fut l'un des pionniers de l'aventure avant de devenir plus tard directeur de la manifestation. Hôtellerie déficiente, accueil que l'on peut qualifier de réservé, restaurants fermés : ceux qui ont essuyé les plâtres des premières éditions gardent des souvenirs mitigés de ces débuts provinciaux.
Il faut y ajouter le moment de l'année, considéré comme peu propice aux débats festivaliers. Pluies diluviennes et vent à décorner les bœufs n'épargnent pas les visiteurs. En 1977, s'effondre la bulle gonflable, qui fait déjà le charme assez particulier des rencontres, les auteurs errent comme des âmes en peine, et certains éditeurs pensent que le Salon est fichu. Mais non : Hergé en personne est là, sa présence sauve la mise.
Il y aura d'autres avis de coups de vent, d'autres tempêtes moins visibles mais plus menaçantes. Des soubresauts politiques, d'abord. Lorsque Jean-Michel Boucheron (PS) arrive à la mairie en 1977, il est plutôt anti-Salon. Jean Mardman, un autre fondateur, précise : « Il prétendait que c'était inutile, luxueux ». M. Boucheron prendra vite la mesure des avantages que le Salon pouvait apporter à sa ville. Mais, une bonne dizaine d'années plus tard et un scandale financier consommé entre-temps, c'est son successeur Georges Chavanes (UDC) qui souffle le froid à un moment où, de surcroît, le chiffre d'affaires global de la bande dessinée est en baisse.
Bouderies Le cap sera passé avec, notamment, l'arrivée d'un nouveau partenaire, Michel-Edouard Leclerc, qui vient en connaisseur — sa bibliothèque comprend plusieurs milliers d'albums — et qui veut faire de la ville « la Mecque de la BD ». Il y a aussi les bouderies d'éditeurs. Certaines ne tirent pas à conséquence, même si les « odeurs de merguez » ne suscitent guère l'enthousiasme de certaines maisons réputées. D'autres sont plus embarrassantes, comme lorsque les Belges de chez Dupuis dénoncent en 1987 les « franchouillards » qui se distribueraient les « grelots » entre eux, lorsque d'autres responsables éditoriaux refusent de jouer le jeu ou se retirent.
Si l'on ajoute à cela les rumeurs récurrentes de déménagement dans d'autres villes supposées plus propices à l'exercice (Toulouse ? Bordeaux ?) et les dissensions dans l'équipe de direction, la menace s'alourdit. Elle se concrétisera avec le lancement de la manifestation à la fois dissidente et concurrente de Grenoble en 1989. Après un démarrage d'une puissance impressionnante, la fusée grenobloise implosera en plein vol, bien avant d'avoir atteint sa vitesse de croisière. Et Angoulême restera « la ville qui vit en ses images », même si d'autres festivals iront se multipliant, certains avec un beau succès, comme Blois ou Saint-Malo.
Mais comment expliquer la longévité d'Angoulême ? La création du Salon a correspondu à ce que le sociologue Luc Boltanski, dans le premier numéro de la revue Actes de la recherche en sciences sociales de Pierre Bourdieu, en janvier 1975, pouvait intituler « Processus de canonisation : comment la bande dessinée devient un art ». Pour sa part, Pierre Pascal déclare simplement : « C'est tombé pile, au bon moment » Mais il rappelle à juste titre qu'il y a eu, dès les années 60, un « avant-Angoulême », avec des noms que l'on retrouvera souvent par la suite à divers titres, comme ceux de Claude Moliterni, Jean-Claude Forest, Jean-Pierre Dionnet ou Philippe Druillet ; avec l'appui d'amateurs éclairés comme Alain Resnais ; avec des revues et des sociétés savantes réunissant des esprits curieux.
Les événements de 1968, et le mouvement post-soixante-huitard plus encore, ne sont pas non plus étrangers à l'émergence de nouvelles formes culturelles. On oublie aujourd'hui la chape de plomb qui régnait alors sur l'ensemble des médias, à l'exception de quelques titres virulents comme HaraKiri, fantaisistes comme Pilote, ou ouverts sur l'imaginaire comme la revue Fiction.
C'est René Pétillon (grand prix 1989) qui peut dire : « Je n'ai pas oublié les années Pompidou ! La bande dessinée permettait tout parce qu'il fallait que ça sorte : on avait besoin d'une soupape. »
Coups salutaires Dans le sillage de René Goscinny, une « école française » apparaît précisément à ce moment-là. Elle est formée par une génération de dessinateurs et de scénaristes qui « détournent sur la bande dessinée des ambitions censurées qu'une origine sociale plus élevée les inciterait à investir dans le champ de la peinture ou de la littérature », dit encore Luc Boltanski. L'humour, la dérision, la colère, la fantaisie, le saugrenu, l'aventure, l'utopie, la sexualité, autant de choses qui s'inscrivent dans la mouvance antiautoritaire de l'époque, éclatent dans les journaux ou les albums et, bien entendu, se retrouvent à Angoulême. Une vulgarité assumée y acquiert droit de cité, c'est le cas de le dire. Contournant sans effort le populisme, la bande dessinée s'insurge contre l'élitisme, le snobisme, la vacuité formaliste de la culture noble. Les tenants de la « ligne crade », de Jean-Marc Reiser à Philippe Vuillemin (tous deux couronnés par un Grand Prix, à près de vingt ans d'écart), seront d'ailleurs toujours partie intégrante de l'esprit BD.
L'ironie corrosive de Claire Brétecher (plutôt à gauche), de Gérard Lauzier (plutôt à droite), de Marcel Gotlib (au-dessus de tout le monde) portent des coups salutaires à la bonne conscience.
Mais ce joyeux remue-ménage ne se coupe pas pour autant d'une réflexion que l'on pourrait parfois qualifier d'académique. Il y a toujours eu à Angoulême des débats abscons auxquels un public parfois ébahi n'a pourtant pas rechigné à assister. Quel autre festival aurait osé, pour son ouverture, proposer une conférence (en anglais) de Hogarth sur le thème « Symbol and metaphor in the comic strip from a classical point of view ? »... Presque tous les grands thèmes du moment — du féminisme à l'humanitaire en passant par l'écologie — auront été abordés, et dûment illustrés.
Quant à la lutte contre la censure, elle constituera l'un des axes les plus véhéments du festival, culminant sous le giscardisme avec Angoulême, sixième du nom. Il est vrai que la bande dessinée, soumise qu'elle était aux lois de 1949 destinées à protéger la jeunesse, a souffert de l'hypocrisie ambiante davantage que d'autres arts mieux en cour.
Ancrage lié à l'origine sociale de beaucoup des auteurs. Côté autodidacte des organisateurs. Goût d'un savoir un peu sauvage, un peu marginal. Et surtout esprit d'enfance, désir de rester attaché à des lectures d'enfance alors qu'on est devenu adulte. Autant de facteurs qui vont entraîner une autre petite révolution copernicienne. Le milieu enseignant, majoritairement hostile à la BD jusque dans les années 70, découvre un moyen d'expression qui constitue l'ultime rempart de la lecture, et fait souvent d'Angoulême un lieu de pèlerinage juvénile.
L'université elle-même s'y colle, sémiologie de l'image ou sociologie des banlieues aidant. La bande dessinée a décidément fait son entrée dans le paysage socio-culturel (comme on dit à l'époque) français. Et Angoulême avec elle.
Le Salon mène sa vie. 10 000 visiteurs en 1974, déjà, une surprise. En 1995, on en recense 148 500. Même les entrées payantes ne ralentissent pas le flot des envahisseurs d'une ville littéralement, quoique pacifiquement, assiégée en dépit de ses remparts. Les journalistes se comptent par centaines. Les antiquaires arrivent en 1979 avec leurs raretés pour collectionneurs. Quant aux fanzineux, sympathique horde pratiquant la scissiparité, la métempsycose, la Gestetner puis la PAO, et surtout la provocation, ils sont toujours là.
Milieu d'artisans Sous la houlette de Francis Groux, de David Caméo et de beaucoup d'autres, il y a de grandes réussites. Par exemple avec les expositions scéniques initiées par François Vie. L'astronef de Valérian avec ses passagers-visiteurs fera date, le bunker-musée d'Enki Bilal ou le paquebot de Goscinny aussi, le labyrinthe physique et conceptuel inspiré des Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters constituant pour certains un sommet dans l'incarnation d'une œuvre graphique.
Il y a aussi d'entêtants ratages, comme ceux de la remise des prix, d'abord des pingouins Alfred assez disgracieux, ensuite des Alph'art inspirés de l'œuvre inachevée d'Hergé. A peu près tous les lieux de la ville sont mis à contribution, les cérémonies oscillent entre le para-télévisuel et la pitrerie de patronage, personne n'est content, même pas ceux qui ont les prix. Mais ces cafouillages sont-ils pires que les sinistres remises d'Oscars et autres Césars ? Que les aimables fourberies des prix littéraires français ? Un nouvel équilibre semble de toute façon avoir été trouvé, qui renoue utilement avec la simplicité amicale des débuts.
Cela dit, le palmarès d'Angoulême prête assez peu à contestation, à la différence de beaucoup d'autres. Enjeux financiers somme toute modérés ; prestige bien relatif aussi, car ce n'est pas sur les honneurs que fonctionne la notoriété en bande dessinée ; homogénéité d'un milieu d'artisans où le respect du travail bien fait n'est pas un vain mot... Les explications ne s'excluent pas mais, à l'arrivée, quelles qu'aient été les formes successives des jurys, qui songerait à nier le talent d'un Will Eisner, d'un Hugo Pratt, de merveilleux dessinateurs comme Tardi, Giraud, Cabanes ou Juillard ?
On peut assurément regretter des oublis, le plus souvent aux dépens des créateurs de séries populaires ou enfantines. On peut renâcler sur des choix trop (ou pas assez) médiatiques. Mais les nombreux — trop nombreux ? — autres prix sont aussi là pour compenser les inévitables arbitraires.
Le Salon a d'autres fonctions auxquelles on ne pense pas spontanément. Par exemple, une fonction politique. Depuis Jack Lang, fidèle parmi les fidèles, les ministres s'y sont pieusement succédé. Les plus convaincus (Jack Lang encore, puis Philippe Douste-Blazy) ont proposé des mesures en faveur de la BD. Fortunes diverses après ces effets d'annonce, comme toujours, mais aussi résultats spectaculaires avec la création du CNBDI (Centre national de la bande dessinée et de l'image).
En 1985, c'est l'apothéose avec la visite de François Mitterrand, même s'il confond dans un enthousiasme bien compréhensible Chéri-Bibi et Bibi Fricotin, ce qui de toute façon ne change pas grand-chose à l'affaire. Cette année, Catherine Trautmann devrait être aussi à Angoulême.
Le festival remplit d'autres rôles encore, dont celui de rite de passage. Eric Corbeyran, jeune scénariste à l'œuvre déjà importante, raconte : « Janvier 83 : je suis dessinateur et je viens au Salon avec le coeur qui bat plus fort à chaque fois que je croise une personnalité. Janvier 84 : je me paye un stage, mes planches laissent les animateurs complètement froids. 85 : j'abandonne le dessin. 86 : j'ai décidé de devenir scénariste, je dors dans ma 2 CV et me pèle les nougats sous mon cuir. Le froid me réveille vers 4 heures du matin, les bulles sont encore fermées. 87 : Le Lombard s'intéresse à mon premier scénario. 89 : pour la première fois, je passe derrière un stand, celui de Dargaud. Janvier 90 : je suis un PRO ! Première dédicace chez Vents d'Ouest. Expo, cocktail, badge « auteur ». On me rembourse même le déplacement. » Beaucoup d'auteurs confirmés ne pourraient-ils pas raconter une histoire voisine ?
Reconnaissance Egalement importante, l'aura internationale du lieu, et ce depuis le tout début. Pour beaucoup de pays où le statut de la bande dessinée était pour le moins incertain, y compris aux Etats-Unis d'où sont venus chercher une reconnaissance méritée un Crumb ou un Art Spiegelman, il y a eu là comme une balise. Andréas Knigge, directeur littéraire de la maison d'édition allemande Carlsen Verlag, résume le sentiment général : « Arriver à Angoulême, c'était sortir du désert et découvrir le paradis. En Allemagne, la bande dessinée était considérée comme minable. Et là, tout d'un coup, ça faisait partie de la culture. Au Café de la Paix et ailleurs, il y avait des gens qui s'intéressaient à cette forme d'art, des gens qui, chose incroyable, en discutaient jusque tard dans la nuit ! »
Souvenirs... Pour beaucoup, c'est aussi cela, le Salon d'Angoulême. Il faudrait évoquer le train spécial amenant chaque année de Paris une cohorte de dessinateurs, journalistes, amateurs, avec un Jean-Michel Charlier (scénariste de
Tanguy et Laverdure), ancien pilote faisant s'écrouler de rire un wagon, avec de sombres histoires de pigeons-voyageurs.
Il faudrait suivre aussi à la trace les dessinateurs multi-cartes soucieux de rester en bons termes avec leurs différents éditeurs et prenant le petit déjeuner en compagnie des gens de Casterman, le déjeuner à la table de Glénat, le diner chez Dargaud, pour finir avec un verre aux frais des Humanos ou d'Albin Michel. On pourrait reprendre la complainte de la sous-représentation féminine de la profession, qui n'a longtemps compté que la douce Annie Goetzinger et la piquante Chantal Montellier dans ses rangs, même si l'on peut constater une féminisation réconfortante, aussi bien du côté de la production (avec la reconnaissance de Florence Cestac) que de la fréquentation (où les jeunes filles se font moins rares).
Il faudrait parler de l'hôtel de France, toujours le plus convoité d'Angoulême, bien qu'il soit devenu Mercure. Certains soirs, la congrégation de grands prix y est telle qu'une bombe judicieusement placée par un ennemi des petits Mickeys pulvériserait le Gotha de la bande dessinée, directeurs littéraires compris. Ce qui est grave car, en principe, on ne s'attaque pas aux officiers d'état-major ! C'est là d'ailleurs qu'on lit l'une des spécificités du Salon dont il est le plus fier : l'engagement direct des éditeurs (et non des libraires).
Pour d'autres, Angoulême, ce serait plutôt le foot, avec le Mickson BD Football Club d'Etienne Robial portant les couleurs de la profession face à des équipes de journalistes. Et pour d'autres encore — qui peuvent parfois être les mêmes — ce serait la musique, comme pour Jean-Claude Denis, aussi bon musicien que dessinateur, animant vigoureusement les nuits festivalières en compagnie de Franck Margerin et de son groupe, Les Hommes du Président.
Marathoniens de la dédicace Mais il faut finir par répondre à la question initiale. Que vient-on donc faire à Angoulême ? Eh bien, pour beaucoup de gens jeunes et moins jeunes, on y vient pour les dédicaces. Qui n'a pas vu les gigantesques queues devant les stands lorsqu'une vedette est en signature n'a rien vu de la consommation culturelle contemporaine.
Il est vrai que la dédicace d'un artiste graphique, comparée aux pauvres phrases des littérateurs, c'est du Michel-Ange à côté de graffitis dans les toilettes. Mais il est exact qu'on peut aussi s'interroger sur cette étrange passion qui transforme les dessinateurs en marathoniens, pour ne pas dire en stakhanovistes, de la valeur ajoutée à un album ; qu'on peut y lire le même désarroi, peut-être, que dans la recherche d'autographes de célébrités en tout genre.
Il n'empêche qu'il y a dans ces foules réellement passionnées de telle ou telle série, de tel ou tel artiste, un rapport étroit entre l'auteur et le lecteur, l'amateur et le professionnel, qui n'est pas si fréquent par les temps qui courent. C'est aussi cet état d'esprit qui contribue à faire d'Angoulême une manifestation qu'on pourrait qualifier à bien des égards de démocratique, ce qui n'est pas rien.
|