 |
Pierre Lacroix au temps de sa jeunesse folle (Boréal 1982 ; photo Nobert Spehner)
|
Pierre Lacroix a été pendant longtemps un infatigable éditeur de fanzines au Québec (Carfax et Temps Tôt pour n’en citer que deux). Le fandom québécois lui doit beaucoup. Mais il a fini par se fatiguer — malheureusement pour l’écologie du milieu SF&F, où que ce soit, les éditeurs de fanzines finissent toujours par se décourager, ou par se rappeler qu’ils ont une vie, en fin de compte. Pierre Lacroix vit désormais la sienne en France, dans une ferme, et il en semble tout à fait heureux. Tant mieux pour lui !
PL : Elisabeth Vonarburg, qui êtes-vous en tant que personne de tous les jours ?
EV : Une personne de tous les jours. Qu’est-ce qu’on mange, faut payer Bell [le téléphone] et Hydro [l’électricité] aujourd’hui, bon sang, le chat est encore dans les plantes, qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir... Et aussi : c’est quoi le programme aujourd’hui, écriture, courrier, essais, articles, répondre à des entrevues par lettre ?...
PL : Quel est votre nom de jeune fille ? Vonarburg est votre nom de femme mariée...
EV : Ferron-Wehrlin. Tout ça, c’est le nom de mon père. Ferron-Wehrlin-Morché si tu veux celui de ma mère en plus. Vonarburg était mon nom de femme mariée, en effet, c’est aussi mon nom de plume, celui sous lequel je connais la gloâre. Mon ex m’en a fait cadeau quand nous nous sommes séparés officiellement, en janvier 91. Comme je dis toujours : on ne choisit pas ses parents, mais on choisit son mari. Je préfère un nom que j’ai choisi.
PL : Vous qui êtes une fan de la première heure, qu’est-ce qui vous a amenée à écrire de la SF ?
EV : Fan de la première heure ? Quelle première heure ? Au Québec ? Je ne suis entrée en contact avec Norbert Spehner, Solaris (alors Requiem) et la SFQ naissante qu’en 74-75, après Daniel Sernine, par exemple. En France ? Je n’ai jamais été une “fan” dans le sens où je comprends ce terme, i.e. jamais appartenu à un regroupement autour d’un fanzine. J’achetais Fiction et Galaxie en kiosque... Et je lisais tout ce que je pouvais trouver, ce qui pour moi décrit l’amatrice passionnée, pas la “fan”, que je vois comme souvent plus limitée dans ses lectures (rien que Asimov, rien que le Fleuve Noir...), et souvent aussi plus intéressée aux activités para-lecture de la SF — comme écrire à un fanzine. J’avoue cependant que j’ai écrit une fois à Fiction (z’ont publié ma lettre ! J’me sentais pu ! ) Et une fois à Gérard Klein personnellement (m’a répondu par retour de courrier ! J’me sentais pu ! ) Mais j’ignorais totalement l’existence des autres fanzines français de l’époque, je ne suis jamais allée à aucune convention — j’ai même raté la mondiale en Allemagne, au début des années 70...
Je ne me suis jamais considérée vraiment comme une “fan”, je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis venue tard à la SF ? (j’avais 16-17 ans, j’entrais à l’Université). Parce que j’en ai tout de suite lu un vaste éventail qualitatif, sans être limitée, par exemple, au Fleuve Noir de l’époque ? Parce que j’ai toujours lu beaucoup d’autres choses ? Parce que je suis secrètement snob ? Coudon, choisissez.
Maintenant, ce qui m’a amenée à écrire de la SF. J’ai des tas d’explications, rétrospectivement, toutes valides (pardi, j’ai passé toute ma thèse de doctorat à me la poser, cette question !). Mais la première est sans doute que de toute façon j’écrivais — carnets intimes, lettres, poésie... Et les premiers balbutiements de la fiction, vers 15-16 ans. C’est aussi à cette époque que j’ai découvert la SF, pas seulement comme littérature mais comme “vision du monde”. Ce qui m’a amenée à en écrire, je suppose, est d’abord d’en avoir beaucoup lu ! Mes écrits ont alors pris “tout naturellement” une tournure SF. Et puis, le roman autobiographique que j’avais commencé avait mal tourné (j’en attendais confusément une revanche sur la réalité, et voilà-t-il pas qu’il m’échappait et devenait pire que la réalité ! Un comble !) ; et la première nouvelle entière que j’aie écrite était du fantastique (para-lovecraftien ! ) qui m’a beaucoup inquiétée quant à ma santé mentale... Je n’ai pas eu ce genre de problèmes avec la SF. La SF était, comme je l’ai souvent dit plus tard, et c’est toujours vrai, “à la bonne distance”, entre mes propres bébelles (les effrayantes, et les autres) et... le réel, ou le questionnement du réel. Et puis, j’ai toujours aimé les histoires. Dans la SF (et les autres genres connexes d’ailleurs, où je commence à aller voir), on peut encore raconter des histoires. Et puis j’aime toujours secrètement la poésie. Dans la SF, on peut sournoisement faire de la poésie sans que le lecteur s’en rende vraiment compte...
PL : Est-ce important pour vous d’écrire ?
EV : Quelle question idiote, pensa-t-elle d’abord. Mais finalement, pas vraiment. Au premier abord, j’ai envie de dire : “BIEN SÛR, puisque je le fais !”. Mais le second rabord me fait réfléchir. “Important”. Que veut-on dire par là ? Est-ce important pour moi, ou est-ce important en général — signifiant, “valable”, pertinent, comme but-dans-la-vie ? Pour moi, oui, donc, c’est important : c’est une vieille habitude, de me dire ma vie pour la vivre plus complètement, et de me la dire en la rêvant, à travers des histoires. Et puis c’est devenu important, parce que c’est la direction qu’a prise mon existence, ma “carrière” première, l’enseignement, ne m’ayant jamais totalement satisfaite, même si je l’aime assez (j’aime partager ce que j'ai appris) — et les occasions de l’exercer de façon viable s’étant taries, aussi ! Il ne me reste que l’écriture, pourrais-je dire, alors tu parles que c’est important ! Ça me fait vivre en partie, matériellement cette fois, à travers des bourses d’écriture, des petits droits d’auteur, des petits cachets ici et là pour des lectures, des conférences, des piges...
Mais est-ce important d’écrire, d’être écrivaine ? Là, je ne sais pas trop. Si j’étais un homme, statistiquement, je répondrais que oui, que l’Écrivain Peut Changer le Monde en Écrivant LE Livre. Mais les femmes ont, statistiquement, des attentes plus modestes dans le domaine de la gloire, de la fortune, et de leur impact sur le monde en général. Je suis une femme pas mal statistique de ce point de vue. La célébrité, coudon, soyons réaliste. Écrire de la SF en français au Québec, ce n’est pas un moyen sûr d’atteindre la célébrité, si même je voulais être célèbre, ce que je ne crois pas vraiment (mais c’est une autre question...). La célébrité... Pendant qu’on est vivant, eh bien, avant de dépendre (quand même ! ) des lecteurs, ça dépend des tirages de vos livres, de la promotion faite par l’éditeur, de la bonne volonté des distributeurs, des libraires et des critiques littéraires. Alors... Quand on est mort ? Je ne crois guère à la postérité de toute façon. Je me dis que mon nom va rester, dans une ou deux encyclopédies, et dans quelques recensions poussiéreuses. Et les livres sont des choses bien périssables.
Est-ce important, alors, d’écrire ? Ma foi oui. Comme c’est important d’essayer d’être au monde de la façon la plus consciente possible. Comme c’est important de savoir qui on est, ce qu’on peut faire — et de l’être, et de le faire du mieux qu’on peut. Comme c’est important de toucher les autres, de les comprendre et de les aimer le plus possible. C’est important d’écrire, alors. Mais ni plus ni moins que tout ça : pour moi, écrire, c’est une de mes façons de faire tout ça Je me suis souvent la posé la question, il y a quelques années, de savoir ce que je ferais si pour écrire un livre génial il me fallait rater ma vie humainement, comme personne. La réponse a toujours été “je préfère ne pas trop rater ma vie de personne, ici et maintenant, et fuck la gloire de mes os.” Ce n’est sans doute pas une réponse bien romantique. Mais c’est la mienne.
PL : En choisissant la SF, n’avez-vous pas l’impression de n’écrire que pour une élite ?
EV : Huh ? Ah oui, tu veux dire Slans ’R’ Us , “les amateurs de SF sont la crème de l’humanité, le sel de la terre” ? Bé non, désolée, de ce point de vue, je n’ai pas l’impression d’écrire pour une élite. Mais l’impression d’écrire pour un petit nombre de gens qui ont (hypothétiquement, idéalement...) en commun certaines visions du monde auxquelles je souscris plus ou moins ? Oui. Un groupe n’est pas “une élite” simplement parce qu'il est limité et que nous nous trouvons y appartenir, n’est-ce pas ?
PL : Qu’est-ce qui occupe votre pensée quand vous commencez à écrire une histoire ? Ce qui vous intéresse, ce qui intéresse les autres, ou principalement le marché visé ?
EV : Ce qui m’intéresse, c’est de l’écrire, la maudite histoire ! De la faire exister, de la concrétiser, matérialiser, sortir du virtuel et de ma tête ! J’y ai en général pensé/rêvé pendant des mois, parfois des années, et j’en ai exploré tous les aspects qui m’intéressent. Quant à ce qui y intéresserait “les autres”... d’abord, il y a plusieurs sortes d’”autres”. J’ai par exemple une brochette de lecteurs-tests à qui je fais la plupart du temps lire mes histoires. Je les ai choisis, au cours des années, parce que je sais ce qui les intéresse, et donc le type de lecture, et le type de commentaires utiles que je peux espérer d’eux. Mais je ne pense pas à eux quand j’écris l’histoire. Je me la raconte à moi d’abord. C’est quand elle sera finie que je commencerai à m’interroger sur les réactions des “autres” — mes lecteurs-tests en premier.
Et puis, chronologiquement, il y a les autres “autres” : le “marché”. Qui est pour moi d’abord les directeurs littéraires. Ce sont d’abord des personnes, des individus : des lecteurs, et donc je les envisage d’abord comme tels, pas comme “le marché”... Je n’entretiens d’ailleurs avec aucun d’eux de relation assez personnelle pour avoir une idée précise de ce qui les “intéresse”. Quand bien même je l’aurais, j’y penserais après avoir écrit l’histoire (“ça, ce serait plutôt pour machin que 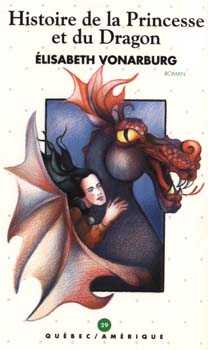 pour truc..”). Quant au “marché visé”... Dans la grande majorité des cas, jusqu’à présent, je n’ai jamais “visé” aucun marché. Je n’ai par exemple écrit que très peu de textes sur commande (sur motif imposé, pour une revue précise : par exemple “Cogito” pour Imagine, “Pupa” pour le numéro spécial sur les poupées, dans XYZ, ou “Celles qui vivent au-dessus des nuages” pour le spécial de Moebius sur le thème de Danaë). Histoire de la Princesse et du Dragon, publié en collection pour jeunes, n’avait pas été écrite avec ce public en vue, et les contes pour jeunes que je dois écrire cette année, je vais les écrire d’abord pour moi — pour l’enfant qui est en moi. La directrice littéraire de la collection à qui je les proposerai décidera ensuite s’ils lui conviennent. S’il y a des modifications à faire qui me conviennent, je les ferai. Sinon, j’essaierai un autre “marché”, voilà tout, et la négociation des modifications à faire recommencera... pour truc..”). Quant au “marché visé”... Dans la grande majorité des cas, jusqu’à présent, je n’ai jamais “visé” aucun marché. Je n’ai par exemple écrit que très peu de textes sur commande (sur motif imposé, pour une revue précise : par exemple “Cogito” pour Imagine, “Pupa” pour le numéro spécial sur les poupées, dans XYZ, ou “Celles qui vivent au-dessus des nuages” pour le spécial de Moebius sur le thème de Danaë). Histoire de la Princesse et du Dragon, publié en collection pour jeunes, n’avait pas été écrite avec ce public en vue, et les contes pour jeunes que je dois écrire cette année, je vais les écrire d’abord pour moi — pour l’enfant qui est en moi. La directrice littéraire de la collection à qui je les proposerai décidera ensuite s’ils lui conviennent. S’il y a des modifications à faire qui me conviennent, je les ferai. Sinon, j’essaierai un autre “marché”, voilà tout, et la négociation des modifications à faire recommencera...
Mais il est certain que les commentaires de toutes les sortes d’”autres” ont été assimilées par ma petite critique intérieure — laquelle ne fonctionne vraiment qu’une fois le texte né, écrit. Et je me rends compte, par exemple, que la perspective d’être publiée aux États-Unis m’a donné un degré de réflexion de plus sur ce que je fais — après l’avoir fait, encore une fois. Mon dernier roman, Les Voyageurs malgré eux (inédit) 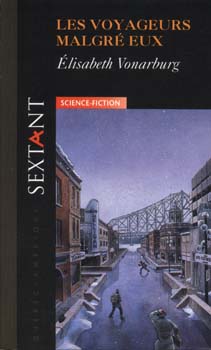 a suscité chez le lecteur de Press Porcépic, mon éditeur canadien anglais, exactement le commentaire que j’avais prévu : “OK pour le Canada, peut-être problématique pour les États-Unis, parce que c’est “very French” (il veut dire “canadien-français”...). J’attendrai les commentaires de Bantam, (l’éditeur américain), et alors, j’aviserai. Mais l’écriture de la chose, et avant son écriture, sa conception même, n’ont de comptes à rendre qu’à elles-mêmes — et à moi. a suscité chez le lecteur de Press Porcépic, mon éditeur canadien anglais, exactement le commentaire que j’avais prévu : “OK pour le Canada, peut-être problématique pour les États-Unis, parce que c’est “very French” (il veut dire “canadien-français”...). J’attendrai les commentaires de Bantam, (l’éditeur américain), et alors, j’aviserai. Mais l’écriture de la chose, et avant son écriture, sa conception même, n’ont de comptes à rendre qu’à elles-mêmes — et à moi.
C’est en cela que, dans une perspective américaine, je ne suis pas une “professionnelle de l’écriture”.
PL : Quelles sont les personnes que vous voulez atteindre par vos écrits ?
EV : Les gens capables de les lire, serais-je tentée de répondre, c’est-à-dire une certaine portion du lectorat, (SF et général), assez limitée. Je suis lucide, je sais que le genre de choses que j’ai envie de raconter, et la façon dont je les raconte, n’intéressent pas tout le monde, et de loin. Mais en réalité, les gens que je veux “atteindre”, dont je désire qu’ils lisent mes textes et m’en parlent, ce sont d’abord mes amis, et les personnes qui font partie de mon paysage intérieur — collègues et critiques respectés. Ceux-là, je les connais, je sais que je peux les “atteindre” : ils sont à portée de téléphone ou de lettre. Les autres, les inconnus, je me les souhaite, mais je ne compte pas sur eux. Quand ils m’arrivent, dans une convention ou un salon du livre, c’est comme un luxe inouï, un cadeau tombé du ciel : “Eh, il y a d’autres personnes que les copains qui me lisent ! ” Il y en a même qui aiment ça...
PL : Vous arrive-t-il de relire vos textes publiés et de ne pas être entièrement satisfaite de ce que vous avez écrit ?
EV : Bien sûr. Mais j’ai aussi une conscience très claire de mon écriture (thèmes et réalisation, je veux dire) dans le temps : de son évolution — de mon évolution ! Il y a des choses qu’on ne peut pas écrire autrement à une période donnée de son évolution, c'est une question de capacité humaine et littéraire. Quand l’occasion m’en est donnée, (ça s’est présenté assez souvent), je retouche les erreurs les plus flagrantes, celles qui défigurent le texte : des non-concordances de dates, des phrases mal foutues, des incohérences dans l’intrigue... Mais même si j’ai ultérieurement une conscience plus claire de ce que j’ai “voulu faire”, ou de ce que “voulait dire” l’histoire, au plan des contenus (et c’est toujours le cas parce que je réfléchis constamment sur le sens de ce que j’ai écrit), je n’ai encore jamais eu de remords ni de regrets, du genre “Je l’écrirais bien mieux maintenant”. Non : je l’écrirais autrement aujourd’hui, et ce serait sans doute une autre histoire. Je n’ai encore jamais rien publié dont je n’étais satisfaite à l’époque, mes fonds de tiroir sont... dans mes tiroirs ! Et la fidélité à soi veut qu’on accepte l’image que vous renvoie un texte passé : “Ah, j’étais comme ça à ce moment-là...” Ça me sert de point de repère pour voir si j’ai grandi, changé.
PL : Avez vous le désir secret, un jour ou l’autre, d’écrire pour un public plus large que celui de la SF ?
EV : D’une façon toute abstraite, et pas du tout secrète, comme n’importe quelle écrivaine, (n’importe quelle exhibitionniste...), j’ai bien quelque part envie d’être lue par un maximum de monde (ne serait-ce que pour le fric ! ) Mais je te renvoie aux questions (4), (5), (6) et (7) pour un commentaire plus poussé de cette question...
PL : Quelle serait votre réaction si on vous disait qu’on n’aime pas le genre de fiction que vous écrivez, que c’est trop littéraire et pas assez imaginatif, ou avec pas assez d’action ?
EV : Quelle a été ma réaction quand on m’a dit tout ça, tu veux dire (et bien d'autres choses ! ) Composite. Ça va de “ouiiiin, j’veux que tout l’monde m’aiaiaiaiaime ! “ à “Va donc chier”, ou plutôt sa variante polie, “Too bad, on ne peut pas plaire à tout le monde”, en passant par “Vous êtes parfaitement libre de ne plus jamais me lire et de fourguer ce bouquin à une librairie d’occaze”. Entre la blessure narcissique et l’agressivité, il y a toutes les nuances. Mais j’essaie surtout de comprendre, en général, pourquoi, à partir de quoi, la personne me fait ces remarques : personnalité, autres lectures, éléments précis dans le bouquin ou l’histoire en accusation... D’où me parle ce lecteur, cette lectrice, ses a priori, ses bébelles, tout ça. Après tout, c'est ça, la vraie communication entre auteure et lecteurs, non ? (on souhaiterait parfois que le lecteur se donne le même mal...) C’est passionnant, en général, et en général ça me rend mon calme — c’est mon côté ethnologue. Et ainsi, il y a des personnes dont l’avis négatif m’est complètement équilatéral (et même certaines dont je peux prédire avec exactitude la nature et la formulation des commentaires négatifs, ce qui est un peu déprimant, à vrai dire). Et d’autres personnes de la part de qui ça me dérange énormément, et je vais revenir dessus comme un chien sur un bout d’os, 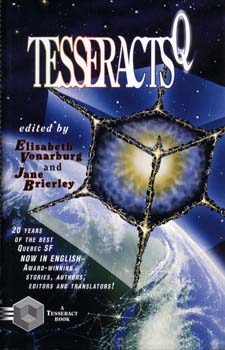 jusqu’à ce que ma remise en question de moi-même (et du texte. Oui, j’avoue, je tends à m’identifier pas mal à ce que j’écris) ait produit des débuts de réponses satisfaisantes. Tout dépend de la façon dont je perçois la qualité de l’interlocuteur... Mais j’ai eu récemment un petit velours. On est en train de compiler des listes des 50 meilleurs nouvelles de SFQ d’après telle ou telle “personnalité du milieu” pour le projet Tesseracts Québec (traduction en anglais pour une antho). Et j’ai eu le plaisir surpris de retrouver plusieurs de mes textes dans le peloton de tête... mais jamais les mêmes ! Ce qui m’amène à penser que j’aurai désormais une réponse à au moins une des critiques qu’on me fait, “c’est toujours la même chose ! ” : “il faut croire que non, la preuve...” jusqu’à ce que ma remise en question de moi-même (et du texte. Oui, j’avoue, je tends à m’identifier pas mal à ce que j’écris) ait produit des débuts de réponses satisfaisantes. Tout dépend de la façon dont je perçois la qualité de l’interlocuteur... Mais j’ai eu récemment un petit velours. On est en train de compiler des listes des 50 meilleurs nouvelles de SFQ d’après telle ou telle “personnalité du milieu” pour le projet Tesseracts Québec (traduction en anglais pour une antho). Et j’ai eu le plaisir surpris de retrouver plusieurs de mes textes dans le peloton de tête... mais jamais les mêmes ! Ce qui m’amène à penser que j’aurai désormais une réponse à au moins une des critiques qu’on me fait, “c’est toujours la même chose ! ” : “il faut croire que non, la preuve...”
PL : Vous avez été la première québécoise en SF à être publiée en France (Denoël). Que vous a apporté l’expérience à ce jour ?
EV : D’être citée comme la première québécoise en SF à être publiée en France.
Mais sérieusement. Ça m’a apporté... Quelque chose de décoratif dans mon CV ? Ah ben non, c’est plutôt le fait que ce bouquin (Le Silence de la Cité) ait gagné un prix, qui fait bien dans le CV. Alors, ça m’a apporté... Environ trois mille dollars de droits d’auteure en dix ans ? La jalousie de certains de mes collègues ? Tout un tas de critiques plus ou moins pertinentes à coller dans mon scrap-book, pour les jours où je serai bien vieille (faut bien rigoler un peu) ? D’assister à des discussions interminables pour savoir si je suis une auteure québécoise ou française (il semble que pour toi au moins ce soit réglé, Pierre : aaah, chouette) ?
Mais sérieusement. Ça m’a donné un bouquin publié à fourguer à Press Porcépic quand ils m’ont demandé si j’avais un roman à leur proposer. Et alors ils l’ont fait traduire, et alors il a été republié en Angleterre, et alors maintenant il fait partie du deal que m’a offert Bantam et il va être publié aux États-Unis, ce qui me permettra — avec un peu de chance — d’avoir l’avis de quelques autres collègues aimés/respectés en langue anglaise... et quelques critiques à ajouter à mon scrap-book, et quelques $ou$ à mon compte en banque, mais pas grand chose, il y a deux éditeurs qui se servent d’abord, et ma traductrice aussi (qu’elle soit bénie).
Mais sérieusement. C’est d’avoir publié ce bouquin en France qui m’a apporté tout ça, ou simplement de l’avoir publié tout court ? (Avec le fait, bien entendu, qu’il soit géniâl ! ) Je te laisse en décider.
PL : Que retirez-vous de votre longue expérience en tant qu’ex-directrice littéraire de la revue Solaris ?
EV : Pendant ces onze ans, j’ai énormément appris sur l’écriture. J’ai énormément appris sur la lecture. J’ai énormément appris sur les écrivains et les lecteurs. J’ai énormément appris sur moi-même. J’ai énormément appris sur l’exercice du pouvoir. Bref, et en quelque sorte, j’ai énormément appris.
PL : Parlez-nous de vos ateliers d’écriture. Etes-vous persuadée que cela peut vraiment aider les auteurs débutants à devenir de vrais pros ?
EV : Pour les ateliers d'écriture, je pourrais en dire autant que de la direction littéraire : j’y ai énormément appris, et le même genre de choses, mais en direct, à chaud, et donc d’une façon beaucoup plus frappante. J’en ai donné en SF, mais j’ai aussi donné des ateliers simplement littéraires, sans viser un genre particulier de littérature, dans un cadre institutionnel, en universités. Et les expériences ont été exactement semblables — pour moi et pour les étudiants, j’ajouterais. Il est certain que cela a influencé de façon majeure la façon dont j’envisage la littérature, le littéraire, la question de l’inspiration et tout le fourbi...
Si cela peut aider les débutants à devenir de vrais pros ? ... Qu’entends-tu par “vrais pros” ? Des gens qui savent présenter un manuscrit à un éditeur ? Oui, éventuellement. Des gens qui savent comment fonctionne le monde de l’édition, savent lire un contrat ? Non, absolument pas, ce n’était pas l’orientation de mes ateliers. Des gens capables d’écrire n’importe quoi à la commande parce qu’ils possèdent tous les trucs ? Non, absolument pas, parce qu’il n’y a pas de trucs — ou du moins mes ateliers n’étaient pas de ce type (il en existe, cependant, des ateliers de ce type ! Je ne dirai pas ce que j’en pense). Des gens qui savent écrire génialement ? Non plus. Un atelier d’écriture ne fabrique pas des génies ni même de bons écrivains, ni même des écrivains.
Des miens sont sortis, je crois, des gens qui ont commencé à savoir lire, se (re)lire, et lire autrui ; des gens qui ont commencé à mieux comprendre ce qu’est la réception d’un texte ; des gens qui ont commencé à reconnaître leurs forces et leurs faiblesses dans l’écriture de la fiction, aussi bien au plan des contenus qu’au plan de la forme, et qui ont commencé à comprendre le fonctionnement de telle ou telle stratégie pour tirer partie des unes et remédier aux autres. Des gens, éventuellement, qui ont commencé à réaliser ce que ça peut impliquer d’être un écrivain — ou une écrivaine — plutôt que de simples écrivants, c’est-à-dire des gens qui se distraient en écrivant, (c’est leur droit, ils peuvent parfaitement continuer après avoir participé à des ateliers), ou des-qui-jouent-à-écrire, c’est-à-dire qui prennent des poses décoratives pour avoir les bénéfices du statut d’hartiste mais pas les responsabilités — et là, moi, je débarque assez vite...
Ce que tous ceux qui participent à des ateliers font après avoir commencé d’apprendre ceci ou cela, c’est d’eux que cela dépend. Des ateliers n’ont pas grande influence sur la pulsion à écrire, le désir et la volonté d’écrire, et de terminer, et de réécrire, et de faire lire, et de réécrire, et de continuer en dépit des éventuels commentaires négatifs, et des éventuels refus. Et d’approfondir sans cesse son acte d’écriture, et d’organiser sa vie en fonction de cette écriture. C’est ça, pour moi, “un vrai pro”. Ça n’a pas grand chose à voir avec le genre d’ateliers, ni avec le genre de littérature qu’on pratique — ni avec the bottom line.
PL : Est-ce suite à ces ateliers que vous est venue l’idée d’écrire et de publier un livre sur le sujet ?
EV : J’ai d’abord publié une série d’articles dans Requiem puis dans Solaris à la demande de Norbert Spehner (ça m’a gagné deux Boréal, les seuls que j’aie jamais eus en de hors du Silence !). Puis on m’a demandé d’en faire un livre, et j’ai sauté avec reconnaissance sur cette  offre pour écrire Comment écrire des histoires, guide de l’explorateur, aux éditions La Lignée, Beloeil, ça se commande en librairie, très beau, pas si cher, et non, je n’éprouve aucun scrupule à pousser ce livre, parce que, par les nombreux commentaires de toutes sortes d’utilisateurs, que j’en ai eu et continue à en avoir, je sais qu’il sert à quelque chose (comme les ateliers, mais pour davantage de monde, ouaiaiaiais ! ). S’il ne reste qu’un seul bouquin de moi, que ce soit celui-là ! offre pour écrire Comment écrire des histoires, guide de l’explorateur, aux éditions La Lignée, Beloeil, ça se commande en librairie, très beau, pas si cher, et non, je n’éprouve aucun scrupule à pousser ce livre, parce que, par les nombreux commentaires de toutes sortes d’utilisateurs, que j’en ai eu et continue à en avoir, je sais qu’il sert à quelque chose (comme les ateliers, mais pour davantage de monde, ouaiaiaiais ! ). S’il ne reste qu’un seul bouquin de moi, que ce soit celui-là !
(Est-ce à dire que j’en suis plus fière/contente que des autres ? Qu’écrire de la non-fiction éducative est plus important qu’écrire de la fiction ? Hum.
C’est important d’une façon différente. Alors que la fiction est une bouteille à la mer, je sais qu’on lit Comment écrire des histoires, et qu’on s’en sert, et je sais qui — le public captif, les pauvres, des écoles, collèges et universités... mais ils n’ont pas l’air de s’en plaindre. Le facteur communication-échange est plus facile à évaluer. C’est comme de préparer un bon repas pour des amis : on sait ce qu’on leur donne, on sait comment ils le reçoivent... Et ce qu’ils en font, ajouterai-je, au risque d’entendre au fond de la salle : “De la merde ! " Certes. Mais avant cela, il y a transformation de la nourriture en énergie utile pour le corps, n’est-ce pas ? La merde, somme toute, est le résidu d’une opération largement positive.)
PL : Si vous aviez un jugement critique à porter sur ce qui s’est écrit en SFQ depuis 1974, quel serait-il ?
EV : Je dirais que ça c’est écrit, que c’est là et que ça continue, et que j’attends toujours avec impatience de voir ce que Machin va écrire maintenant, ou Truc. Mais en fait, je suis trop près pour répondre à cette question. Je connais trop Machin, ou Truc. Je ne vois pas “la SFQ depuis 1974” mais le cheminement personnel, hautement idiosyncratique, de Truc, ou de Machin. Oh, je pourrais très bien faire des “jugements critiques” — après tout, comme prof, j’ai été formée à ça. Mais ce serait donner dans un panneau trop facile, et dont la légitimité me semble de plus en plus discutable. J’aimerais te retourner la question : pourquoi me demandes-tu cela ? Pour voir si j’ai les mêmes goûts que toi ou non ? Pour voir (et faire voir, en me guettant au tournant) qui j’aime ou n’aime pas ? Qu’est-ce qui te fait penser que mes opinions ont plus, ou moins, d'intérêt que la tienne, celle de l’éditeur de Temps Tôt, ou celle de n’importe lequel de ses lecteurs ? Ai-je vraiment un point de vue privilégié, ou des lumières exceptionnelles, ou un Goût qui pourrait servir d’Arbitre ? Je ne crois pas.
PL : Pensez-vous que l’amateurisme pour un fanzine soit synonyme de médiocrité ?
EV : Hé-hé-hé-hé-hé (ricanement sardonique). Compte tenu de mes démêlés en France avec Octa Magazine, son éditeur et ses lecteurs, compte tenu aussi des longues et répétitives discussions qui ont lieu dans le milieu depuis des années sur ce point, que ce soit à Solaris ou dans le fanzine que tu éditais, Carfax, je trouve que poser cette question est d’une assez jolie hypocrisie, mon cher Pierre. Mais OK, les lecteurs de Temps Tôt étaient sans doute à peine nés en ce temps-là, reprenons pour eux. Pas avec des réponses, non-non-non, mais avec des questions que je les invite à se poser :
C’est quoi, pour eux (tu me poses la question à leur place, n’est-ce pas ?) “l’amateurisme” ? Par rapport à quoi, la “médiocrité” ? Et même, somme toute, qu’est-ce donc qu’un “fanzine” ?
Toute réponse honnête et compréhensible à ta question exige de moi que je définisse ce que moi j’entends par ces termes. Si je commence à définir, avec ma légendaire sobriété, j’en ai pour environ une dizaine de numéros de Temps Tôt. Puis-je prendre un chèque-de-pluie ?
PL : Qu’attendez-vous d’un fanzine ou d’une revue semi professionnelle ?
EV : (Ah bon, voilà que c’est la même chose ? Je croyais qu’un fanzine et une revue semi-professionnelle étaient deux choses bien différentes...)
Qu’ils me plaisent, me divertissent, m’intéressent et me fassent penser.
PL : Si vous pouviez revenir en arrière dans le temps, qu’aimeriez-vous changer, que feriez-vous autrement ?
EV : Je n’aurais confiance en aucun éditeur pour faire son travail. Je ne me laisserais pas intimider par un éditeur. Et j’exigerais toute négociation avec un éditeur par écrit en triple exemplaire devant huissier. C'est aussi ce que je recommanderais à tous les écrivains débutants ! |