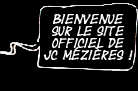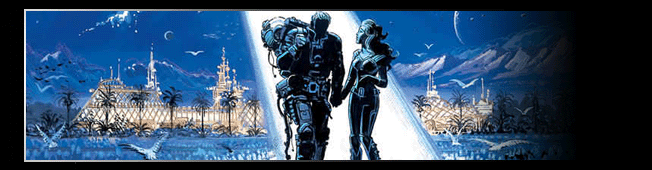

ARTICLE
|
Bande dessinée : Frankfurter Rundschau, Octobre 2000 En cette rentrée d'octobre, la bande dessinée est présente un peu partout en France. Une exposition de prestige au sein de la grande bibliothèque François Mitterrand à Paris. Une promenade à thème dans le nouveau (et splendide) parc de Bercy qui lui fait face de l'autre côté de la Seine. Des planches accrochées dans de nombreux musées parisiens ou provinciaux.
Une pièce de théâtre à succès adaptée d'un album à succès lui aussi. Des émissions qui lui sont désormais consacrées sur la très élitiste radio France Culture. Les librairies qui réservent leurs meilleurs emplacements aux nouveautés en dépit de la lancinante course aux prix littéraires. Les universités qui font figurer la BD en bonne place dans leurs programmes de sciences de la communication ou de l'éducation...
Sans compter les intellectuels qui depuis longtemps évitent soigneusement l'ostracisme, tels le philosophe Michel Serres s'érigeant en éminent tintinologue, l'ex-conseiller présidentiel Jacques Attali s'associant au dessinateur Philippe Druillet le temps d'un livre, ou encore le grand sociologue Pierre Bourdieu faisant appel à Jean-Claude Mézières pour concevoir les premiers numéros de sa revue « Actes de la Recherche en Sciences Sociales ». Sans oublier l'événement rituel qui s'approche pour le mois de janvier, à savoir le salon de la bande dessinée d'Angoulême, seul sans doute à pouvoir — dans son registre — rivaliser avec Francfort en termes de notoriété éditoriale internationale.
Quel contraste avec la situation des « comics » dans d'autres pays ! Le mot lui-même, par rapport à la « bande dessinée », est déjà lesté d'une charge négative le renvoyant à une sorte de puérilité régressive expliquant par exemple la place qu'occupent les petites boutiques de fascicules aux USA : juste à côté, et même un peu en dessous, des sex-shops. En Angleterre, dans les bibliothèques publiques où le savoir est disposé en rayonnages bien ordonnés, les rares albums égarés là sont fréquemment placés dans un coin où se retrouvent en vrac des ouvrages hétéroclites réunis par un seul trait commun, celui d'être « out of size ». En Espagne, malgré une grande tradition graphique, les modestes illustrés vendus en kiosque n'ont pas permis à des artistes comme Carlos Gimenez de briller dans lumière de la « movida ». Au Moyen-Orient, lorsque vous annoncez que vous êtes à la fois scénariste de bande dessinée et professeur d'université, vous suscitez au mieux la méfiance, au pire l'hilarité. Quant au Japon, la puissante industrie des « mangas » ne relève sans doute pas directement d'une approche en termes de créativité mais plutôt de productivité. En Allemagne enfin, en dépit des accomplissements d'un grand directeur de collection comme Andréas Knigge à Hambourg dès les années 80, en dépit de la chaleureuse réussite d'un festival comme Erlangen, en dépit de l'existence déjeunes dessinateurs promis à un bel avenir, il reste me semble-t-il un peu de chemin à faire pour que la BD s'inscrive dans le paysage culturel.
Pourquoi cette situation française bien particulière, accordant une place de choix à ce que beaucoup considèrent encore ici et là dans le meilleur des cas comme un art mineur ? D'abord, il conviendrait de savoir ce qui peut légitimement être considéré comme un art plastique majeur aujourd'hui. La peinture ? La sculpture ? La photo ? Le design ? La mode ? Au delà d'investissement financiers à caractère souvent spéculatif, de pratiques muséales passablement arbitraires, d'effets d'imposition médiatique bien orchestrés, tous ces domaines de la création — au demeurant parfaitement respectables — peinent à montrer une supériorité morale ou esthétique autre que celle liée à des pratiques de la classe dominante et/ou à des enjeux économiques parfois faramineux .
De ce point de vue, la bande dessinée apparaît à bien des égards comme un genre de basse extraction, à la fois ciblée sur la lecture enfantine, liée à des formes de presse populaire, éloignée des préoccupations formalistes de certaines avant-gardes, attachée de façon en quelque sorte consubstantielle à la représentation figurative et à la linéarité narrative, et de surcroît pratiquée le plus souvent par des créateurs d'origine sociale modeste. C'est pourquoi elle se situe plutôt du côté d'autres formes d'expression elles aussi fraîchement reconnues ou en passe de l'être. Car plus qu'avec les arts plastiques, c'est avec le jazz, le rock, le rap, le reggae ou le raï, que la BD a ici des accointances. Ces genres musicaux plus ou moins nouveaux, d'origine suburbaine et métissée comme une équipe de football à la française, sont beaucoup plus proches du monde de la bande dessinée que le micro-milieu des galeries d'art. Egalement proches de la BD, les « mauvais genres » littéraires : le polar, la science-fiction, le fantastique, l'érotique même dans une certaine mesure, et par dessus tout, l'humour. N'oublions pas non plus évidemment le cinéma. Dans ce petit paradis des salles obscures qu'est la France, autant le dire : jeunes et moins jeunes auteurs de bande dessinée sont tous des enfants du cinéma, de ses images, de ses dialogues, de ses acteurs.
Autant de choses, donc, qui se mêlent pour constituer non pas une subculture ou une paralittérature — comme on a pu le croire dans les années 70 — mais bien davantage le véritable substrat de la modernité autant que le support de l'expression pour ceux qui ont quelque chose à dire sur leur monde, celui dans lequel ils vivent, hic et mine. Et non pas l'univers perçu comme quelque peu asphyxiant d'une « haute culture » soumise aux diktats d'un Pierre Boulez ou d'un Philippe Sollers, autoproclamés arbitres des élégances sur ce qui serait moderne ou ne le serait pas en matière musicale ou picturale.
Restent encore quelques mystères à dissiper pour mieux cerner cette exception française. D'abord, historiquement, le genre lui-même a eu la chance d'être constitué par des créateurs exceptionnels qui en fondaient la grammaire universelle en même temps qu'ils menaient leur oeuvre personnelle : Hergé côté bien-pensant avec Tintin, Franquin côté décapant avec Gaston, Charlier côté réaliste avec Blueberry, Goscinny qui — outre Astérix —
a su ouvrir dans les années 60 son journal « Pilote » à d'innombrables jeunes dessinateurs et les a encouragés à s'exprimer dans leur propre style, de Giraud à Tardi en passant par Fred, Gotlieb, Claire Brétecher et tant d'autres.
Ensuite, traditionnellement si l'on ose dire, la France offre un peu plus de porosité que d'autres pays entre culture cultivée et culture populaire, entre genres nobles et genres ignobles. Marcel Duchamp a su le premier transformer les objets les plus triviaux en oeuvres d'art. Gide a reconnu et même un peu jalousé la fécondité littéraire de Simenon. Sartre et Beauvoir étaient des lecteurs de « Détective », magazine de faits divers pas vraiment élégant. Et c'est ainsi que, à partir de 1981, un ministre socialiste de la culture comme Jack Lang est parvenu à fédérer avec bonne humeur des activités à l'intérêt ou à la réussite plus ou moins manifestes en leur décernant en quelque sorte des permis de séjour sur la scène culturelle.
Autre facteur de contamination des registres : la menace (réelle ou supposée) de la standardisation culturelle véhiculée par la télévision, les jeux vidéo,
Internet, etc. ; et, corrélativement, le fantasme (justifié ou déplacé) de l'analphabétisation rampante des jeunes Français. Alors là, alliance à front renversé inattendue ! Instituteurs, professeurs, bibliothécaires, éditeurs et même universitaires, effrayés par le recul de la lecture ( en particulier la lecture romanesque, devenue pratique essentiellement féminine) redécouvrent une nouvelle ligne Maginot : plutôt que de ne rien faire, poussons nos sauvageons illettrés à lire nos ennemis d'hier, i.e. bande dessinée, roman policier, presse
magazine, etc. Curieuse victoire, en somme.
Rappelons néanmoins que tout n'est pas forcément rosé au royaume de la bande dessinée. Si la production éditoriale continue à fonctionner selon un rythme soutenu (jusqu'à 800 titres par an, ce qui est énorme), les échecs sont plus nombreux que les succès, on s'en doute. Le marché est fragile, d'autant plus que les albums reviennent cher à fabriquer alors qu'ils sont vendus à bon marché (environ moitié prix d'un petit roman en collection classique), ne laissant qu'une marge réduite aux éditeurs qui n'ont dès lors plus que deux choix principaux.
Soit avoir quelques héros récurrents à succès, soit multiplier les titres. Ces deux stratégies sont porteuses de risques de natures différentes . On le voit avec le développement de séries standardisées comme XIII ou Largo Wynch, appliquant non sans habileté les recettes de techno-writers américains auteurs de best-sellers à répétition. Mais la tentation est grande aussi, pour retrouver un public d'adolescents parfois rebutés par l'extrême sophistication d'albums de création, de revenir à des valeurs de comics ayant fait leurs preuves : gros nez, gros seins, gros flingues, érotisme et ésotérisme de bazar, ce qui en soi n'a rien de grave mais qui tend à rejeter la BD dans le ghetto dont elle a eu du mal à sortir.
Tout ce qui précède resterait cependant incompréhensible au lecteur étranger si l'on ne terminait pas par ce qui constitue l'essentiel. C'est à dire l'existence de ce que l'on peut appeler une certaine école française de dessinateurs, talentueuse, diverse, et toujours en renouvellement. Là où, sous d'autres cieux, des jeunes artistes vont faire le choix de la peinture de chevalet, des installations, de l'illustration, de la décoration, de la publicité, que sais-je, en France, aujourd'hui comme hier, certains des plus doués d'entre eux vont spontanément se diriger vers ce qui, faute d'être un métier vraiment lucratif (sauf pour une poignée de vedettes) apparaît comme un formidable espace de liberté d'expression. Sans cesse l'invention graphique s'incarne dans des nouveaux noms : André
Juillard, Max Cabanes ou François Boucq pour les maîtres du dessin ; Franck Margerin, Florence Cestac ou Lewis Trondheim dans le camp désopilant ; et un Enki Bilal pour une oeuvre tout entière irréprochable.
Mais on ne va pas citer ici tous les grands prix d'Angoulême sauf pour rappeler que ceux-ci, à la différence notable des fameux prix littéraires français, ne sont pratiquement jamais contestés tant leur exemplarité est évidente pour tous. Car c'est cela aussi la spécificité culturelle de la bande dessinée : une des rarissimes formes de lecture interâge, interclasse , ou pères et fils, jeunes et vieux, lecteurs cultivés et amateurs de franche rigolade, fans collectionneurs d'autographes ou jeunes filles pour qui il ne s'agit que d'une forme narrative parmi d'autres, communient de façon assez exceptionnelle dans un genre qui génère chez beaucoup une véritable passion à la française.
|