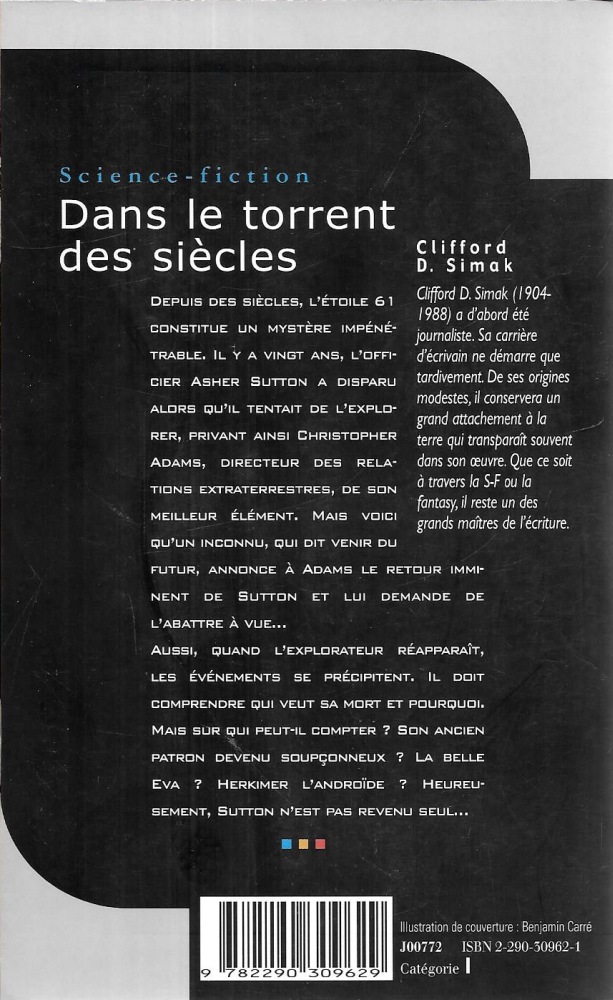|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Dans le torrent des siècles
Clifford Donald SIMAK Titre original : Time Quarry (magazine) / Time and Again (volume) / First He Died (chez Dell), 1951 Première parution : Galaxy Science Fiction, octobre à décembre 1950. En volume : États-Unis, New York : Simon & Schuster, 1951 ISFDB Traduction de Georges H. GALLET Illustration de Benjamin CARRÉ J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (2001 - 2007)  n° 500 n° 500  Dépôt légal : novembre 2000, Achevé d'imprimer : 3 novembre 2000 Roman, 320 pages, catégorie / prix : I ISBN : 2-290-30962-1 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Autres éditions
Sous le titre De temps à autres HACHETTE / GALLIMARD, 1962 Sous le titre Dans le torrent des siècles J'AI LU, 1973, 1975, 1984, 1990, 1993 in Galaxie (1ère série) n° 1, NUIT ET JOUR, 1953 in Galaxie (1ère série) n° 2, 1954 in Galaxie (1ère série) n° 3, 1954 in Galaxie (1ère série) n° 4, 1954 in Les Mines du temps, OMNIBUS, 2004
Quatrième de couverture
Depuis des siècles, l'étoile 61 constitue un mystère impénétrable. Il y a vingt ans, l'officier Asher Sutton a disparu alors qu'il tentait de l'explorer, privant ainsi Christopher Adams, directeur des relations extraterrestres de son meilleur élément. Mais voici qu'un inconnu, qui dit venir du futur, annonce à Adams le retour de Sutton et lui demande de l'abattre à vue... Clifford D. Simak Critiques des autres éditions ou de la série
Tel Simak à l'aube de ce premier roman 1, le protagoniste principal de Dans le torrent des siècles a un livre à écrire, mais au début du récit, le personnage ne le sait pas encore. Pour l'heure, en 6000 et quelque, Ash Sutton rentre à la base au bout de vingt ans d'absence, sur un astronef percé de partout, qui ne devrait pas voler, et dans un corps remanié, qu'il “retrouve” — tout comme le vieil hôtel où il aimait à séjourner. Le vieux robot de la famille, lassé de l'attendre, a décampé depuis belle lurette dans les astéroïdes, mais Adams, le patron de Sutton, est toujours là. Si Ash découvre une Terre qui l'a érigé en héros après sa “disparition” dans l'impénétrable constellation du Cygne, la planète mère le dégoûte bien vite : l'assassinat institué y règne sous forme de duel ritualisé, on y traite les androïdes quasi-humains comme des esclaves et, au lieu de faire preuve d'humilité, l'homme se prend pour l'espèce élue qui doit civiliser par la violence un cosmos hostile. Or celui-ci est peuplé d'autres races plus évoluées ; Ash en sait quelque chose, puisqu'une de ces entités habite son esprit après l'avoir ressuscité sur Cygne 61 et doté d'un organisme “double” — qu'il peut déconnecter à l'envi. Quand Ash comprend qu'un envoyé du futur a prévenu Adams de son arrivée et qu'on a découvert sur une lointaine planète, dans un vaisseau accidenté, la trace d'un livre dont lui-même est l'auteur, il se rend compte qu'il se retrouve malgré lui au centre d'une lutte entre factions rivales qui le prennent pour une sorte de Messie. Mais quel sera son message ? C'est ce qu'il lui reste à saisir. Et surtout, il lui faut se réapproprier son destin, car les exégètes futurs de sa pensée sont innombrables, ont envahi le temps et ne cessent de vouloir s'emparer de lui, le poursuivant dans diverses péripéties... (Le premier titre original anglais, Time Quarry, signifie d'ailleurs “ la proie du temps ”.) A la différence de Simak, et malgré l'intermède d'un long séjour à la ferme au 20ème siècle, Sutton ne parviendra pas à coucher son livre sur le papier dans le cours du roman, mais une fin ouverte le verra laisser derrière lui la jeune femme dont il est épris pour s'atteler à la tâche. Sutton ignore que sa dulcinée n'est autre qu'une androïde... alors que le message qu'il a à délivrer, on l'a deviné, est une leçon d'humilité prônant l'égalité à instituer entre humains et robots. Comme Demain les chiens, Dans le torrent des siècles est à la fois un hymne humaniste et une critique affligée des aspects les moins reluisants de la nature humaine. Ces considérations générales sur la violence et l'arrogance inutiles de notre espèce trouvent un écho à peine voilé, sous couvert d'une évocation du futur, dans des éléments reflétant les années 1940-1950 : retour des vétérans de la 2ème Guerre mondiale et suites de celle-ci (Ash revient d'une zone de “silence radio” total rappelant celui du bloc communiste de l'époque et, si la paranoïa hégémonique à tout crin d'Adams et de la Terre évoque assez clairement la guerre froide et les prémisses de l'intervention américaine en Corée puis au Vietnam, l'atterrissage du début, avec la voix intérieure qui habite Ash et ses sensations de ne pas “être” dans son corps, fait irrésistiblement penser au déphasage de l'ancien combattant victime de stress traumatique — c.f. également la scène naturaliste, p. 108, où Ash tire un mourant de l'eau, à propos de laquelle on ne peut s'empêcher de penser au best-seller de Norman Mailer, Les nus et les morts, récit de guerre situé pendant la guerre du Pacifique et paru en 1948 2) ; on retrouve aussi de façon assez transparente dans les revendications des robots les débuts de la déségrégation des Noirs américains 3 — voire l'Holocauste à travers le marquage sur la peau desdits robots. Le chapitre 11 livre quant à lui dans la Maison du Zag une délicieuse scène de rêve 100% pur Freud, où, parti à la pêche avec une fillette près du Grand Trou (sic !), Ash enfant échange un petit ver contre un gros poisson. Si l'auteur n'évoque ici qu'indirectement la sexualité (le contraire serait difficile au début des années 1950, même si le premier rapport Kinsey est paru deux ans plus tôt), il se situe loin du pastoralisme gnangnan et vieux jeu auquel certains voudraient le cantonner. 4 Simak fait également appel dans ce roman d'action métaphorique et philosophique à un florilège d'outils science-fictifs qui ont certainement réjoui l'amateur de SF de l'époque et que l'avenir n'a pas (encore ?) démentis : voyages dans l'espace et le temps/paradoxes temporels, “bons” robots quasi-humains, mais aussi “gadgets” tels le vidéophone ou la communication interstellaire par transmission de pensée. Les questionnements de Sutton sur son destin préfigurent du reste étrangement ceux d'un Paul Atréides dans le cycle de Dune, et la scène de la Maison du Zag ainsi que le troisième tiers du récit ne sont pas sans suggérer des problématiques dickiennes. On voit donc toute la puissance d'un ouvrage qui n'a rien perdu de son sel, et dont la lecture laisse à la fois désabusé et plein d'allant. Notes : 1. A part Les ingénieurs du cosmos, un feuilleton — avec toutes les contraintes que cela implique — paru dans Astounding en 1939 (la version en volume ultérieure a d'ailleurs été remaniée), et Empire, réécriture d'un manuscrit de jeunesse de John W. Campbell, Simak n'a publié jusque-là que des nouvelles, même si certaines composeront ensuite le « roman épisodique » Demain les chiens. Nathalie MÈGE
[critique « commune » à DANS LE TORRENT DES SIECLES (J'ai Lu n° 500) et à A PIED, A CHEVAL ET EN FUSEE (Denoel Pressence du Futur n° 175)] Toute sa vie, c'est-à-dire dans toute son œuvre, qui est vaste et diverse, Clifford D. Simak a exalté sur le ton de la ballade des vertus simples : la fraternité de tout ce qui vit, le sens immanent de la justice, l'amour de la nature, les joies que procure un travail utile et bien fait. Et, par-dessus tout ça, plane l'ombre fluide du Destin, qui fait régner l'harmonie en prenant son temps, et pour qui une vie d'homme, ou de chien, ou de robot, n'est rien d'autre qu'un grain de poussière dans le sablier de l'éternité. Simak a su ainsi allier un spiritualisme jamais intellectuel et jamais non plus bondieusard à une vision de l'histoire qui, pour être formulée en termes idéalistes, n'en a pas moins acquis une actualité qu'on lui aurait déniée il y a seulement dix ans. A l'image de son confrère Bradbury, Simak le passéiste, le bucolique, le « réactionnaire », peut aujourd'hui faire bonne figure dans le peloton de tête des auteurs touchés par l'écologie et le concept de l'an 01. « Alors que j'avais fait des études de droit, je découvris bientôt que cela ne répondait pas entièrement à mes goûts et depuis quarante ans et même un peu plus, je me suis occupé d'agriculture, y trouvant plus de satisfaction que j'en ai jamais trouvé dans le droit. Car l'agriculture est un travail honnête et moralement réconfortant qui vous met en contact avec les premières nécessités de la vie, et où on trouve, je crois, un contentement presque vaniteux dans la tâche simple, et pourtant étonnante, de tirer de la nourriture du sol. » (P. 130). Cette confession, dont il n'est pas douteux que l'auteur la prenne à son compte (même si, pour notre satisfaction de lecteur, il ne l'a pas appliquée dans les faits), est tirée de son roman Dans le torrent des siècles, publié originellement en 1951 et dont J'ai lu nous offre, après l'ancien Galaxie et le Rayon fantastique, une troisième traduction enfin fidèle et complète. Simak est unanimement célébré pour Demain les chiens. Time and again, qui lui succède immédiatement dans la chronologie, est plus révélateur des constantes qui donnent à l'œuvre son unité, de l'éthique qui la sous-tend. Asher Sutton, agent galactique qu'on croyait mort depuis vingt ans et qui, effectivement, a bien été tué dans l'écrasement de son astronef sur une planète interdite du Cygne, revient sur Terre avec les fondements d'un livre qui, dans le futur, a déjà été écrit. Ce livre, dont le titre est Ceci est la Destinée, et qui s'ouvre sur la phrase « Aucune créature ne marche seule sur la route de la vie », est le manifeste du mécanisme du Destin, lequel n'est autre que l'évolution, façonnée par une intelligence secrète et toute-puissante. Darwin rejoint Dieu, Simak rejoint Simak, et l'histoire du futur rejoint l'histoire du passé. Car en cette année 8386, l'égalité ne règne toujours pas, malgré ou à cause de l'expansion subie par l'humanité : « Les hommes étaient éparpillés dans toute la galaxie. Un homme seul ici, une poignée là. (...) Car l'homme avait volé trop vite, avait poussé trop loin — au-delà de ses capacités physiques. (...) Trop éparpillés et sur des distances trop grandes. Un homme, avec une douzaine d'androïdes et une centaine de robots, pouvait tenir un système solaire. Pouvait le tenir jusqu'à ce qu'il y ait davantage d'hommes ou que quelque chose craque . » (p. 37). Et en effet, pour « tenir » ces territoires immenses, les hommes ont créé une sous-race à leur image, les androïdes, qui ne peuvent se reproduire et portent, gravé sur le front, leur numéro de série, comme une marque d'infamie, de ségrégation. Asher Sutton va être le prophète des androïdes, il est l'envoyé du Destin, qui leur signifie que l'heure a sonné pour eux de leur libération. Chaque époque a son Juif, son nègre, et il y a toujours un Sauveur. Mais il ne suffit pas. Un homme providentiel n'est jamais qu'un déclic de l'histoire et le dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera » est plus vivant que jamais : sur une planète secrète, le Berceau, les androïdes ont redécouvert le secret de la vie, de la reproduction... Cette galaxie, dont la cohésion repose sur la présence d'androïdes exploités, ressemble étrangement à l'Empire romain, dont l'éphémère et fragile puissance s'appuyait sur l'exploitation d'esclaves bien plus nombreux que les libres citoyens. Ceci précisé, il est loisible d'extrapoler sur le destin de Sutton, et de voir en lui un nouveau Christ accordé à l'âge spatial, un être tué et ressuscité, envoyé sur Terre par une puissance qu'on ne connaîtra jamais pour enseigner la justice et soulever les esclaves, puis repartant dans l'inconnu son œuvre accomplie, sans pouvoir accéder à sa destinée humaine : « ... une femme, une androïde, qui sanglotait, le cœur brisé. » Dans ce roman touffu à l'extrême, le plus van vogtien de l'auteur (space-opera doublé d'un time-opera centré sur l'existence d'un super-héros qui, au départ, ne connaît ni l'étendue de ses pouvoirs ni le but ultime qui le motive inconsciemment), Simak ne se contente pas d'habiller de péripéties une thèse humaniste. Il le fait en conteur qui sait, par-delà l'événement, s'arrêter au bon moment pour enfiler comme des perles toute une suite de digressions qui nous ramènent en réalité au cœur du récit et lui donnent son épaisseur. Pour que, à travers Sutton, le lecteur se laisse envahir par la nostalgie d'une existence plus saine et plus rude, il faut d'abord donner de la Terre une image sans équivoque : « ... une planète qui n'était qu'une capitale... une planète qui ne produisait pas de nourriture, qui ne permettait aucune industrie, qui ne s'occupait que de gouverner. Une planète dont chaque parcelle était l'œuvre d'un paysagiste et soignée comme une pelouse, un parc ou un jardin. » (p. 58). Ensuite l'auteur peut faire donner toutes les cordes de son orchestre, pour la grande symphonie à la nature qui s'opère à travers l'exil de Sutton au XXe siècle (gageons que si le livre avait été écrit vingt ans plus tard, c'est au XIXe siècle que Simak aurait situé son âge de grâce !), où il doit pendant dix ans vivre comme un fermier : « Parfois le travail, non seulement par son effet sédatif mais en lui-même, devenait quelque chose d'intéressant et de satisfaisant. L'alignement bien droit des poteaux d'une clôture nouvellement posée devenait un petit triomphe lorsqu'on la regardait dans toute sa longueur. Le champ moissonné, avec sa poussière sur votre faucheuse, l'odeur du soleil sur la paille dorée, et le claquement de la lieuse, tandis que la machine allait et venait, devenait une symphonie puissante, d'abondance et de consentement. Et il y avait des moments ou le rose des pommiers en fleur, resplendissant à travers la pluie argentée du printemps, devenait un hymne sauvage et païen a la résurrection de la Terre après les froidures de l'hiver. » (pp. 236-237). Mais cette plongée dans les joies limpides de l'existence ne s'arrête pas à la satisfaction du travail accompli. Grâce aux pouvoirs de son esprit, Sutton entre en contact, presque en symbiose, avec le cerveau d'une souris (« ...la crainte toujours présente, frémissante, insurmontable... l'élan et le bonheur de vivre, la joie de se sentir des pattes rapides, le contentement d'un ventre bien rempli et la douceur du sommeil... »), et c'est dans ces pages qu'il faut voir l'expression la plus nette des tendances de Simak à la fraternisation totale des êtres vivants. De manière caractéristique, répond à cette séquence, dans A pied, à cheval et en fusée, le passage consacré à la fusion spirituelle de Ross, un aventurier humain, et de Hoot, une créature pensante venue d'une autre dimension : « Je lui tendis mes mains et ses tentacules s'en emparèrent, s'y enroulèrent et les serrèrent fortement et a ce moment, mes mains et ses tentacules soudés ensemble, je ne faisais plus qu'un avec cet ami. Pendant un instant me furent révélées les ténèbres et la lumière de son être et j'eus la brève révélation (...) de ce qu'il savait, de ce dont il se souvenait, de ce qu'il espérait, de ce dont il rêvait, de ce qu'il était (...) de l'irréelle, choquante, presque incompréhensible structure de sa société et de la lisière, à peine une ombre pâle, de l'arc-en-ciel de ses mœurs. » (P. 231). A vingt ans d'écart c'est bien la même recherche de la fraternité inter-espèces, de même que le fonctionnement du destin passe toujours par les mêmes structures : « Et qu'est-ce que le destin ? Est-ce quelque chose qui n'est pas écrit dans les étoiles mais dans les gènes des hommes qui savent comment ils vont agir, ce qu'ils désirent, et comment ils vont s'y prendre pour l'obtenir ? » (p. 244). Bien sûr, on pourra ressentir Destiny Doll comme un Simak mineur, comme une resucée effritée des grands thèmes de jadis : les lecteurs de Galaxie, dans le numéro 120, ne lui accordent, au firmament du Littératron du mois, qu'une « naine », cotation 7 à 10 sur 20... Sans doute est-ce là un Simak de sa veine Scheckley, qui roule sur l'exploration, par un groupe mixte mi-humain mi-non humain, d'une planète pleine de pièges, de chausse-trappes, d'illusions fantasmatiques et de créatures toutes plus bizarres les unes que les autres. On peut aussi penser à certains Wul et, pourquoi pas, à une bande dessinée de Forest, tant les personnages et créatures sont typés et pittoresques : côté humain, outre Mike Ross, on trouve Sara, une Diane-chasseresse hautaine, frère Tuck (le nom vient de la saga de Robin Hood), qui est un moine ascétique, ainsi que Smith, un aveugle doué d'un sixième sens ; côté non humain, il y a l'extraordinaire Hoot, dont la vie passe par trois « soi », un robot rimailleur du nom de Roscoe, les « dadas », des chevaux à bascule qui sont plus que des automates, et une multitude d'êtres de rencontre, comme cette roue énigmatique dont le moyeu vivant est une « cochonnerie tremblotante », des centaures belliqueux, des arbres dont les graines sont des réservoirs à mémoire... En fait, sous les apparences limpides d'un roman d'aventures épiques et pas trop sérieuses, Simak remet sur le métier son éternel problème du destin individuel et collectif de chaque vie, avec la dialectique écologique que cela suppose. De même que dans la vie de la souris, bonheur et crainte étaient intimement liés, de même Ross éprouve, après avoir « tué » un arbre pensant qui le bombardait de ses graines meurtrières, la houle du désespoir que lancent vers lui les créatures symbiotiques (encore la symbiose...) qui habitaient le végétal ; « Sans-abri, criaient toutes ces bouches. Vous avez fait de nous des sans-abri. Vous avez détruit notre maison et maintenant nous n'avons plus de maison, qu'allons-nous devenir ? Nous sommes perdus. Nous sommes nus. Nous avons faim. Nous allons mourir. Nous ne connaissons pas d'autre endroit. Nous demandions si peu de chose, nous avions besoin de si peu de chose et même cela, vous nous l'avez retiré. Quel droit aviez-vous de nous le retirer, vous qui possédez tant de choses ? Quelle espèce de créature êtes-vous donc pour nous jeter ainsi dans un monde dont nous ne voulons pas, que nous ne connaissons pas, où nous ne pouvons même pas vivre ? (p. 137). (...) Une sourde colère monta en moi, en réaction à ce sentiment de culpabilité et je me surpris à essayer de justifier l'abattage de l'arbre ce qui, considéré isolément, était facile, car cela pouvait être expliqué et justifié d'une manière simple. L'arbre avait tenté de me tuer et m'aurait d'ailleurs tué si Hoot n'était pas intervenu. L'arbre avait donc essayé de me tuer et je l'avais abattu, ce qui n'était que justice élémentaire, tout le monde en conviendra. Mais l'aurais-je fait, me demandé-je, si j'avais su qu'il abritait toutes ces lamentables créatures ? J'essayai bien de ma persuader que je n'aurais pas agi de cette manière si je l'avais su, mais ce fut peine perdue. Je savais reconnaître un mensonge, même lorsque je me le destinais. Je devais bien l'admettre : j'aurais agi exactement de la même manière si je l'avais su. » (p. 139). Rien n'est simple, le manichéisme n'existe pas dans l'univers. C'est ce que nous chuchote A pied, à cheval et en fusée qui, sous les dehors enchanteurs du roman picaresque, nous serine en sourdine une des grandes leçons de Simak : aucune entreprise ne vaut de sacrifier le simple bonheur de vivre. L'expédition, qui devait rapporter la richesse et la connaissance se dissout non seulement parce que le but recule à mesure qu'on s'en approche, mais mieux encore parce qu'il s'estompe dans l'esprit de Ross et de Sara : « Et en fin de compte nous poursuivions un mythe et ce mythe n'était qu'un autre piège — un leurre à l'intérieur d'un leurre. » (p. 220). Même le projet formidable de rassembler toute la connaissance de la galaxie dans les chaînes nucléiques des arbres à mémoire a été abandonné par les mystérieux planteurs, qui n'avaient peut-être formé ce dessein que « dans l'enthousiasme irréfléchi de leur jeunesse ». Et Ross en personne, qui ne cessait de répéter que tout est bon à vendre, abandonne sans regret ce qui faisait son passé (la volte-face est peut-être un peu rapide, mais qu'importe ? ) « comme un enfant abandonne un jouet dont il s'est lassé », pour vivre une vie neuve dans une des enclaves dimensionnelles de la planète-mirage, où l'attend un décor qui nous est désormais familier : « Le village et la rivière s'étendaient en dessous de nous et des champs et des bois s'allongeaient jusqu'à l'horizon. Et je savais que ce monde n'avait pas de fin et qu'en même temps il était la fin du temps ; endroit éternel, immuable, où il y avait une place pour chacun. » (p. 282). Ce paradis familier, il est plaisant de l'imaginer comme la matérialisation des rêveries d'un vieux monsieur nostalgique et fatigué, un vieil auteur de science-fiction. Mais il est plus plaisant encore de penser que nous, lecteurs, pourrions nous y arrêter un jour, but ultime, « fin du temps », pour y lire des romans de Clifford Simak ou, mieux encore, pour n'avoir plus besoin d'y lire quoi que ce soit... Denis PHILIPPE
Simak est célèbre en France depuis la traduction de « Demain les chiens ». Pourtant ce cycle de contes, aussi admirable soit-il, n'est peut-être pas le chef-d'œuvre de son auteur ; quelques-uns (j'en suis) donneraient plus volontiers la palme à « Time and again ». On peut en discuter à perte de vue, bien sûr ; mais je crois que cette opinion serait plus répandue si les Français pouvaient lire cet ouvrage dans sa langue maternelle. Car « Time and again » est un livre maudit, dans notre langue du moins. Une première version française, baptisée « Dans le torrent des siècles », en parut dans les quatre premiers numéros de « Galaxie », voici bientôt neuf ans ; traduction très inférieure à l'original, mais qui néanmoins aurait pu se justifier (car il faut être indulgent avec les traducteurs, ces tâcherons sous-alimentés, ces manœuvres de base de la littérature) si elle n'avait scandaleusement tronqué et détourné de son sens le texte de Simak. Une réédition s'imposait ; nous l'avons attendue longtemps, la publication en magazine ayant, paraît-il, asséché le marché. Mais « Galaxie » a cessé de paraître, et ses premiers numéros sont devenus introuvables ; notre ami Stephen Spriel, la providence des amateurs, a donc inscrit « Time and again » à son programme. Et voilà que c'est raté, une fois de plus, par la faute du traducteur – et cette fois, je le crains, sans remède possible : car la publication en volume exclut toute réédition pour longtemps. Il aurait mieux valu faire recommencer la traduction, tant la catastrophe est grande : mais la SF est encore considérée comme une parente pauvre, qui ne justifie pas de si grosses dépenses ; ce qu'un éditeur consent à Melville ou Tolstoï, il le refuse à Simak. « De temps à autres », c'est donc la dernière chance, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, de connaître « Time and again » avant leur extrême vieillesse. Je crois, puisque c'est la dernière, que c'est une chance à ne pas manquer ; mais il est juste que les lecteurs en puissance soient prévenus de ce qui les attend. On trouvera donc ci-dessous deux critiques : celle d'un texte français inexcusable à tous points de vue ; celle d'un des plus hauts chefs-d'œuvre de la SF américaine, qui au moins (c'est notre seule consolation) nous est proposé ici dans sa version intégrale. Le plus navrant dans cette traduction, c'est qu'elle est très ambitieuse : le titre français procède d'un intellectualisme légèrement abusif, qui gauchit la formule simakienne pour y rajouter un calembour cérébral, et fait craindre une adaptation plus soucieuse de retrouver le ton de Queneau ou de Vian que celui de l'original. Cette infidélité désinvolte est bien dans le propos du rédacteur, la suite le prouve assez ; mais dès la page de garde, le coupable se cache sous le gracieux pseudonyme de « A. Yeurre », ce qui nous met sur le vrai registre : celui des almanachs Vermot d'avant-guerre. Le texte français apparaît surtout comme une arrière-manifestation d'un populisme de pêcheur à la ligne, qu'on croyait bien mort pourtant ! Le rédacteur doit avoir appris le français dans « Les Pieds-Nickelés » : ayant décidé d'écrire en langue parlée, il retrouve tout naturellement le style de l'argot 1935, qui pourtant n'avait pas survécu à Marcel Duhamel, même dans « Le Hérisson ». Qu'on en juge : « Il a quelque chose en tête, quelque chose qui ne biche pas » (p.132) ; « Ramenez-vous par là une autre fois, dit le vieux » (p.313) ; « Des systèmes économiques et des concepts psychologiques qui nous ont laissés babas…» (p.93). (C'est moi qui souligne.) Ce pourrait être une parodie ; mais il semble bien, à voir d'autres phrases, que l'auteur vient tout juste d'être admis à la maternelle : « Mais il y a autre chose que les mots, autre chose dont il est plus facile de savoir si c'est du vrai » (p.115) ; « Je me demande des fois jusqu'à quel point un homme a le droit d'être satisfait » (p.360). Ce n'est pas seulement qu'il bêtifie, c'est qu'il ne connaît pas le français. Il lui arrive d'employer des mots dont il ignore le sens, comme « maniérisme » (p.184) ; mais ce n'est rien, au regard des ignorances grammaticales. Vous est-il arrivé de lire trois solécismes en une seule phrase ? Non ? Eh bien, voyez : « Mais son esprit à lui ne leur disait seulement que ce qu'il voulait bien leur avouer, seulement assez pour qu'ils n'aient aucun soupçon qu'il gardât quelque chose pour lui » (p.374). Il est vrai que si le rédacteur ne connaît pas l'idiome en usage, il est imbattable sur les tournures désuètes. Il faut le voir parler de « pourchas » (p. 30), ou employer « embûche » dans son sens initial d'« embuscade » (p. 162) ! Derrière le titi de sous-préfecture, on sent percer, constamment, le poète décadent, disciple de Jean Moréas : « Ça du être la foi (…) qui a fait les hommes de Néanderthal peindre les tibias en rouge…» (p. 142) ; «…déterminer (…) quelles parties en sont originales et quelles ne le sont pas » (p. 284). Mais le pire, c'est qu'il ne voit pas de dissonance entre ces registres et qu'il mélange, sans vergogne aucune, le populo et l'ampoulé. Dans l'exemple cité plus haut, il est question de « lorgner le pourchas » ! Mais il va plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'au bucolico-truand : « Un geai raya le ciel et vint se poser sur un poteau de barrière lavé de soleil. Il remua la queue et cria, engueulant quiconque était à portée de sa voix » (p. 347). Ce goût morbide pour la laideur, qui ne rate aucune occasion de s'exprimer, finit par donner un résultat très varié. Il vous arrivera de lire : « Du calme, la panse. Au boulot, le foie. Pompe toujours, mon cœur » (p. 19) – ce qui serait du Jean Cap, si ce n'était si vulgaire. On peut jouer à chercher la phrase la plus ridicule : « On l'attrape, dis, Johnny ? » nous ramène au pisseaulisme mentionné plus haut, et inciterait plutôt à l'indulgence due aux enfançons ; le tic-tac du traceur trouvera certainement des partisans, mais la plume me tombe des mains à l'idée de le reproduire, et je laisse au lecteur le plaisir de la surprise. Personnellement, j'opte pour : « Le manuscrit est là, j'ai contrôlé, entier. — Et des tas de papier ? — Et des tas de papier. » (p. 173). Ces exercices de style sans verve ni panache ne mériteraient que le silence, si le responsable avait fondé l'école olibriste ou la littérature escogriffique pour son propre compte. Malheureusement il s'en est pris à un autre, dont il a lâchement maculé le texte : procédé qui se comprendrait, s'il s'agissait d'un autre Frédérick Le maître et d'une nouvelle « Auberge des Adrets » ; mais avoir défiguré le fleuve calme de Simak par un pareil tatouage, ça mériterait une fessée – car je doute que l'inconscient qui s'est permis une plaisanterie aussi hors de propos soit capable de prendre la décision qui s'impose : aller cuver sa honte chez Les Trappistes, et expier dans Les mortifications. Mais laissons là Yeurre et ses turlutaines. Le lecteur est prévenu, il ne risque plus de surprises catastrophiques ; il se peut même qu'il ait épuisé son agressivité en ma compagnie, ce qui lui permettrait de lire le livre ensuite sans s'attarder à ces détails trop voyants. D'ailleurs la grandeur de « Time and again » survit à ces excentricités, ce qui en dit long ; les écarts du traducteur se font même plus rares au bout de deux cents pages, comme si la personnalité la plus forte avait fini par phagocyter l'importun. C'est de cette personnalité, une des plus remarquables de la science-fiction américaine, qu'il sera question maintenant. « Time and again » est un livre d'une exceptionnelle richesse. Simak y fait pratiquement l'inventaire complet de ses thèmes favoris – plus complet encore que dans « Demain les chiens ». Il en résulte une impression de foisonnement et de générosité qui fait penser à Van Vogt, d'autant plus que ta technique du livre, nettement inspirée du grand apôtre des « rouages entre les rouages », vise à faire pénétrer le lecteur dans un univers incompréhensible. Une remarque du genre : « Coïncidence ou plan, cette fois ? Difficile à savoir » (p. 46) fait figure de citation, comme les multiples comparaisons de joueur d'échecs ; et nombre de scènes suivent une démarche qui est exactement celle de l'« idéalisme » van vogtien : ainsi le héros se trouve vivre une scène édénique (p. 106), mais on comprend après coup qu'il y est un enfant (p. 108) et enfin qu'il imagine cette scène dans une boîte de « rêves sur mesure » (p. 112). Toute l'exposition notamment, qui occupe près de 150 pages, est un véritable récital de ruses de guerre visant à dépister le lecteur né de la dernière pluie. Asher Sutton, parti depuis vingt ans explorer 61 Cygni, est de retour ; il va rendre compte de sa mission à Christopher Adams, son chef de service. Entre ces deux événements tout simples, Simak réussit à créer une quantité d'incidents si impressionnante, à introduire une quantité de personnages si énorme, que toutes les tentatives d'analyse, ou seulement de repérage, font instantanément naufrage dans la brume. Mentionnons à titre d'exemple qu'Adams est lancé dans l'action dès la première page, mais que sa fonction n'est définie qu'à la page 59, et que la date de l'intrigue n'est donnée qu'à la page 120. Pourtant la manière de Simak, si on la regarde de plus près, diffère sensiblement de celle de van Vogt. Si l'auteur du « Monde des non-A » ne cesse d'introduire des rouages entre les rouages, c'est que pour lui une réalité en cache toujours une autre, et qu'il n'y a guère de terme à sa quête : on ne devrait pas comparer ses intrigues à des puzzles ou à des labyrinthes, parce que chez lui ce n'est pas seulement le chemin à parcourir qui fait problème, mais aussi le chemin déjà parcouru : les perspectives ne cessent de changer, les résultats acquis d'être remis en question. Au contraire la structure de « Time and again » ressemble réellement à une architecture, car Simak sait où il va : le retour de Sutton finira par restaurer l'ordre dans un univers en folie, et les morceaux épars du cosmos sont, par eux-mêmes, vides de sens ; il n'y a rien d'autre à faire que de les recoller. C'est pourquoi il n'y a pas ici, à proprement parler, de « rouages à l'intérieur des rouages » : chaque chapitre apporte un fait-choc, mais un seul, et des chapitres d'inégale longueur se suivent comme des éléments de puzzle. Aussi bien les principaux éléments du jeu nous sont-ils donnés coup sur coup, du chapitre XIV au chapitre XVI : 1° Sutton revient de l'au-delà ; 2° Une guerre se déroule dans le temps ; 3° Cette guerre a pour cause la mission dont Sutton a été chargé dans l'au-delà, et qui lui reste à accomplir. Vivre son destin : c'est désormais le seul problème de Sutton, et l'intrigue se linéarise peu à peu sans renoncer au « style » compliqué qui fait l'un des charmes de l'ouvrage, mais qui n'en est sans doute pas l'élément le plus sérieux au regard de l'auteur. À ce stade, quelques grands thèmes ont fini par se dégager, planant au-dessus de la mêlée ; et Simak introduit entre ces thèmes des liens organiques. Ici encore, la démarche du héros est profondément originale : Van Vogt est un incomparable poseur de problèmes, mais les pistes qu'il explore tournent court le plus souvent ; « Time and again » au contraire est une construction philosophique et presque une démonstration. Le premier thème majeur est celui des androïdes. Les hommes les ont créés à leur image, pour les aider à tenir un empire galactique trop vaste ; mais ils leur ont imposé des limitations (incapacité de se reproduire, marque sur le front) qui leur permettent de les maintenir dans une condition inférieure et de les traiter comme des outils. On pourrait croire que l'unique problème des androïdes est de conquérir l'égalité qui leur apporterait, contre le mépris ou le paternalisme des hommes, l'espoir et la dignité. Simak dit fort bien tout cela ; pourtant l'essentiel à ses yeux est ailleurs. Son antihumanisme est bien connu des lecteurs de « Demain les chiens » : à ses yeux la race humaine est une race orgueilleuse et malfaisante, qui ne vise qu'à conquérir la suprématie par tous les moyens sans se demander quel usage elle en fera. L'absurdité de l'empire ainsi constitué apparaît, par exemple, dans la description du journal galactique (p. 85) : on y voit une série de planètes posées les unes à côté des autres, sans autre problème commun que l'ambition des hommes, sans courants profonds et vitaux. Contre cette monstruosité, Simak trouve un pittoresque contraste déjà utilisé dans « Demain les chiens » : celui des robots. Dotés par l'homme de raison, mais dépourvus de son vouloir-vivre et de son agressivité, ils sont facilement cafardeux, paternels ou entêtés ; leur comportement à la fois sentimental et rudimentaire ressemble d'assez près au fond à celui d'un vieux paysan du passé comme John Sutton. Pourtant il est clair que Simak ici se place sur le plan de la dérision et de la satire : si une machine peut donner une leçon d'humanité aux hommes, la preuve de leur échec sera formelle. Il me semble que la trouvaille des androïdes est beaucoup plus belle, et surtout beaucoup moins pessimiste : une chance est donnée à cette nouvelle race humaine, en tous points semblable à la précédente, d'éviter les erreurs de ses créateurs et de chercher à comprendre l'univers plutôt qu'à le détruire. C'est là le problème de fond qui se profile derrière celui de l'émancipation des androïdes. Car les hommes sont ici décrits comme des sourds : ils ne comprennent rien aux voix de l'espace (ch. VI) ni au langage de la rivière (ch. XXXII). Le héros de l'histoire, Asher Sutton, est le premier homme qui ait écouté et compris ces voix – qui sont les voix du destin. Encore ne l'a-t-il pas fait exprès : simplement, l'astre qu'il est parti explorer se trouve être celui où vivent les destins. Le destin est, dans l'ordre logique, le deuxième grand thème de « Time and again ». C'en est aussi, peut-être, la plus belle idée : qu'un astronaute découvre l'au-delà au bout du ciel, c'est un retournement qui ne manque pas de saveur ; et la constellation du Cygne y retrouve, par un détour inattendu, la signification symbolique du cygne dans toute les eschatologies. Il faut nuancer, bien sûr, cette notion d'au-delà : bien que Sutton se donne comme chrétien (p. 47) et que l'analyse de Simak repose toujours plus ou moins sur l'idée que la vie est un don, il n'en dit pas moins fort explicitement que sa découverte n'est pas une nouvelle religion (p. 240). Les destins, explique-t-il, sont des « abstractions symboliques » accompagnant chaque être vivant au cours de son existence : superbe idée SF que celle de ces entités vivantes, mais aussi, remarquons-le, idée philosophique ; ce sont des êtres du même genre que Platon, dans « Le Banquet », appelait démons – c'est-à-dire des intermédiaires, chargés d'apporter à l'homme une étincelle de la vérité. Or la vérité, pour Simak, réside dans une conception panthéiste de la vie. Les pouvoirs surnaturels détenus par Sutton sont au nombre de deux : 1° il peut triompher de la mort ; 2° il peut vivre la vie des autres (ce qui n'est pas exactement de la télépathie). On pourrait dire la même chose, ou peu s'en faut, du destin : ce n'est pas la fatalité inéluctable, redoutée de cet homme prométhéen que Simak n'apprécie guère ; c'est un petit compagnon fidèle, mi-chien mi-enfant, qui apporte la paix et le bonheur à ceux qui savent entendre sa voix. Le tout est d'accepter, d'« écouter son destin » (p. 357), ce que l'homme ne sait pas faire. La révélation de Sutton, résumée par lui dans un livre, va donc susciter des réactions diverses robots et androïdes s'y convertiront avec enthousiasme ; mais la plupart des hommes la refuseront, craignant d'y perdre leur suprématie, et ceux qui l'accepteront prétendront la réserver à leur propre race, prouvant ainsi qu'ils ne la prennent pas au sérieux et la considèrent seulement comme un instrument de suprématie. C'est ici qu'intervient le troisième grand thème de « Time and again » : celui du voyage dans le temps. Cette technique venant d'être inventée, partisans et adversaires de Sutton se livrent à une guerre acharnée pour protéger, modifier ou détruire le livre qui contiendra sa révélation. On peut s'étonner de voir le panthéiste Simak faire une telle place à ce thème, qui fait appel, plus qu'aucun autre, à la notion d'un univers en désordre. Pourtant il introduit des nuances telles que tout devient logique. Pour lui le temps n'est pratiquement pas malléable : « Le passé ne peut être changé dans sa totalité. Il peut être altéré, subtilement » (p. 343). De là une tactique propre à la guerre temporelle, qui consiste à modifier des événements imperceptibles et bien placés ; ainsi les commandos du temps ne risquent pas de se faire repérer par l'adversaire ou de provoquer des troubles graves, ce qui serait fatal à leur propre avenir : car le temps est un, et il ne peut exister d'avenirs parallèles (p. 93). Quand Sutton voyage dans le temps, c'est pour obéir à son destin : ce qui lui permet de vieillir de dix ans alors que ses alliés l'ont quitté pendant cinq semaines. Cette pause dans la ronde effrénée des événements est symptomatique de la manière de Simak : le paysage édénique de Bridgeport y répond au lent écoulement du temps, et Sutton y puise l'ultime détachement, la sagesse antique où le livre s'abîme en fin de compte, quand il donne son corps à reproduire aux androïdes et qu'il n'est plus qu'une entité flottant dans un océan de lumière, une entité que les hommes appellent traître. Un peu de mélancolie plane sur ces dernières pages, la mélancolie du prédestiné : Sutton se sent solitaire dans son apothéose, et ne réfléchit pas qu'une fois de plus tout a été préparé pour lui, et que son rôle éminent n'est qu'une modeste part au sein de l'ordre du monde. Cet ultime avatar qui remet tout en cause, et qui montre que l'« éternel humain » n'est pas encore vaincu, n'est pas le moins beau mouvement de « Time and again » ; mais il y en a bien d'autres encore, tant qu'il paraît difficile d'en faire seulement le tour, dans ce time-opera bouddhiste, chef-d'œuvre de l'eschato-science-fiction. Jacques GOIMARD |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |