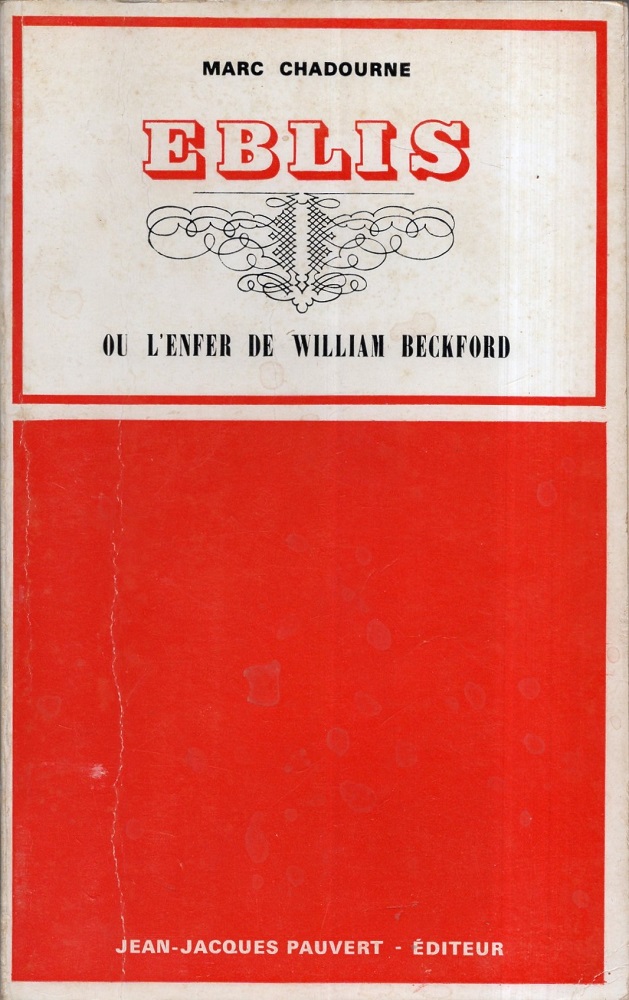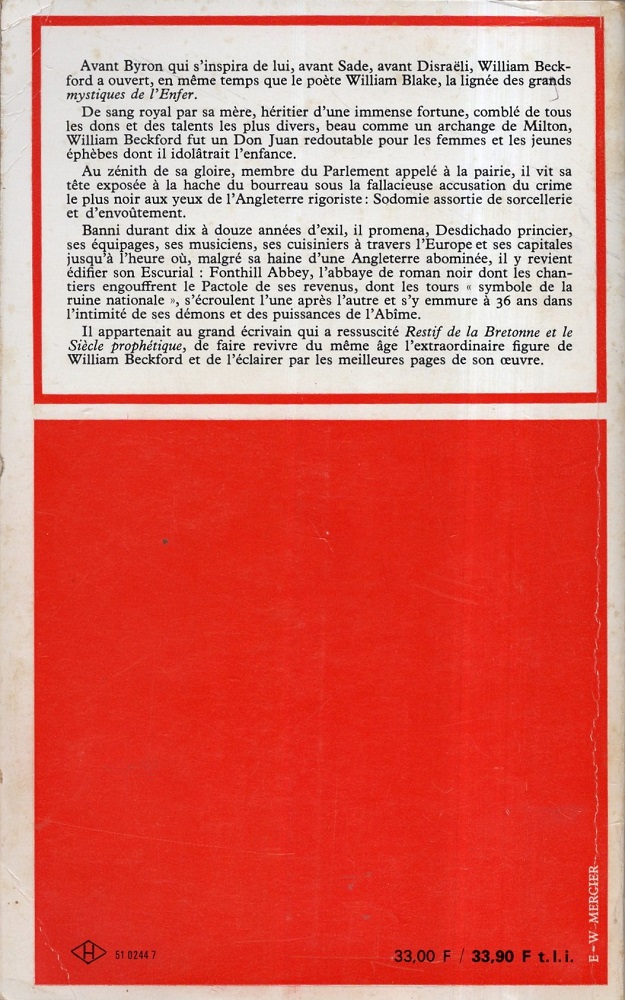|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Eblis ou l'enfer de William Beckford : suivi d'une anthologie de l'œuvre en ses meilleures pages
Marc CHADOURNE PAUVERT (Paris, France) Dépôt légal : 1967 Première édition Étude d'une œuvre, 344 pages ISBN : néant Format : 13,5 x 21,5 cm❌ Genre : Imaginaire
Quatrième de couverture
Avant Byron qui s'inspira de lui, avant Sade, avant Disraëli, William Beckford a ouvert, en même temps que le poète William Blake, la lignée des grands mystiques de l'Enfer.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Avant-propos, pages 7 à 7, préface 2 - L'Homme, pages 17 à 160, essai 3 - William BECKFORD, Le Cycle d'Eblis, pages 161 à 176, extrait de nouvelle 4 - William BECKFORD, Vathek, pages 177 à 218, extrait de nouvelle 5 - William BECKFORD, Histoire du Prince Barkiarokh, pages 219 à 248, extrait de nouvelle 6 - William BECKFORD, Histoire des deux princes : Alasi et Firouz, pages 249 à 264, extrait de nouvelle 7 - William BECKFORD, Histoire de la Princesse Zulkais et du Prince Kalilah, pages 265 à 278, extrait de nouvelle 8 - William BECKFORD, Fin du Cycle d'Eblis, pages 279 à 284, extrait de nouvelle 9 - William BECKFORD, L'Excursion à Alcobaca et Batalha, pages 285 à 330, extrait de nouvelle 10 - Appendice I : Sources, pages 331 à 334, notes 11 - Appendice II : Notes et références, pages 335 à 340, notes
Critiques
William, duc de Beckford, auteur de Vathek et des Épisodes, est l’une des plus étranges figures des littératures de l’imaginaire. Il naît en 1760 de cet autre William Beckford qui fut lord-maire de Londres et qui, par deux fois, ne négligea pas d’admonester sévèrement le roi d’Angleterre au nom de la Cité. De sa mère, Lady Hamilton, il tient du sang royal. À la mort de son père, en 1770, il devient l’homme le plus riche d’Angleterre, sans doute l’un des plus riches d’Occident, grâce aux immenses propriétés jamaïcaines des Beckford dont il parviendra pourtant à épuiser le revenu. Il ressemble à un personnage de conte de fées : il est beau, universellement doué – ne se vantera-t-il pas d’avoir soufflé à Mozart un air des Noces de Figaro ! Il a le goût le plus sûr mais aussi le plus fantasque. Il séduit aisément tous ceux qui lui plaisent, quel que soit leur sexe, il organise dans le vieux château de Fonthill des fêtes étranges et grandioses dont l’apogée se situe à la Noël 1781 en une cérémonie qui durera trois jours et dont l’ignorance des détails enflamme depuis près de deux siècles les imaginations. Aussitôt après, il écrit en deux jours et une nuit, selon ses propres termes, Vathek, en français, et pose le plan des Épisodes. Une affaire de mœurs fait scandale et le jette en 1785 dans un exil de dix ans. Il en profite pour recueillir dans toute l’Europe une fabuleuse collection d’objets d’art. Revenu enfin en Angleterre en 1796, il fait construire un château prodigieux, dans le style néo-gothique qui fleurissait alors : Fonthill Abbey, flanqué d’une tour gigantesque qui s’effondre sous le souffle du vent en 1800. Il éclate de rire et la fait reconstruire. En 1825, elle s’écroule à nouveau. Il fera dans la dernière partie de sa vie construire une troisième tour, à Bath où il s’est retiré, « presque ruiné » si l’on en croit les chroniqueurs. Il meurt en 1844, âgé de 84 ans, en reclus silencieux. Ce bref résumé ne saurait prétendre à donner même une idée de ce que fut la vie de Beckford. Il convient de se reporter au beau livre que vient de lui consacrer Marc Chadourne et auquel se trouve annexé un choix des œuvres littéraires de Beckford, pour mieux saisir ce destin extraordinaire. Car Beckford a accompli trois œuvres qui ne se laissent pas aisément dissocier. Son livre, son château et sa vie. Il est frappant et presque caractéristique de son humour que ses pages aient survécu à ses pierres. Pour singulière qu’elle soit, l’œuvre de Beckford, c’est-à-dire principalement Vathek et les Épisodes qui forment un tout, doit être replacée dans son contexte. D’un côté, elle appartient au XVIIIe siècle. Beckford est presque le contemporain de Sade. Il est un grand seigneur cultivé, peut-être le dernier des aristocrates, si sûr de sa race que, par un séduisant paradoxe, il se fera des amis parmi les révolutionnaires à Paris et qu’il assistera à l’exécution de Louis XVI. Bien avant cela, il aura été recueillir la sagesse de la bouche de Voltaire. Il méprisera et haïra, toute la seconde moitié de sa vie, le XIXe siècle, ce siècle de marchands. Mais, de l’autre côté, Beckford annonce le romantisme, il est lui-même, malgré la brièveté de son œuvre, l’un des plus grands romantiques anglais. Comme Sade, comme Restif, il a le sens et le goût de la clarté. Comme à Sade, elle ne lui suffit pas. Il lui faut chercher autre chose – en partie parce qu’il a tout, en partie pour des raisons plus profondes – dans l’excès, du côté du tourment et de l’ombre. Ses accents sont déjà ceux de Byron qui l’idolâtrera, sinon ceux de Chateaubriand. Il y a dans la rage de Vathek à se perdre quelque chose qui évoque le destin de Faust (écrit entre 1773 et 1831) et la figure de Melmoth (1820). Vathek, calife oriental, est dévoré du double démon de la puissance et de la connaissance. Sous l’impulsion de sa mère, la terrible Carathis, il n’hésitera pas à quitter sa tour de onze mille degrés pour se lancer à la recherche du château souterrain d’Eblis dont le Glaour, effroyable démon, lui a révélé l’existence. En compagnie de Nouronihar, une princesse qu’il a rencontrée dans son voyage, il s’achemine vers sa damnation. Avant que son cœur soit dévoré par une flamme éternelle, il aura le loisir d’entendre les récits de deux autres princes et d’une princesse, non moins acharnés dans le mal. Ces récits constituent les Épisodes. Presque tout est admirable dans Vathek et dans les Épisodes. La richesse et la précision de la langue, l’ingéniosité de l’invention, la somptuosité des lieux, la férocité froide de passions qui demeurent intellectuelles jusque dans leurs déchaînements. D’un seul coup, Beckford a égalé sinon surpassé ses maîtres : les conteurs arabes. Mais il ne leur a guère, à dire vrai, emprunté qu’un cadre. C’est de lui-même et de sa vie qu’il parle. Vathek seul fut publié en 1787, à Lausanne et à Paris, non sans quelques tribulations que je vous laisse le soin de découvrir dans l’ouvrage de Marc Chadourne. Les Épisodes demeurèrent inédits du vivant de Beckford et ne furent édités qu’à partir de 1909. L’un et les autres ne connurent jamais qu’une audience restreinte. Ils faisaient trop de part aux passions pour la prude Angleterre et ils étaient trop délirants, trop oniriques pour la France raisonnante à laquelle ils étaient pourtant dédiés. Ils furent donc périodiquement redécouverts par des esprits de qualité, qui ne parvinrent pas à entraîner le public à leur suite. Ainsi par Mallarmé qui préfaça une édition de Vathek en 1876. Les surréalistes firent à leur tour fête à Beckford. Il est à souhaiter que le livre de Chadourne tire définitivement du purgatoire où elle est demeurée l’œuvre étincelante de William Beckford. Le choix de textes qui est proposé au lecteur et qui est fort habile convaincra, je l’espère, de nombreux lecteurs de se reporter à une édition complète. La meilleure, à ma connaissance, reste celle qui parut chez Stock en 1948, qui est accompagnée d’une excellente présentation de J.B. Brunlus et qui reproduit la préface de Mallarmé. Elle est malheureusement épuisée, ayant figuré dans une collection remarquable, « Les Voyages imaginaires », qui connut l’ignominie des soldes. Mais on peut encore la trouver chez des bouquinistes et c’est la chance que je souhaite à nos lecteurs. Entre le conte oriental, le roman fantastique et le délire onirique, Vathek est difficile à situer dans l’univers de l’imaginaire. Il s’y glisse des fragments d’utopie, un souci du détail architectural et vestimentaire qui annonce Poe. La multiplicité et en même temps la fixité des symboles Invitent tout particulièrement à un décryptage psychanalytique. Que l’on songe au destin de Vathek que l’on trouve au sommet de sa tour et qui finit dans les entrailles de la terre, poursuivi par sa terrible mère Carathis, et à celui de Beckford lui-même qui n’en finit pas d’ériger des tours qui s’effondrent, et à l’œil si terrible, si pénétrant, de Vathek, mais qui ne lui permet pas de triompher d’Eblis. Que l’on se souvienne de la difficulté où se trouve Beckford de fixer sa passion sur l’un ou l’autre sexe, et de l’amitié si charnelle qui unit, dans les Épisodes, les deux princes Alasi et Firouz avant que le premier découvre tardivement et presque par accident que le second est en réalité la princesse Firouzkha. Que l’on y ajoute le meurtre du père qui revient comme un leitmotiv et qui est perpétré notamment par le prince Barkiarokh, et l’on comprend que le problème central de Beckford est celui d’un Œdipe non résolu. La névrose prend chez Beckford, pourtant comblé, la forme de l’insatiabilité. Ainsi la soif de Vathek, éveillée par le méchant Giaour et qu’aucune source ne peut étancher. Ainsi l’avidité de Barkiarokh qu’aucune richesse ne satisfait. Ainsi Beckford lui-même, collectionneur acharné, entasseur de trésors dont il n’a jamais vraiment joui. Ainsi, d’autre part, la quête éperdue de la satisfaction au-delà du possible ou du moins du permis, qui porte Zulkaïs et Kalilah à l’inceste et Firouz et Alasi à l’homosexualité. Ainsi enfin la quête éperdue des trésors inaccessibles d’Eblis. C’est peut-être par un scrupule trop rigoureux que certains commentateurs de Beckford ont vu dans le châtiment des adorateurs d’Eblis – avoir le cœur rongé par une flamme éternelle – une conclusion morale de circonstance. Car il exprime totalement l’enfer de William Beckford, sa névrose, son incapacité à aimer vraiment qui le rejette pour plus de la moitié de son existence dans une implacable solitude. Ainsi, à l’orée de sa vie, avait-il entrevu et tracé sous la dictée de son inconscient le labyrinthe de ses jours. Gérard KLEIN |
| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |