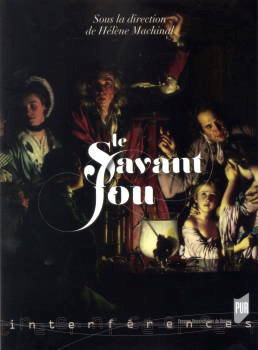|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Savant fou
COLLECTIF Textes réunis par Hélène MACHINAL Illustration de Joseph WRIGHT OF DERBY PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES (Rennes, France), coll. Interférences   Date de parution : 15 mai 2013 Dépôt légal : avril 2013 Première édition Ouvrage universitaire, 516 pages, catégorie / prix : 23 € ISBN : 978-2-7535-2274-9 Format : 15,2 x 20,8 cm✅ Genre : Imaginaire
Quatrième de couverture
Personnage complexe, le savant fou renvoie à une opposition remontant à l'Antiquité qui perçoit folie et génie comme deux notions complémentaires. Cette complémentarité perdure et se nourrit des crises épistémologiques qui bouleversent la perception du monde et de lui-même qu'a l'être humain. La figure du savant fou cristallise de nombreuses peurs diffuses qui peuvent être d'ordre politique, social, religieux, économique ou idéologique et qui ont trait à la possibilité même de se définir en tant qu'être humain.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Hélène MACHINAL, Introduction, pages 11 à 25, introduction 2 - Jean-Jacques LECERCLE, Généalogie de l'archétypde du savant fou, ou : le Savant Cosinus était-il fou ?, pages 27 à 60, article universitaire 3 - Victor SAGE, Frankenstein's education : towards a gothic archaeology of the "[mad] scientist", pages 61 à 72, article universitaire 4 - Bernard JOLY, La Figure de l'alchimiste dans la littérature du XIXe et du XXe siècles, pages 75 à 88, article universitaire 5 - Christophe CHAMBOST, (Dé)raison et sentiments : les savants fous dans l'œuvre de Nathanael Hawthorne et dans la littérature américaine du XIXe siècle, pages 89 à 102, article universitaire 6 - Lauric GUILLAUD, Le Savant fou vernien et la mise à distance du progrès, pages 107 à 125, article universitaire 7 - Laurence TALAIRACH, "Knowledge for its own sake, is the only god I worship" : les "savants fous" dans Heart & Science de Wilkie Collins, pages 127 à 143, article universitaire 8 - Nathalie JAECK, Un savant fou peut en cacher un autre dans "The Island of doctor Moreau" de H.G. Wells, pages 147 à 158, article universitaire 9 - Rémi LE MARCH'HADOUR, L'Héritage du docteur Moreau de H.G. Wells : deux figures de savants fous dans l'œuvre narrative d'Adolfo Bioy Casares, pages 159 à 170, article universitaire 10 - Gilles MÉNÉGALDO, Le Savant fou au miroir du mythe de Frankenstein : trois avatars filmiques (Whale, Fisher, Branagh), pages 173 à 192, article universitaire 11 - Anne HELLEGOUARC'H, Une odeur de soufre tenace : le docteur William Price et la morale non-conformiste (1800-1893), pages 193 à 209, article universitaire 12 - Manuel MONTOYA, De Carlo Gelati à Espérandieu et le docteur Chou : savants fous et discours tératologique dans l'œuvre de Jacques Tardi, pages 211 à 228, article universitaire 13 - Liliane CHEILAN, L'Étrange cas du docteur Murakami dans Baptism, manga de Kazuo Umezu, Japon, 1995, pages 229 à 240, article universitaire 14 - Marie-Christine AGOSTO, Frankenstein chez les cow-boys : the Hawkline monster de Richard Brautigan, pages 243 à 254, article universitaire 15 - Anne LE GUELLEC, "Smashing up the mystery of the world" : le savant naturaliste comme vandale dans Gould's Book of Fish de Richard Flanagan, pages 255 à 266, article universitaire 16 - Gilles CHAMEROIS, Against the day de Thomas Pynchon : Nikola Tesla ou Thomas Edison, la folie ou la mort, pages 267 à 288, article universitaire 17 - Camille MANFREDI, Savant fou, romancier fou dans Poor Things d'Alasdair Gray, pages 289 à 301, article universitaire 18 - Denis MELLIER, Wittgenstein fiction, pages 303 à 325, article universitaire 19 - Jocelyn DUPONT, Les Psychiatres fous du Dr. McGrath, pages 327 à 340, article universitaire 20 - Thierry ROBIN, Idiotie, savoir et folie chez Flann O'Brien, pages 341 à 359, article universitaire 21 - Jérôme DUTEL, Un avatar moderne du savant fou : le linguiste fou, pages 361 à 373, article universitaire 22 - Jean-François BAILLON, Du savant fou à la folie de la science : raison et déraison dans le cinéma britannique à l'âge nucléaire 1950-1965, pages 377 à 388, article universitaire 23 - Pierre CASSOU-NOGUÈS, Norbert Wiener dans la presse américaine : une figure du bon savant fou, pages 389 à 406, article universitaire 24 - Jean-François CHASSAY, Sommeil cauchemardesque, pages 407 à 417, article universitaire 25 - Claire LARSONNEUR, Put the Blame on...? A face/off between neuroscientists and terrorists, pages 419 à 429, article universitaire 26 - Élaine DESPRÉS, Quand les savants ne peuvent plus s'arrêter : la réaction en chaîne de l'irresponsabilité chez Kurt Vonnegut, pages 433 à 449, article universitaire 27 - Roxane HAMERY, Éprouver son amour, réprouver son désir. Trouble everyday de Claire Denis ou les tourments du savant, pages 451 à 461, article universitaire 28 - Isabelle BOOF-VERMESSE, Les Intelligences artificielles ont-elles un sexe ? "Savants fous" et "savantes folles" dans Neuromancer de William Gibson, pages 463 à 475, article universitaire 29 - Christopher Damien AURETTA, David Cronenberg's mad scientist in The Fly : Allegories of the "lab", pages 477 à 492, article universitaire 30 - Gaïd GIRARD, De Blade Runner à Matrix, les savants fous font de la résistance, pages 495 à 503, article universitaire
Critiques
Les colloques universitaires donnent lieu à deux types de publications : la simple compilation des interventions des participants, parfois sans grand rapport les unes avec les autres ; ou des ouvrages plus ambitieux, qui tentent de faire émerger un regard neuf sur un sujet donné à partir de ce faisceau de points de vue convergents. C’est clairement à ce second type de synthèse que s’est attelée Hélène Machinal pour les actes du colloque sur « les savants fous du XIXe au XXe siècle » tenu à Brest en octobre 2009. 516 pages, 30 contributeurs : l’ouvrage qui vient de paraître aux Presses Universitaires de Rennes peut impressionner, mais le jeu en vaut la chandelle. Un beau travail d’édition : l’érudition et même la technicité de la plupart des textes (dont trois en anglais) n’entravent pas la limpidité et l’agrément de lecture de l’ensemble, qu’on peut considérer comme un modèle du genre. Il serait vain de passer ici en revue les différentes contributions, à raison de trois lignes chacune (à peine de quoi citer les titres… Juste un échantillon, pour le plaisir : « L’Héritage du docteur Moreau de H. G. Wells : deux figures de savants fous dans l’œuvre narrative d’Adolfo Bioy Casares », par Rémi Le Marc’hadour). Allez plutôt y voir. Il y en a pour tous les goûts, ou presque, de la littérature, anglaise (Wells, Wilkie Collins), irlandaise (Flann O’Brien), américaine (Pynchon, Vonnegut, Gibson…) et même française (Verne !) à la philosophie, en passant par le cinéma, la BD (Tardi), les mangas et bien sûr l’inévitable Victor Frankenstein. En toute subjectivité assumée, je m’en tiendrai donc aux thèmes qui m’ont le plus intrigué. Etrangement, pour un ouvrage a priori résolument littéraire, les meilleures surprises sont pour moi venues des philosophes, ou des contributions à connotation philosophique. Ainsi, Pierre Cassou-Noguès (interviewé ici même par notre collaborateur Xavier Mauméjean dans notre 61e livraison) choisit-il de présenter la figure de « bon savant fou » construite par la presse américaine autour du cybernéticien (et auteur occasionnel de nouvelles de SF) Norbert Wiener ; Bernard Joly s’intéresse à celle de l’alchimiste et Jérôme Dutel, de façon plus inattendue, à celle du « linguiste fou ». Denis Mellier s’interroge quant à lui sur les représentations du philosophe Ludwig Wittgenstein, dont l’intransigeance intellectuelle est telle qu’elle peut être lue comme une folie, mais aussi comme « une malédiction et une aventure », et qu’on découvre sujet de plusieurs « Wittgenstein-fictions ». Mais si le rédac’chef m’autorise un paragraphe plus technique, le plus étonnant est peut-être la référence récurrente à un autre philosophe, Alain Badiou (d’ailleurs curieusement absent de l’index). L’introduction d’Hélène Machinal explique comment le sommaire de l’ouvrage suit les chemins ouverts par la « généalogie de l’archétype » développée par Jean-Jacques Lecercle, qui se réclame explicitement de la théorie badiousienne de l’événement (L’Etre et l’événement, 1988). Dans son propre article, qui fait office de prologue, Lecercle distingue trois temps de la construction de la forme du savant fou : 1/ le temps de la simple « représentation » d’un événement réel, tel une découverte ou même une révolution scientifique en cours, comme le tableau de Joseph Wright de Derby (1768) qui fournit la dérangeante couverture du livre ; 2/ celui du mythe et du « savant pas fou », dont le moteur est un événement fictif, comme la découverte du secret de la vie par le Dr Frankenstein ; enfin, 3/ celui, largement parodique, de l’archétype « aussi fou que savant ». L’application des nuances ontologiques de Badiou au domaine littéraire, et singulièrement à la science-fiction, ouvre des horizons insoupçonnés et renforce heureusement la cohérence de l’ouvrage. Un regret toutefois, pour finir : le regard largement extérieur que les auteurs (à l’exception notable de Cassou-Noguès) semblent porter sur la science. Pourquoi se donner tant de mal à penser la folie du savant fou, et escamoter l’autre composante du mythe, son rapport organique à la science ? Le sujet, à la confluence des fameuses « deux cultures », scientifique et littéraire, aurait mérité que soient convoqués aussi quelques fous de science… Éric PICHOLLE |
| Dans la nooSFere : 87252 livres, 112069 photos de couvertures, 83686 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |