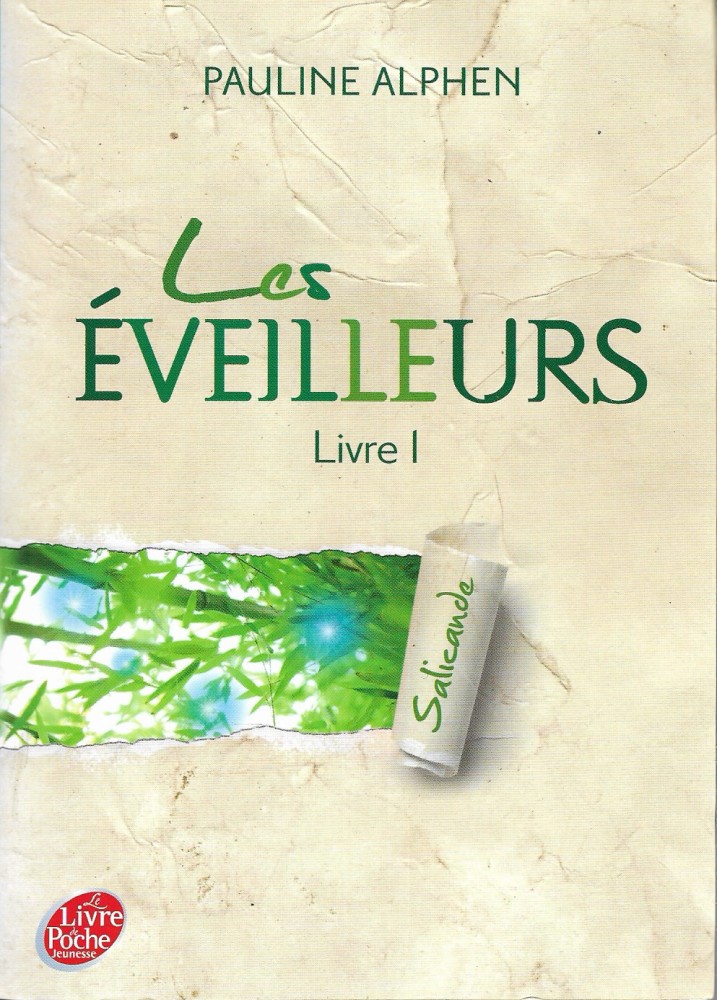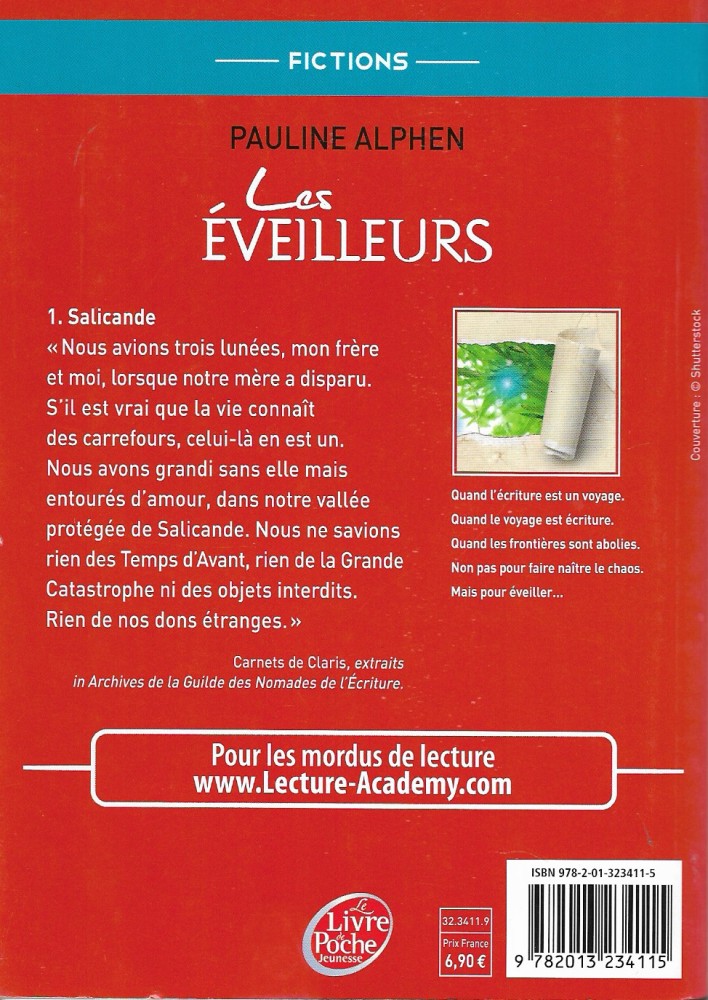|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Salicande
Pauline ALPHEN Cycle : Les Éveilleurs vol. 1  LIVRE DE POCHE Jeunesse (Paris, France), coll. Fictions  n° 1647 n° 1647 Date de parution : 27 juin 2012 Dépôt légal : juillet 2012 Réédition Roman, 544 pages, catégorie / prix : 6,90 € ISBN : 978-2-01-323411-5 Format : 12,5 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Le titre "Salicande" n'apparaît qu'en quatrième de couverture. Couverture : Shutterstock.
Quatrième de couverture
« Nous avions trois lunées, mon frère et moi, lorsque notre mère a disparu. S'il est vrai que la vie connaît des carrefours, celui-là en est un. Nous avons grandi sans elle mais entourés d'amour, dans notre vallée protégée de Salicande. Nous ne savions rien des Temps d'Avant, rien de la Grande Catastrophe ni des objets interdits. Rien de nos dons étranges. » Quand l’écriture est un voyage. Critiques des autres éditions ou de la série
« ''Le troisième millénaire sera vert'' était le slogan des hommes politiques éclairés du XXIe siècle. Ce siècle charnière avait tous les éléments en main pour anticiper la Grande Catastrophe et inverser la tendance. Mais les hommes n'en finissaient pas d'établir des diagnostics sans jamais passer à l'action. » (p.337) * Afin de ne pas abuser le lecteur, permettons-nous une mise en garde : Salicande n'est pas le roman de fantasy que laisse supposer sa vilaine couverture, mais bien un ouvrage de science-fiction, situé en 2259, dans un cadre post-apocalyptique. D'habitude plus inspiré, Stéphane Collignon n'a sans doute pas lu le livre avant de réaliser cette illustration : au lieu de placer un château bêtement moyennageux en arrière-plan, il aurait dû, pour respecter l'intrigue, y représenter « une grosse bâtisse flanquée d'un vieux phare, ruine anachronique d'un temps reculé où la mer recouvrait le relief. » (p.13 !) Certes, l'autrice elle-même joue l'ambiguité en baptisant le phare « la tour » ou son propriétaire « le duc », d'un simple surnom. Ou encore en insérant à son histoire des animaux qui parlent, des élémentaires, une prophétie... Mais la « magie » n'est ici qu'une question de perception du réel à travers le filtre de l'ignorance : à mesure que les personnages découvriront leur monde et son histoire, tous ces éléments seront rationalisés de manière cohérente – notamment à l'aide de pouvoirs psys et d'univers parallèles. De la pure SF... et de la bonne ! Cette découverte du monde se fera en compagnie de jumeaux : le garçon, Jad, souffre d'une maladie cardiaque mais possède un esprit fort qui lui permet de faire face au drame de la disparition de sa mère, Sierra ; la fille, Claris, se veut un garçon manqué, désireuse de manier les armes et de vivre des aventures, mais demeure au contraire incapable d'évoquer la disparue. Leur père, Eben, n'est que l'ombre de lui-même depuis que sa femme est partie et il maintient sans conviction la plupart des interdits concernant la technologie ou le passé, interdits imposés par son propre père, Jors. Bien d'autres personnages vivent aussi avec leur problématique personnelle : le vieux Blaise se voit comme une sorte de Merlin mais peine à se reconnaître comme le père du jeune Ugh ; Bahir Borges, coloriste et libraire, est aveugle et ne peut donc ni voir les couleurs ni lire ; sa fille Jwel est à la fois amoureuse de Blanc Faucon et en colère contre lui car il refuse de rejeter la société phallocrate et rétrograde de Vieil Ambre dont il est issu... En revanche, nul méchant ! Les jumeaux ne doivent pas sauver le monde – du moins pas pour l'instant, d'autres tomes sont à venir, alors qui sait ? Ils n'ont pas non plus à se cacher d'un psychopathe désireux d'asservir la planète. Non, Salicande est essentiellement un roman d'apprentissage : il leur faut visiter le village voisin puis les villes alentours, lire les documents qui leur révèleront l'effondrement de notre civilisation et ses causes, apprendre les échecs, l'escrime et le tir à l'arc, la poésie et la cuisine, découvrir enfin leurs propres pouvoirs, hérités des générations antérieures. Car leur passé – qui est aussi « notre » avenir – fut riche en événements. Les manipulations génétiques ont permis de créer de nouveaux animaux (sizyfs, bézoards, aptérines...) et de nouveaux fruits (jabous, pitanguines...) au détriment de la biodiversité. Clonage et chirurgie ont permis d'allonger la vie de certains. L'émergence de pouvoirs psys, stimulée par des drogues et des logiciels (la « révolution » de Ramsky) a accru la fracture entre Nantis et non-Nantis. Les « Spirit Games » opposant divers clans tels que Magicos, Semi-Ordis et Naturex ont précipité la disparition de toute une génération d'adolescents lors de jeux parapsys. La découverte d'une nouvelle planète – Amazonia – a permis aux plus riches de s'y replier après avoir épuisé la Terre de toutes ses ressources... Cette double richesse – personnages complexes et thèmes multiples aux fortes implications écologiques – apporte ainsi une véritable profondeur à ce roman. Mais Salicande recèle aussi un bel hommage à la lecture : « Lire est un voyage. On ne peut pas arriver sans être parti. On ne peut pas partir sans avoir envie d'arriver. Mais : être entre ! Là réside le vrai délice : le parcours. La lecture. » (p.225). Les personnages savourent et commentent avec bonheur les oeuvres sauvées du passé, comme Les Royaumes du Nord ou Le Seigneur des anneaux. Les références à Harry Potter, à Shakespeare ou même à la Guerre des étoiles abondent. Cet amour de la littérature se matérialise dans une guilde, les « Nomades de l'Ecriture » (formés au Nomadstère, joli néologisme basé sur monastère), tandis que la famille colorée de Bahir Borges fait figure de famille-dictionnaire, usant joyeusement de mots oubliés. « L'une des illusions du Nomade de l'Ecriture est de penser qu'il sait tout de son oeuvre. Ce qu'il écrit, pourquoi il l'écrit. Il ne sait rien. Les personnages savent. Le Lecteur sait. Le Nomade fait de son mieux pour découvrir ce que les Personnages portent en eux et ce que le Lecteur révèle. » (p.226) Restent à découvrir les pouvoirs détenus par les « Vrais Lecteurs », une notion qui nous rappelle irrésistiblement le Coeur d'encre de Cornelia Funke. La présente chronique souhaite rendre compte de la densité d'un récit qui pourtant ne contient ni méchant, ni quête – sauf celle de la connaissance – , ni même de réelle aventure... Et pourtant, tout n'y est pas encore dévoilé : vous ai-je parlé des Vifs, de la Peste verte, de la chouette Athéna, du mystérieux jeu sans règles des Milles Chemins, du tissu dulcepiel... ? Non, le voyage sera encore riche en découvertes, d'autant plus agréable qu'il est porté par un style d'une grande lisibilité et que l'intelligence y côtoie habilement l'émotion. Vous ai-je convaincu de mon enthousiasme pour le premier roman de science-fiction jeunesse de Pauline Alphen ? Vous ai-je persuadé de passer outre la couverture ? Tant mieux : vous ne le regretterez pas. Espérons maintenant que l'autrice saura conserver une telle densité dans les suites à venir et qu'elle continuera à y éviter le « grand méchant » et les péripéties convenues qui alimentent mécaniquement bien trop de romans. Pascal PATOZ (lui écrire) |
| Dans la nooSFere : 87271 livres, 112144 photos de couvertures, 83707 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |