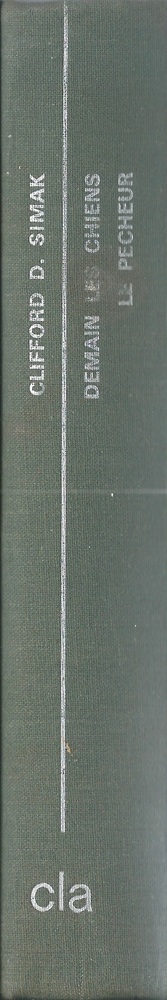|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Demain les chiens / Le Pêcheur
Clifford Donald SIMAK Traduction de Jean ROSENTHAL Illustrations intérieures de Joop VAN COUWELAAR OPTA (Paris, France), coll. Club du livre d'anticipation  n° 3 n° 3  Dépôt légal : 1er trimestre 1966, Achevé d'imprimer : 1 mars 1966 Première édition Recueil de romans, 428 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 20,2 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture cartonnée toilé, gauffrage à chaud argenté. Tirage limité à 4000 exemplaires numérotés de 1 à 4000 et à 150 exemplaires hors-commerce de collaborateurs marqués H.C. Pas de texte sur la quatrième de couverture.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Sam MOSKOWITZ, Introduction, pages V à XVII, introduction, trad. Jean ROSENTHAL 2 - Pierre VERSINS, Bibliographie française des œuvres de C. D. Simak, pages XIX à XXII, bibliographie 3 - Demain les chiens (City, 1952), pages 1 à 201, recueil de nouvelles, trad. Jean ROSENTHAL 4 - Note de l'éditeur (Editor's Preface, 1952), pages 3 à 5, préface, trad. Jean ROSENTHAL 5 - Notes sur le premier conte (Notes on the First Tale, 1952), pages 7 à 9, notes, trad. Jean ROSENTHAL 6 - La Cité (City, 1944), pages 10 à 34, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 7 - Notes sur le deuxième conte (Notes on the Second Tale, 1952), pages 35 à 36, notes, trad. Jean ROSENTHAL 8 - La Tanière (Huddling Place, 1944), pages 37 à 53, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 9 - Notes sur le troisième conte (Notes on the Third Tale, 1952), pages 55 à 56, notes, trad. Jean ROSENTHAL 10 - Le Recensement (Census, 1944), pages 57 à 82, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 11 - Notes sur le quatrième conte (Notes on the Fourth Tale, 1952), pages 83 à 83, notes, trad. Jean ROSENTHAL 12 - Les Déserteurs (Desertion, 1944), pages 84 à 95, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 13 - Notes sur le cinquième conte (Notes on the Fifth Tale, 1952), pages 97 à 98, notes, trad. Jean ROSENTHAL 14 - Le Paradis (Paradise, 1946), pages 99 à 118, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 15 - Notes sur le sixième conte (Notes on the Sixth Tale, 1952), pages 119 à 119, notes, trad. Jean ROSENTHAL 16 - Les Passe-temps (Hobbies, 1946), pages 120 à 149, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 17 - Notes sur le septième conte (Notes on the Seventh Tale, 1952), pages 151 à 152, notes, trad. Jean ROSENTHAL 18 - Esope (Aesop, 1947), pages 153 à 179, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 19 - Notes sur le huitième conte (Notes on the Eighth Tale, 1952), pages 181 à 181, notes, trad. Jean ROSENTHAL 20 - Un moyen bien simple (The Simple Way, 1951), pages 182 à 201, nouvelle, trad. Jean ROSENTHAL 21 - Le Pêcheur (Time is the Simplest Thing / The Fisherman, 1961), pages 207 à 395, roman, trad. Jean ROSENTHAL
Critiques
Jusqu’à présent Fiction n’avait guère ouvert au Club au Livre d’Anticipation que ses pages publicitaires. Je suis sûr que beaucoup de lecteurs les ont lues et qu’aucun parmi les aficionados n’aura manqué d’apprécier à sa juste valeur une nouvelle de la taille de celle que représente la réédition de Demain les chiens. Mais il ne faut pas penser qu’aux vieux durs à cuire. Ceux-ci d’ailleurs ont déjà presque tous ce livre dans leur bibliothèque, et le volume du C. L. A. ne saurait les intéresser que par le deuxième roman (inédit) qu’il contient. C’est aux autres surtout que cet article s’adresse, à ceux qui ont commencé d’aimer la science-fiction, mais n’ont pas encore vécu cette expérience capitale dans la vie de tout amateur : la lecture de Demain les chiens. Clifford D. Simak est un auteur bien connu dans notre domaine. Il est souvent apparu dans les pages de Fiction, plus souvent encore dans les pages de Galaxie (ancienne et nouvelle formule). Mais ceux qui ne l’appréhendent qu’à travers cette dernière revue risquent fort de se le représenter comme une sorte de Sheckley adjoint et de méconnaître la place à part qu’il occupe dans le Panthéon de la S. F. Pourtant il est le seul auteur qui ait reçu deux fois dans sa vie le Hugo, qui est en quelque sorte l’Oscar de la S. F. (Bradbury s’est sans doute vu décerner plus d’honneurs, mais pas par les amateurs de S. F.). C’est précisément pour Demain les chiens qu’il reçut son premier Hugo en 1952 ; l’ouvrage fut traduit en français la même année (coup de chance insigne, que bien peu de livres de S. F. ont partagé). Sa dernière édition dans notre pays date de 1954, et il est clair qu’une réédition s’imposait. Elle a été conçue par le C. L. A. à l’intention des spécialistes, avec une introduction de Sam Moskowitz (le plus grand historien vivant de la S. F., dont il faudra bien se résigner à traduire un jour les admirables textes) et une bibliographie de Pierre Versins (qui est sans aucun doute, pour sa part, le plus grand chartiste vivant). Mais les amateurs vont d’abord au texte, et ne se demandent qu’ensuite (et pas toujours) si l’édition est soignée ou non. Au fond, ils ont bien raison ; jamais un commentaire, aussi bon soit-il, ne remplacera un véritable texte, même mauvais. Quelquefois même le texte contient lui-même son propre commentaire, et c’est précisément le cas Ici. Dans Demain les chiens, Simak raconte la fin de l’espèce humaine et son remplacement par une espèce de chiens mutants. Les chiens en question ne sont pas des monstres venus d’ailleurs : leurs mutations sont l’œuvre des hommes, et l’édification de leur culture est l’œuvre du robot Jenkins, qui est lui-même de fabrication humaine. C’est donc l’homme avant tout qui est en cause, et l’homme envisagé sous l’angle moral. Quelles sont ses fins ? Quelles sont ses tendances profondes ? Quelle est la justification de sa présence dans l’univers ? On voit qu’il s’agit d’un problème grave, et la solution que lui donne Simak n’est pas gaie – du point de vue de l’homme en tout cas, puisque celui-ci est condamné à disparaître ; mais les chiens et leurs alliés orienteront toute leur culture dans le sens du progrès moral cher à Simak. Cependant, il n’est pas facile à un homme de se résoudre à renier sa propre espèce, et l’ouvrage porte de multiples traces des conflits intérieurs vécus par Simak. Il se compose de huit nouvelles, dont la publication s’est échelonnée de 1944 à 1951 ; Simak a si bien vécu avec ce thème pendant sept années que certaines nouvelles comme Les déserteurs, à l’origine étrangère au cycle, ont fini par s’y trouver intégrées indirectement par une allusion dans une nouvelle postérieure, comme dans Balzac. Mais la plupart des huit récits sont très voisins par la structure, comme si l’auteur s’était beaucoup battu avec son problème avant de parvenir à le résoudre. Il n’y a, dans Demain les chiens, pas moins de quatre fins de l’humanité, celle-ci jouant pratiquement dans l’histoire le rôle du monstre à exorciser : le départ pour Jupiter, la mise en animation suspendue des habitants de Genève, l’expulsion des hommes sauvages dans l’univers des horlas, l’évacuation de la Terre et l’abandon des hommes endormis dans la cité perdue de Genève. On ne compte plus les espèces qui, à un moment eu à un autre, se voient offrir une chance de succéder à l’homme (chiens, robots, mutants, robots sauvages, horlas, fourmis…) ni les chances qui sont offertes à l’homme lui-même, et que celui-ci manque de toutes les façons possibles. L’ensemble de l’histoire dure plus de onze mille ans. Pourtant Simak réussit à sauvegarder l’unité de son livre à travers ce foisonnement. Après tout, sa lenteur n’est qu’une conséquence des constants efforts qu’il fait pour se récupérer lui-même. Et le cycle est ponctué par un certain nombre de permanences : celle de la famille Webster, dont la généalogie, de John à Jérôme, de Thomas à Bruce, de Tyler à Jon et peut-être de Tom à Peter, rythme l’histoire de l’espèce humaine jusqu’à son ultime désagrégation ; celle du domaine fondé sur les ruines de la ville Initiale, véritable colline inspirée où les Webster, puis les chiens, cherchent à tâtons l’issue du grand drame cosmique ; celle du robot Jenkins enfin, fabriqué au XXIe siècle et qui vit encore au-delà du CXe siècle, après avoir assumé bien malgré lui, la lourde tâche de diriger et de conseiller les chiens. Tant de patience finit par l’emporter : à la fin de sa trajectoire, Simak a presque oublié l’humanité qui n’est plus pour les chiens qu’un mythe sans consistance. Il rédige, pour la publication en volume, des notices littéraires précédant chaque texte et dues à des chiens érudits, des centaines de siècles après la fin de l’histoire. Ce procédé, qui donne à tout le cycle un petit parfum borgesien, modifie l’éclairage de l’histoire en fonction de l’humeur finale de Simak : satisfaction d’avoir mené à bien une lourde tâche et aussi, tout de même, impression d’avoir dit quelque chose d’important. La formule du C. L. A. repose sur la publication groupée de plusieurs œuvres d’un même auteur. Avec Simak, les animateurs de la collection n’avaient que l’embarras du choix. Peut-être n’aurait-il pas été inutile de retraduire Time and again, si malmené dans l’ancien Galaxie et au Rayon Fantastique. Ils ont préféré pourtant – et à juste titre – publier du neuf. Simak a beaucoup produit depuis une quinzaine d’années, non sans se répéter à l’occasion, comme tant d’autres gloires de la vieille garde. Pourtant il est normal qu’une inspiration tournée vers la tradition et la sagesse, comme l’a toujours été la sienne, s’épanouisse dans l’âge mûr. Le dernier des grands bilans de son expérience et de son destin, Simak l’a confié en 1961 à la revue Analog sous le titre The Fisherman, avant de le publier en librairie sous le titre Time is the simplest thing. C’est ce roman qui figure dans le volume du C. L. A. sous le titre Le Pêcheur. Ce livre met en scène une humanité future qui n’a pu atteindre les étoiles et qui s’est peu à peu résignée, repliée, sur elle-même et fermée aux innovations. Sur la Terre en décadence, un seul ferment de progrès : la propulsion instantanée des esprits, qui permet à certains mutants de visiter mentalement d’innombrables planètes et d’en ramener des nouveautés utiles aux hommes. Mais l’institution qui a organisé ces voyages, et qui a fort justement été appelés « l’Hameçon –, s’est constituée en un vaste monopole et s’est à son tour refermés sur elle-même. L’initiative et l’aptitude au progrès ont lentement disparu l’humanité glisse lentement vers un état de médiocrité parfaite. Une seule porte reste ouverte : celle que franchissent quotidiennement les « pêcheurs » délégués par l’Hameçon sur de lointaines planètes. Et l’un d’eux fait un jour, dans les astres, une rencontre qui modifiera radicalement l’avenir. La richesse des thèmes du Pêcheur n’est comparable qu’à celle des autres grands livres de Simak, Demain les chiens et Time and again. Il n’y a guère de thème de science-fiction qui ne s’y trouve abordé et exploité avec une habileté consommée. Le plus brillamment renouvelé est peut-être celui du temps déjà richement représenté pourtant dans l’œuvre de Simak. Le temps est la chose la plus simple, comme le dit le titre de l’édition américaine en volume (qui aurait bien dû être repris ici, soit dit en passant) l’humanité ici vit au présent et disparaît lorsqu’on se décale dans le temps. Le héros de l’histoire en remontant dans le passé ne retrouve pas l’univers tel qu’il l’a quitté ; il ne trouve que la nature sans hommes et sans traces de leur activité Lorsqu’il voyage dans l’avenir, le résultat est bien plus remarquable encore : les choses elles-mêmes ont disparu, st il se retrouve en plein néant, ce qui après tout rend mieux compte de la nature véritable du temps que la plupart des théories imaginées par les écrivains de S. F. Il semble qu’avec les années le contraste s’avive encore entre le penchant de Simak pour les intrigues compliquées et la simplicité volontaire de sa vision morale du monde ; ou, si l’on préfère, entre son côté van Vogt et son côté Virgile. Tous ses romans sont des tentatives pour percer le secret de cette inspiration multiple et la ramener à l’unité. Le Pêcheur ne fait pas exception ; peut-être même nous donne-t-il des éléments de réponse plus clairs que tous les livres précédents. L’univers bucolique de Simak est empreint d’une telle paix, d’une telle douceur, d’un tel équilibre qu’on se demande par quel miracle il peut y échapper de temps en temps. La réponse est simple pourtant ; elle est la même pour Simak et pour tous les autres grands bucoliques de la littérature, de Théocrite à Rousseau. Cet univers n’est pas premier ; il a été construit comme un refuge pour échapper à un autre univers, insupportable celui-là. Ce qui perturbe tout, c’est que l’inspiration paysanne de Simak correspond à un mythe bien enraciné dans la tradition américaine, et qu’elle apparaît à l’auteur comme au lecteur sous des dehors concrets qui masquent son origine compensatoire. Mais dans Le Pêcheur, Simak nous livre des cauchemars qui ont certainement préexisté à son Arcadie et qui l’équilibrent dans le roman : au pêcheur bénéfique, Shepherd Blaine correspond le pêcheur malfaisant, Lambert Finn Blaine lui-même, par la grâce d’une pêche par trop miraculeuse, puise dans sa propre mémoire les souvenirs d’un être non-humain : « La vision devint plus brillante et plus nette, comme si, dans son cerveau, un observateur invisible réglait les lentilles du projecteur cérébral. Il distinguait à présent, avec une remarquable netteté de détails, la route immonde qui grouillait dans cette jungle chaotique. C’était un spectacle ignoble, écœurant, un enchevêtrement de monstres rampants, de pattes visqueuses, d’antennes et de mandibules – une férocité froide, une lutte aveugle et sans merci qui n’avait d’autre mobile qu’une faim dévorante, un appétit jamais rassasié. « Blaine se sentait glacé d’horreur, car la vision avait une réalité, une matérialité qui lui donnaient le sentiment d’être un acteur du drame, une partie de lui-même se trouvant étendue devant cette cheminée, tandis que l’autre se traînait au cœur de cette jungle de cauchemar. » Il est clair que Simak est personnellement engagé par cette description, non seulement par l’horreur de la vision elle-même, mais surtout par la notation finale – qui montre que le narrateur n’est pas un simple témoin. Si par hasard la jungle ici décrite était la société américaine actuelle, il deviendrait évident que l’auteur s’y sent plus ou moins engagé en dépit de ses efforts d’évasion ; toute son œuvre alors ne serait qu’un effort pour résoudre le dilemme. Où cet effort a-t-il mené Simak, au bout de sa carrière d’écrivain ? On en mesurera le succès à un détail : à la fin du Pêcheur, Blaine invite l’humanité à évacuer la Terre. Après tout, cela vaut mieux que d’éliminer l’espèce humaine. Jacques GOIMARD
Prix obtenus par des textes au sommaire
|
| Dans la nooSFere : 87271 livres, 112158 photos de couvertures, 83707 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |