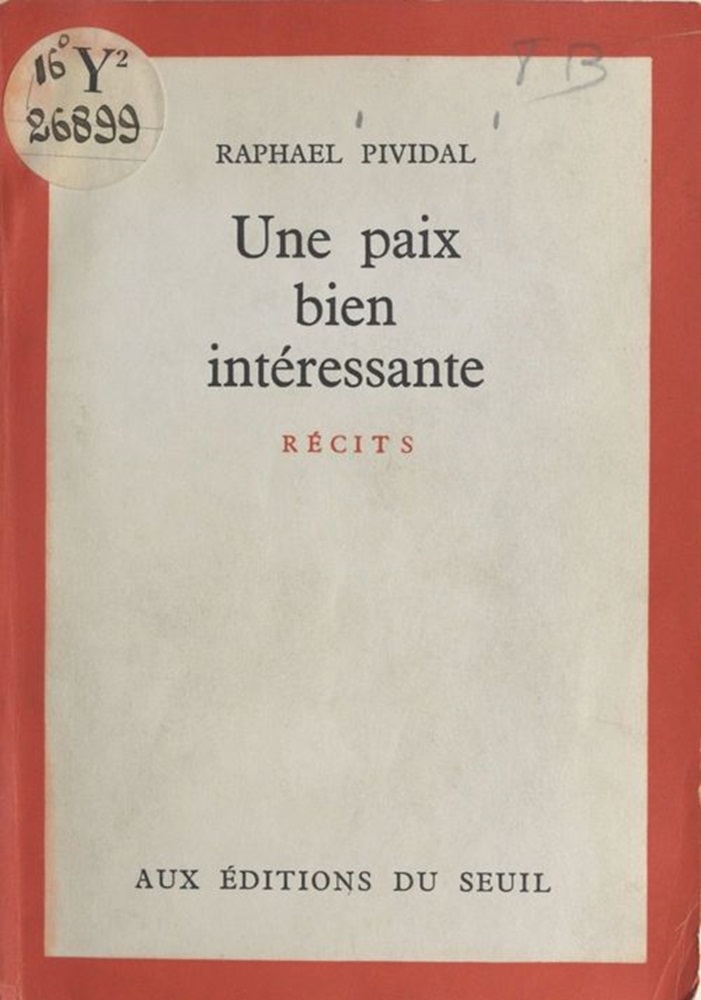|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Une paix bien intéressante
Rafaël PIVIDAL SEUIL (Paris, France) Dépôt légal : 1963 Première édition Roman, 124 pages, catégorie / prix : nd❌ Genre : Fantastique
Quatrième de couverture
« Une paix bien intéressante » offre une série de quatre récits qui s'efforcent de décrire à travers plusieurs tableaux : une ville ultra-moderne que survolent sans fin des avions, une lagune abandonnée, une vallée froide et ombreuse, une maison figée où se tient, comme un bouddha, un père. C'est ainsi la situation d'un monde de l'après-guerre qui nous est donnée. Époque où l'histoire semble arrêtée et incapable d'inventer de nouvelles métaphores. Le thème principal est, en effet, cet arrêt de l'histoire ainsi que la niaiserie des situations psychologiques qui sont le refuge de l'individualisme moderne. Ces tableaux se présentent sous la forme de paysages cosmiques éclairés par un soleil moribond. Dans cette lumière déchirante les personnages essaient de se situer et de dépasser la condition biologique à laquelle la société les condamne. Nul symbolisme d'ailleurs n'est à chercher dans ces contes qui ne sont même pas pessimistes.
Critiques
Il n’y a qu’un adjectif pour définir le livre de Raphaël Pividal, et c’est celui de « désintéressé », au sens où Roger Vaillant l’employait dans son roman La loi. Cette paix et ce monde qui appartiennent peut-être tous deux à notre avenir – mais cela n’est pas dit – sont « bien intéressants » en ce sens qu’ils ne présentent plus d’intérêt pour personne. Ayant trop vu d’événements, les êtres se retirent de l’histoire et abandonnent jusqu’au souci de leur propre destin. Voilà le trait commun des quatre nouvelles qui composent ce recueil. Une paix bien intéressante naquit de la guerre, sans doute d’une grande guerre atomique. Tout se reconstruit, dans la technique. Mais quelque chose a été si profondément entamé, un ressort si totalement assoupli, que la raison manque. L’univers, en quelque sorte, est dépersonnalisé. « La guerre avait tué dans l’œuf ce goût malsain des histoires. » Et même les cheminées ou les canons qui pointent vers le ciel, et les avions qui passent en vagues lourdes et continues, sont devenus des meubles, des habitudes. Les actes de la vie sont accomplis avec une lenteur rigoureuse. On dirait une photo ancienne où non seulement les gestes sont figés mais où de plus les occupations qu’ils servaient ont perdu tout sens. Et peut-être est-ce bien d’une photo qu’il s’agit, en effet, gravée sur le mur du temps ou dans la mémoire éternelle et fragile d’un condamné par la lumière atomique qui se lève à l’est. Peut-être cette paix est-elle un dernier rêve qui, monstrueusement dilaté dans la durée d’un clin d’œil, sert à toute une civilisation de clé pour un néant immuable. Le dimanche dans la vallée, c’est autre chose, car la guerre n’est nulle part quoiqu’elle soit tout aussi sûrement perdue. Cela pourrait se passer en Suisse où l’on a renoncé à en faire. C’est tout l’art du repos et, si j’ose dire, de la consommation dominicale. On va auprès du lac. Là, certains montent dans des bateaux, d’autres les regardent. Tous attendent, quoique, de notoriété secrète, rien ne puisse survenir. Le dimanche et la vallée sont des bateaux fantômes ou des moulages de cire. Tout est si parfaitement réglé qu’on a repeint les horizons. Il n’y a plus nulle part de désirs impossibles et, partant, plus de frustration poignante, perçante. « Apprendre à être malheureux. C’était surtout une question de don, un art spécial de regarder le ciel. S’habituer toujours. Laisser dormir son regard. » Ici, c’est le présent qui s’éternise, et il le fait dans le dimanche, parce que la succession des gestes nécessaires s’interrompt ; le repos, c’est, dans la vallée, une évacuation du temps. Au contraire, La lagune réintroduit le passé, sous la forme d’une statue engloutie, pour mieux le nier, car seule existe la dimension d’une image de pierre dont l’eau a lavé l’histoire. Ici encore, la relation s’établit entre des personnages en vacances (c’est-à-dire « entre ») dans la reconnaissance de l’absence d’événements. « Sur cette île, il n’y avait pas grand-chose à faire. J’attendais. Je savais que ça ne durerait pas quarante mille siècles. La nuit était tombée. Je ne voyais plus rien. » Quoique tout soit parfaitement clair, même la nuit, rien n’est plus intelligible parce que rien n’est plus découvert. Dans ce texte qui est entre les autres celui que je préfère, Pividal nie au fond la possibilité même de la poésie. Le rôle du poète, croyait-on jadis, est d’étonner. Indiscutable poète, Pividal professe que l’étonnement est devenu aujourd’hui impossible. Le monde s’est usé jusqu’à laisser voir la trame, et sous la peau fine jusqu’à la transparence, les rouages des robots se devinent. La solution réside sans doute dans le renoncement presque oriental du Père. Est-ce oriental ? Est-ce le nirvana que recherche le Bouddha ? Il se retire lui aussi, immobile, des choses. Et peut-être est-ce l’image de Dieu ou de l’homme, qui, ayant épuisé les questions du monde et usé les mots, s’en détache et entreprend de le défaire. Est-ce du fantastique ? La prose parfaite de Pividal suscite l’inquiétude. Surgi d’un autre temps, comme un étranger, l’auteur jette sur les choses la brève lumière d’un instantané photographique. Car là est son secret. Le temps s’est arrêté, le temps est venu mourir sur la plaque. Nul doute que le livre de l’étranger Pividal soit actuel, en ce qu’il traduit somme toute une civilisation de la répétition et donc de l’immédiat. Nous vivons par nécessité une civilisation du commun accord, où les règlements sont devenus destin et ont étouffé à la longue les cris individuels, où les éclats violents des individus nous paraissent appartenir irrévocablement au passé. Nos films décrivent pour notre curiosité inquiète cette espèce d’hommes qui se dressèrent seuls contre des léviathans sociaux, le rail, voire la route. La tombe du cow-boy est jonchée de pellicule, et ce sont les troupeaux du dimanche qui, sinon béats, du moins empreints de gentillesse maussade, s’en vont bâiller aux exploits du grand Maciste. Jadis on se fût battu au sang pour une aile de voiture froissée. Mais les chocs innombrables des galets humains ont arrondi les angles. Déjà la paix des individus s’est appesantie sur la terre. Il reste à faire celle des groupes sociaux, mais l’homme déjà, l’individu, est de l’autre côté de la guerre. Il est désintéressé. Il s’en va rôder le dimanche, sur les bords du lac, dans l’espoir inconsistant (et le sachant déçu) qu’à la fin il se passe quelque chose. Bref, il ne peut plus créer. Gérard KLEIN |
| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112209 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |