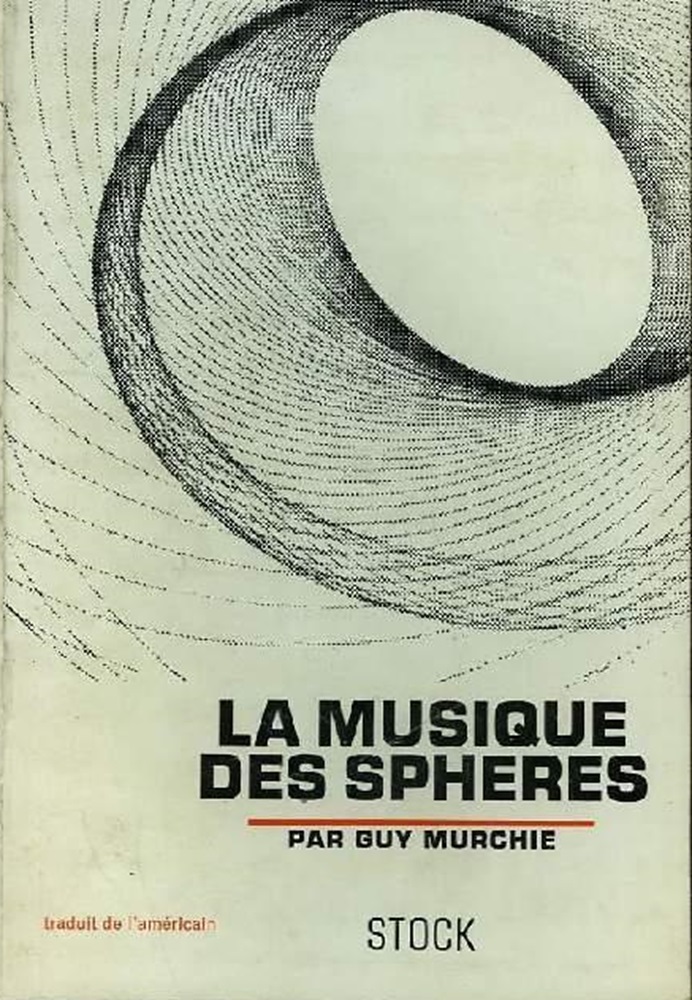|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Musique des sphères
Guy MURCHIE Titre original : Music of the spheres, 1961 Première parution : Boston, USA : Houghton Mifflin, 1961 ISFDB Traduction de Jean-Pierre HARRISON STOCK (Paris, France) Dépôt légal : 1963 Première édition Roman, 528 pages, catégorie / prix : 34,20 F ISBN : néant ❌
Critiques
On trouve ce gros volume – plus de 500 pages – avec appréhension. Son passe-partout de titre fait craindre le pire. Mais on est pleinement rassuré dès le premier chapitre : l’auteur n’affirme pas que Kepler a énoncé ses lois après avoir déchiffré un manuscrit martien, il ne prétend pas que le yoga est la meilleure façon d’aborder la théorie de la relativité, et il n’explique pas par la télépathie les découvertes de Newton. Guy Murchie est, en fait, un ancien pilote qui s’est intéressé aux récentes acquisitions scientifiques au point de se documenter méthodiquement sur elles. Il s’en est fait une sorte de synthèse, et s’est apparemment enthousiasmé pour ce qu’il apprenait ainsi, et a voulu faire partager sa joie à ses lecteurs : c’est ainsi qu’a été écrit ce livre, et l’impression d’ensemble qu’il produit est sympathique. L’ouvrage est divisé en deux parties. La première traite du cosmos. Après un départ laborieux et inutile – l’auteur se décrit dans un astronef, duquel il voit la terre – l’exposé se développe d’intéressante façon, présentant la lune, les planètes, les satellites et les autres astres mineurs du système solaire, pour aborder ensuite le soleil, les étoiles et les galaxies. Il est certain que la lecture de ce livre ne suffit pas pour donner au lecteur une vue complète de chacun de ces sujets ; mais Guy Murchie peut préciser certaines idées, compléter ici ou là une représentation incomplète, et surtout rattacher des notions nouvelles à des éléments déjà connus du lecteur. Ce dernier point est apparent dans le premier chapitre de la seconde partie. En parlant de La matière première des mondes, l’auteur évoque l’édifice moléculaire des corps et donne au passage quelques notions de cristallographie qui apporteront du nouveau à tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’étudier cette science dans une université. La suite de la seconde partie a pour sujets la structure de l’atome, les mouvements ondulatoires, la lumière et le son, pour arriver enfin à la théorie de la relativité et au continuum espace-temps. Au nombre des auteurs que Guy Murchie remercie de l’aide qu’ils lui ont apportée, on remarque Willy Ley et Isaac Asimov : le présent travail n’est pas indigne de celui de ces grands vulgarisateurs. Si Murchie n’a pas l’étendue des connaissances et la sûreté dans l’exposé qui caractérisent Ley et Asimov, il a en revanche reçu ce don de l’enthousiasme qui permet d’établir le contact avec le lecteur. Il fallait d’ailleurs l’avoir, cet enthousiasme, pour se lancer dans un projet si ambitieux. Guy Murchie a illustré lui-même son texte, et on ne peut pas dire que sa réussite soit totale de ce côté. Les meilleurs de ses dessins sont ceux qui s’inspirent de photographies, mais les petites caricatures qui transposent en termes familiers la réalité complexe (électrons sur les gradins d’un amphithéâtre qui serait l’atome, etc), n’apportent pas grand-chose à la clarté de l’exposé. Une autre réserve qui s’impose a trait à la traduction. Celle-ci conserve, bien inutilement, le cachet anglo-saxon de l’original. On peut passer sur l’emploi du titre de docteur à propos de savants qui ne sont pas docteurs en médecine, bien que cet emploi ne soit pas correct en français. Mais on regrettera que les pénibles unités de mesure anglo-saxonnes n’aient pas toujours été converties en valeurs du système métrique : en particulier dans le tableau des satellites donné aux pages 64 et 65. À propos de satellites, on remarquera que Guy Murchie propose des noms pour celles des lunes de Jupiter qui n’en ont pas, mais qu’il semble ignorer que le nom d’Amalthée, dû à Camille Flammarion, est généralement adopté pour l’un de ces astres (celui qui porte le numéro V, par l’ordre de sa découverte, mais qui est en fait le plus proche de Jupiter). Au total, ce livre représente une réussite très honorable dans la réalisation d’un projet ambitieux par son envergure. Demètre IOAKIMIDIS |
| Dans la nooSFere : 87273 livres, 112165 photos de couvertures, 83709 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |