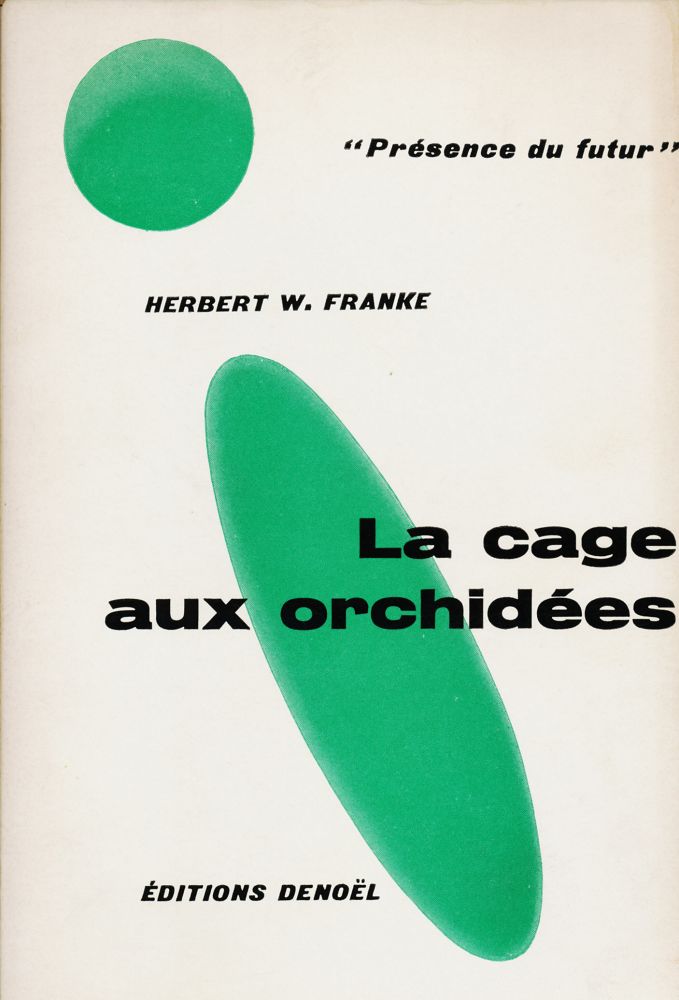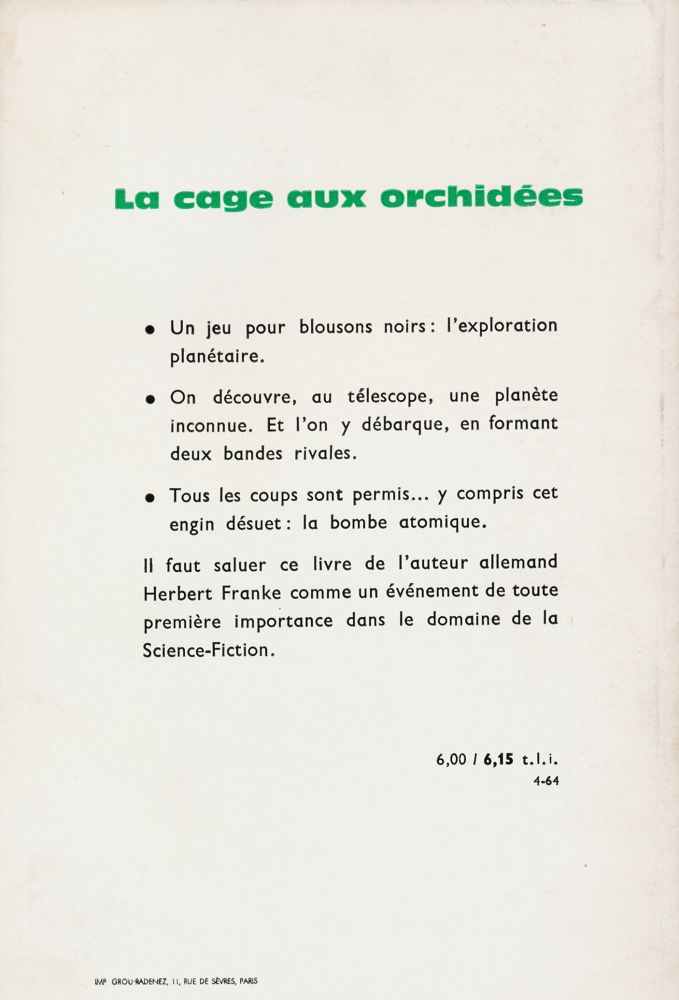|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Cage aux orchidées
Herbert W. FRANKE Titre original : Der Orchideenkäfig, 1961 ISFDB Traduction de Jean-Michel DERAMAT DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur n° 73  Dépôt légal : 1er trimestre 1964, Achevé d'imprimer : 13 mars 1964 Première édition Roman, 232 pages, catégorie / prix : 6,15 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
• Un jeu pour blousons noirs : l'exploration planétaire.
• On découvre, au télescope, une planète inconnue. Et l'on y débarque, en formant deux bandes rivales.
• Tous les coups sont permis... y compris cet engin désuet : la bombe atomique.
Il faut saluer ce livre de l'auteur allemand Herbert Franke comme un événement de toute première importance dans le domaine de la Science-Fiction.
Critiques
Deux groupes, sur une planète inconnue, se disputent une ville, ou plutôt le secret d’une ville. Deux garçons et une fille progressent vers le centre de cette ville énigmatique, avec des allures de voyous. Ils brûlent de l’enthousiasme de la découverte et, en même temps, de l’excitation du jeu. Car ils luttent contre l’autre équipe. Leur quête n’a rien de scientifique. Ce qu’ils cherchent, c’est à connaître, avant les autres, le visage, l’apparence des êtres disparus qui peuplèrent la planète et construisirent la ville ; c’est, au fond, à atteindre la dernière case de ce singulier jeu de l’oie. Tous les coups sont permis. Même les coups bas. La mort est la rançon de l’imprudence. Une mort temporaire, toutefois, même si elle ne renie rien de la souffrance et de l’angoisse ! À peine le premier essai a-t-il sombré dans la destruction que le second commence. Nos héros immortels s’affrontent comme des enfants sur un terrain de jeu ; mais avec des armes un peu plus sérieuses qu’une chaîne de vélo. Ils se traquent dans la ville déserte, s’exécutent, recommencent, attentifs à démêler le sens du labyrinthe entre deux combats. Leurs loyautés sont changeantes, leurs passions instantanées. Leurs vies sont les foulards qui s’échappent des ceintures de grands jeux. Tout est irréel. La ville n’est qu’une occasion de faire semblant d’être, d’avoir peur, de souffrir. Voilà pour le premier thème : des blousons noirs se disputant le trésor de l’inconnu, non pour le posséder, mais pour le ravir. Des gamins éventrant un cheval de bois, une poupée pour découvrir ce qu’ils contiennent, et s’arrachant les morceaux. Des jeux stériles et somme toute impitoyables. Le second thème concerne la ville elle-même. Car ils pénètrent en elle, d’abord poussés dans l’aventure par le souci de triompher, puis évoluent lentement vers la recherche du secret. Et la ville se défend bien, à force d’illusions. Ses habitants semblent l’avoir abandonnée, sous le couvert de défenses efficaces, pour de bon, sans même laisser derrière eux le signe de ce qu’ils furent. Convertie en luna-park, la ville oubliée accueille ses nouveaux parasites. Elle est morte au dehors et ses murailles comme ses demeures s’effondrent sous la caresse du temps et sous l’impact des météores. Mais elle vibre encore, à l’intérieur, d’une vie mécanique, génératrice de rêves. Car la progression de nos héros vers le cœur de la ville est aussi une démarche vers une illusion toujours plus perfectionnée. Un point pressé dans la muraille, et des scènes immuablement recommencées surgissent d’un passé inappréciable. Est-ce vers le rêve, dans la profondeur centrale de la ville, que se sont évadés ses habitants ? Troisième thème. Si nos héros risquent leur vie, s’ils se massacrent avec générosité, s’ils ne reculent pas, pour fracturer les serrures de la ville, devant des expédients aussi considérables qu’une bombe atomique, c’est qu’ils ne risquent rien et qu’ils agissent en somme par procuration. Leurs corps sont à l’abri sur une planète lointaine, la Terre, et ce sont des marionnettes à leur image qu’ils manipulent au milieu des dangers. D’où le Jeu. La ville tout entière est devenue un billard électrique géant. Rien n’est interdit parce qu’on n’est pas, physiquement, présent. Et lorsque nos héros, saisis à la fin par la curiosité au point de conclure des alliances, percent enfin le secret de la ville, c’est pour découvrir que ses habitants ont le visage de leur propre avenir, qu’ayant été au bout de l’illusion que dispensent sans effort, dans l’immobilité, des machines protectrices, ils ont renoncé tout à fait à la vie, et baignent dans l’inaccessible nirvana biologique. Réduits à un état larvaire, ils sommeillent dans des cryptes. L’explosion déclenchée par les humains pour tenter d’atteindre le cœur de la cité en a tué quelques-uns ; et c’est l’occasion d’un étrange procès où deux de nos héros humains s’entendent condamner à une mort que nul, sur ce monde, ne peut leur infliger. Réveillé par l’accident, toutefois, l’un d’eux s’arrachera à l’illusion du jeu et s’avancera, titubant, vers la réalité, si faible que ses chances de l’atteindre, et plus encore de la vaincre, apparaissent négligeables. Le sujet de ce livre est donc l’aliénation. C’est un sujet aujourd’hui commun, et plus particulièrement peut-être dans la littérature allemande, que cette aliénation infligée à l’homme par la machine et par la civilisation, qui l’extraient toutes deux de la nature. En cela, le livre de Herbert W. Franke, qui s’enfonce dans le pessimisme en concluant à la quasi impossibilité pour une espèce intelligente d’échapper au mirage, n’est pas d’une originalité remarquable. Il a toutefois le mérite de nous présenter deux stades de l’aliénation qui sont au-delà du nôtre. Dans le premier, celui des humains, quoique le contact du réel ne soit plus immédiat, la communication demeure possible et, avec elle, le refus et la conscience. Les équipes luttent l’une contre l’autre, même si c’est dans le cadre d’un jeu. Dans le second, au contraire, le rêve est devenu le mur étanche qui circonscrit d’irréversibles solitudes. L’homme – car c’était bien d’hommes qu’il s’agissait – a accompli son orbe. Rejeté au début des temps, ou, du moins, de son temps, de la nature inconsciente, incapable à la fois d’assumer cet exil et de résoudre cette contradiction, il s’est échappé avec un succès croissant dans l’irréalité par les truchements successifs du langage et de la machine. Ne pouvant supporter d’être exclu de l’univers extérieur, il s’est réfugié dans l’autre, l’interne, au point de succomber tout à fait à l’éternelle tentation du solipsisme. Soucieux de réduire les conflits et résultant lui-même d’innombrables conflits, il se nie et s’achève en atteignant son but. Il sort alors de l’Histoire, non pour atteindre un monde de plus, grande réalité, mais de moindre connaissance. Devenu aveugle et sourd, insensible, protégé, il cesse même de rêver, et retourne à l’obscure et fragile rumination du protoplasme. Soucieux d’abolir toute agression, il s’enferme lui-même dans une cage indestructible, la cage aux orchidées. Ce procès que Herbert W. Franke intente à l’homme par la voix impassible des machines est, on le voit, à la fois de nature métaphysique et de signification sociale. D’un côté, il condamne presque irrémédiablement ce qui est jeu en nous, c’est-à-dire aussi création, mystère, invention et rêve, qui nous détournent avec une louche sollicitude à la fois du monde et des autres. De l’autre, il s’attaque au temps présent et rejette cette épaisseur technique qui nous écarte du réel. Ces engins, ces illusions parfaites sont nos voitures et nos films qui contiennent certes les germes de tous les solipsismes. Le spectacle est une procuration, et déjà l’effet de ces interpositions se fait sentir : la violence est tolérée mieux et plus que jamais (tolérée et non subie), parce qu’elle est contemplée plus souvent qu’elle n’est ressentie ; il y a dans la conduite automobile une redoutable irréalité qui débouche quelquefois sur l’interruption d’un destin. La ligne de démarcation entre le rêve et la réalité oscille au point que le rêve s’empare parfois entièrement de l’être, tandis que le réel ne lui laisse plus qu’un goût de cendres insupportable. Au demeurant, notre réalité quotidienne ne peut lutter à armes égales avec l’imaginaire, parce que l’écran même dont l’homme social s’entoure pour mieux se protéger contre l’incertitude du temps neutralise pour lui le sel des choses. Si la dureté des circonstances de la vie aliène, leur morne douceur aliène tout autant. Les blousons noirs ne sont que d’éternels guerriers, oubliés d’un combat qui se mène sans eux, ailleurs ou avant eux, et auquel ils n’ont eu et n’auront pas de part. Puisque la réalité leur refuse un défi à la dimension de l’énergie humaine, il leur faut en trouver un dans l’inutile. En bref, l’homme cherche à surmonter les malédictions des dieux, mais, y étant parvenu, il se perd faute d’adversaires. Les décadences, selon l’évangile de Franke, résultent, pour une société ou pour un homme, de la satisfaction de leurs propos. Un homme qui accomplit son destin meurt. Une société s’immortalise dans l’absence, ou disparaît. Roman désespéré, au fond, malgré la ligne d’horizon qu’il dévoile à la fin, le livre de Franke est sans doute profondément imprégné de la situation de l’Allemagne contemporaine, c’est-à-dire de celle d’une société sans idéal, ou plutôt sans défi autre que celui de vieux revenants, d’une société écrasée par la sécurité. En quoi il intéresse et inquiète, car il témoigne d’une crise morale si grave et si profonde qu’on ne lui voit d’issue que dans la quête d’on ne sait quel mystère et l’irruption d’on ne sait quel délire absurde et brutal. La bourgeoise Allemagne est proche des blousons noirs en ce qu’elle ne se conçoit pas d’autre avenir que celui de la vacance. Et c’est ce mal, si l’on ne vient combler ce loisir, qui s’étend aujourd’hui à la vitesse de la gangrène dans une chair trop saine, mais tuméfiée. Nul n’en est exempt. La forme du livre de Franke sert convenablement son propos, sans plus. L’exposition adroite cerne bien un mystère que j’ai malheureusement peut-être défloré. Et le soin minutieux, systématique avec lequel l’auteur décrit sa ville aurait quelque chose de fascinant si la traduction ne l’avait sans doute aucun défigurée. J’ai tenté en vain de me retrouver dans ce labyrinthe que Franke a pourtant voulu précis. On l’a trahi. La carte est fausse et, quoique derrière elle, on puisse discerner encore les ombres du paysage, c’est dommage. Il faut déplorer que la première œuvre allemande accueillie dans cette collection ait été de la sorte maltraitée avec une application toute scolaire. Gérard KLEIN |
| Dans la nooSFere : 87273 livres, 112165 photos de couvertures, 83709 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |