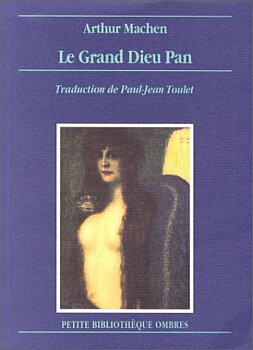|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Grand Dieu Pan
Arthur MACHEN Titre original : The Great God Pan, 1894 Première parution : The Whirlwind, 1890, complétée et corrigée dans "The Great God Pan and The Inmost Light", Angleterre, Londres : John Lane, et États-Unis, Boston (Massachusetts) : Roberts Brothers, 1894 ISFDB Traduction de Paul-Jean TOULET OMBRES , coll. Petite bibliothèque Ombres  n° 21 n° 21  Dépôt légal : janvier 1993 Novella, 128 pages, catégorie / prix : 54 FF ISBN : 2-905964-79-0 ❌ Genre : Fantastique
Autres éditions
in Le Grand Dieu Pan, CALLIDOR, 2023 ÉMILE-PAUL FRÈRES, 1938, 1963 LIBRIO, 1995 LIVRE DE POCHE, 1977 LUMPEN, 2021 in Le Cycle de Dunwich, ORIFLAM, 1999 Pierre-Guillaume DE ROUX, 2015 in Le Grand Dieu Pan suivi de Les trois imposteurs, RBA, 2022 in La Lumière intérieure précédé par Le Grand Dieu Pan, TERRE DE BRUME, 2003 Le VISAGE VERT, 1985
Quatrième de couverture
« Dans toutes ses oeuvres, nouvelles ou romans, les éléments d'horreur sournoise et de frayeur progressive atteignent un degré pratiquement incomparable dans la tension, l'épaisseur, l'acuité réaliste. » H. P. Lovecraft « Arthur Machen peut parfois nous proposer des fables incroyables mais nous sentons qu'elles ont été inspirées par une émotion véritable. Il n'a presque jamais écrit pour étonner autrui ; il l'a fait parce qu'il se savait habitant un monde étrange. » Jorge Luis Borges Critiques des autres éditions ou de la série
« Parmi les créateurs (…) de la terreur cosmique élevée à son plus haut degré artistique, bien peu, s’il s’en trouve, peuvent espérer égaler le versatile Arthur Machen, auteur d’une douzaine de récits (…) où les éléments de l’horreur secrète et la terreur couvante atteignent une acuité réaliste et une qualité quasi incomparable. » En écrivant ces lignes, Lovecraft saluait son maître. Il a beaucoup emprunté à Machen, à commencer par l’idée du culte secret et innommable, aux multiples adeptes s’ignorant mutuellement, et aussi ces « récapitulations », ces instants où la forme humaine vacille, se perd et descend vers les manifestations les plus primitives de la vie : « Cette face noircie, cette forme transformée sur le lit, fondant et passant à vos yeux de la femme à l’homme, de l’homme à la bête, et de la bête à pis que la bête. » (p. 205) Chez le maître, comme chez le disciple, l’inquiétude naît d’une suspension, ou d’une défaite, des lois fixées par la nature ; c’est l’assaut du chaos, des démons de l’espace insondable, l’approche d’êtres intelligents vivant sur un autre plan. Mais si le disciple l’emporte par l’ampleur des visions, la cohérence de son effrayante mythologie, enserrant la Terre d’un réseau d’entités redoutables, son maître l’écrase sur le plan purement littéraire. D’abord, Machen avoue ouvertement ses préoccupations métaphysiques, n’essaye pas de les voiler d’un matérialisme de parade ; ce qui l’occupe, c’est le Mal, son cheminement dans les âmes et les esprits. À l’horreur physique, au dégoût né des caricatures humaines, il oppose une inquiétude purement spirituelle, car les drames qu’il évoque, bien que plus étroits, plus feutrés, nous concernent tous. Et prennent bien plus de résonances en 1964 qu’en 1894 à la sortie de l’ouvrage. Son but est de montrer comment, chez certains, l’homme meurt dans l’intelligence, et laisse à sa place l’éveil des instincts de la brute. Et surtout, Machen manie en maître l’art de la suggestion. Il sait combien il est nécessaire de laisser le lecteur prolonger l’horreur, compléter ce qui se devine au reflet surpris sur un visage, à travers une phrase inachevée. Lovecraft, plus naïf, nous dévoile ses monstres, les braque en pleine lumière, en décrit les lignes nettes, et par ce réalisme dépouille de leur aura maléfique ceux qui « murmuraient dans les ténèbres ». Dans Le grand dieu Pan, les créatures venues des profondeurs insondables de l’espace et du temps cosmiques sont toujours présentes, mais voilées, tapies dans l’ombre. Pas une seule fois Hélène Vaughan nous est présentée objectivement, nous ne la devinons qu’à travers de multiples récits, par le reflet qu’elle laisse sur un visage, par tous ceux qu’elle a approchés et dont elle a dévié, tordu, empoisonné l’esprit. Procédé dont Borges, grand lecteur de Machen, se souviendra quand il écrira L’approche du caché, qui n’est qu’un Dieu Pan inversé. Hélène Vaughan est l’incarnation humaine du mal, et ceux qu’elle entraîne à sa suite ne furent point frappés au hasard. Tous furent attirés, fascinés, envoûtés par ce qu’ils devinèrent en la voyant, et vont se pencher sur le gouffre lucidement, les yeux ouverts, aspirant à le fuir et à s’y perdre. D’où, de quelle présence est-il question, pour qu’ainsi une présence, une parole, un regard, suffisent à étouffer la raison et réveiller les instincts les plus vils ? Cette présence est celle du Grand Pan, évoqué dès les premières lignes, mais sans l’appareil du fantastique classique ou moderne. Machen joue pleinement le jeu du rationalisme, au moins d’apparence. À peine si, de loin en loin, au travers des divers récits, nous devinons l’intrusion d’une entité ; tout se joue dans le mystère des âmes. Le point de départ est des plus positifs. Pour le docteur Raymond, nous vivons dans le monde des apparences, le monde sensible se trouve au-delà, mais nos sens infirmes nous rendent inaptes à l’appréhender ; à peine si quelques-uns peuvent en deviner l’existence. Pour forcer cette barrière, sonder ce qui se trouve derrière le voile, il n’est nul besoin de magie ; l’homme n’utilise pas pleinement les possibilités de son cerveau, il en laisse en friche la presque totalité. Aussi les évocations au centre de pentacles et de fumigations enivrantes seront remplacées par le billard du chirurgien. Une petite incision cervicale et cette jeune femme pourra contempler le réel. Elle en devient folle, car elle découvre le visage de la grande puissance cosmique, l’image de la nature purement matérielle et bestiale. Et sa fille Hélène participera de ce reflet, jusqu’au moment où, sa forme humaine disparaissant, le Grand Pan apparaîtra aux yeux d’un des narrateurs. Avant Borges, Bromfield se souviendra de cette trame dans Miss Annie Spragg… Borges, Bromfield, Lovecraft, tous trois ont plus ou moins ressenti l’influence de cet auteur quasi-inconnu en France, car, bien que Le grand dieu Pan soit sorti voici près de 40 ans, nul éditeur ne s’est intéressé au reste de cette œuvre étrange. Jacques VAN HERP Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Patrick Marcel : Atlas des brumes et des ombres (liste parue en 2002) |
| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |