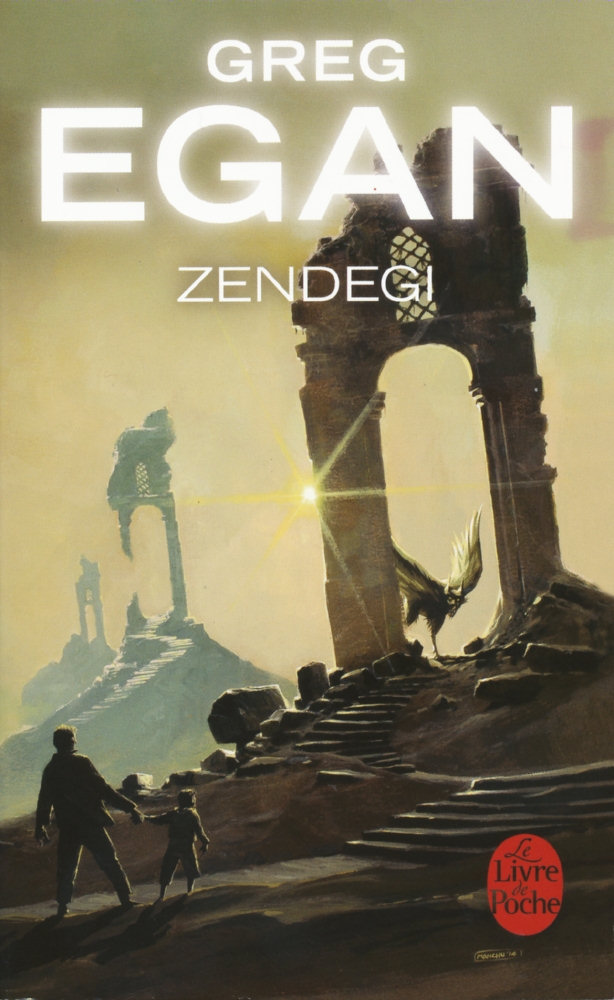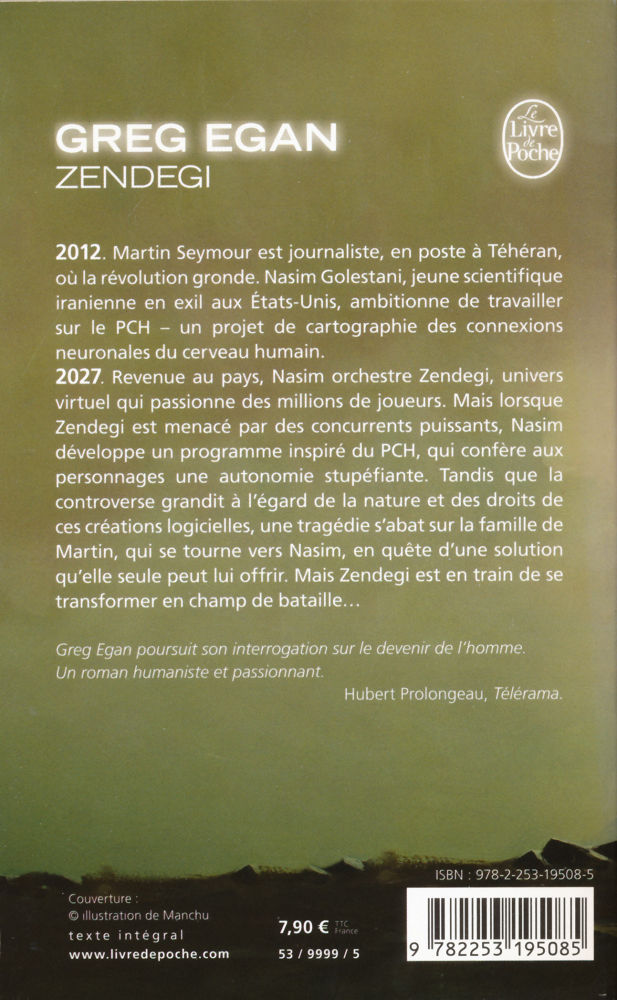|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Zendegi
Greg EGAN Titre original : Zendegi, 2010 Première parution : San Francisco, USA : Night Shade Books, mars 2010 ISFDB Traduction de Pierre-Paul DURASTANTI Illustration de MANCHU LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 33366 n° 33366  Dépôt légal : juin 2014, Achevé d'imprimer : juin 2014 Roman, 480 pages, catégorie / prix : 7,90 € ISBN : 978-2-253-19508-5 Format : 11,0 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
2012. Martin Seymour est journaliste, en poste à Téhéran, où la révolution gronde. Nasim Golestani, jeune scientifique iranienne en exil aux États-Unis, ambitionne de travailler sur le PCH – un projet de cartographie des connexions neuronales du cerveau humain.
2027. Revenue au pays, Nasim orchestre Zendegi, univers virtuel qui passionne des millions de joueurs. Mais lorsque Zendegi est menacé par des concurrents puissants, Nasim développe un programme inspiré du PCH, qui confère aux personnages une autonomie stupéfiante. Tandis que la controverse grandit à l’égard de la nature et des droits de ces créations logicielles, une tragédie s’abat sur la famille de Martin, qui se tourne vers Nasim en quête d’une solution qu’elle seule peut lui offrir. Mais Zendegi est en train de se transformer en champ de bataille...
Greg Egan poursuit son interrogation sur le devenir de l’homme. Un roman humaniste et passionnant.
Hubert Prolongeau, Télérama.
Critiques
En science-fiction, Greg Egan s’est taillé une solide réputation, irriguant le genre de concepts vertigineux et un tantinet abstraits. Car si elle prend souvent pour thème le devenir de l’homme, son œuvre s’aventure surtout sur les chemins arides de la physique quantique, de la numérisation de la personæ, de l’abstraction mathématique et jusqu’au téléchargement de la conscience, tentant d’impulser un sens rationnel à quelques questions métaphysiques essentielles. Avec Zendegi, il arrondit cependant les angles, donnant davantage de chair à l’aspect humain de son récit. Iran, 2012. La publication du résultat des élections législatives débouche sur un vaste mouvement de contestation. À Téhéran et ailleurs, on réclame justice, bravant la répression sauvage des Basijis. En poste dans le pays, Martin Seymour suit les événements pour le compte d’un quotidien australien. Quinze années plus tard, dans un État iranien désormais ouvert aux vertus démocratiques, il vit à Téhéran, marié à une Iranienne et père d’un petit garçon. Un jour, au retour de l’école, il s’initie en sa compagnie à Zendegi, un univers virtuel immersif développé par Nasim, une expatriée revenue au pays après la chute du gouvernement des mollahs. Ayant travaillé sur un projet de cartographie du cerveau aux USA, la scientifique s’apprête à utiliser le résultat de ses recherches pour modéliser des créatures numériques dotées d’une plus grande autonomie. À l’image d’Ian McDonald, Greg Egan imagine le futur dans un pays émergent, ici l’Iran, transposant des problématiques science-fictives en-dehors de leur matrice occidentale. Il faut cependant attendre la seconde partie du roman pour les voir véritablement surgir, l’auteur australien s’inspirant d’abord de la contestation de la réélection du président Ahmadinejad pour décrire une nouvelle révolution démocratique, cette fois-ci victorieuse. Passé ce long préambule, bien documenté, l’intrigue se resserre autour du duo formé par Martin et Nasim, conjuguant l’imaginaire des contes perses à une anticipation légère fondée sur les avancées des neurosciences et de la simulation virtuelle. Pour autant, Zendegi ne verse pas dans une hard SF débridée, préférant le domaine de l’intime aux enjeux spéculatifs, commerciaux et politiques soulevés par la création de logiciels conscients. Un choix risquant fort de déboussoler le lectorat avide de questionnements métaphysiques et éthiques. À défaut, il lui faut se contenter d’un récit dramatique, où l’auteur australien tente de titiller sa fibre sensible. Hélas, si le récit révèle une facette inattendue de l’écriture de Greg Egan, le résultat reste quelque peu laborieux. Si Zendegi apparaît comme un titre abordable pour le néophyte, le roman n’en demeure pas moins une tentative inaboutie de mêler hard SF, considérations politiques, éthiques et récit psychologique. Pas sûr que les aficionados d’Egan s’y retrouvent, en dépit d’un résultat honorable. Laurent LELEU Critiques des autres éditions ou de la série
Ce livre n'est rien moins qu'un événement. En effet, Greg Egan est, depuis qu'il a débuté, l'une des voix les plus intéressantes en SF, l'une de celles qui ont le plus fait progresser le genre depuis une quinzaine d'années. Aussi, tout nouvel ouvrage fait figure d'incontournable dans le paysage éditorial ; quand il s'agit comme ici du premier roman inédit en français de l'auteur depuis plus de dix ans – le dernier, Téranésie, était sorti en 2001 – le caractère exceptionnel est encore plus évident. En 2012, un journaliste, Martin Seymour, est envoyé en Iran pour couvrir la révolution en marche. De scènes d'émeutes en meetings politiques, il tente de décrypter les enjeux du conflit, en même temps qu'il trouve une terre d'accueil, lui qui se remet difficilement de la séparation d'avec sa femme. Au même moment, une chercheuse iranienne exilée aux États-Unis, Nasim Golestani, tente de dresser une cartographie des connexions au sein du cerveau humain. Après une première partie introductive, où Egan nous présente ces protagonistes, leurs envies et leurs tourments, on se retrouve en 2027. Martin vit désormais en Iran, où il tient une librairie ; il est marié, et a un enfant, qu'il distrait parfois en l'emmenant dans Zendegi, vaste univers virtuel partagé au réalisme saisissant et où l'on peut à peu près tout faire. Nasim est pour sa part rentrée en Iran, où elle est la tête pensante de l'entreprise commercialisant Zendegi ; son jeu souffre de la concurrence toujours plus forte, aussi doit-elle tenter en permanence de l'améliorer, et c'est là que son ancienne vie de chercheuse va lui servir. Elle et Martin vont se rencontrer, à l'occasion d'un événement marquant ; les possibilités offertes par la réalité virtuelle vont répondre à un besoin de Martin, et Nasim ne pourra refuser la demande d'aide de Martin, car cela lui permettra de pousser encore plus loin ses recherches... Difficile de parler de ce roman sans en dévoiler trop, et notamment ce qui va survenir après la rencontre entre Martin et Nasim... On avait souvent reproché à Egan par le passé de ne s'intéresser qu'aux considérations scientifiques ou philosophiques de ses intrigues, en évacuant – ou plutôt en négligeant – le facteur humain. L'auteur corrige le tir ici, et dresse le portrait de personnages attachants, qui ont tous leurs fêlures originelles : pour Martin c'est sa vie personnelle, et l'échec de sa relation amoureuse, pour Nasim sa fuite de son pays d'origine et ce perpétuel sentiment de ne pas être à sa place. La première partie risque à ce titre de surprendre les lecteurs habituels d'Egan : hormis quelques scènes dans le laboratoire de Nasim, où spéculations scientifiques se confrontent aux expériences en cours, l'essentiel du début du livre se déroule dans un Iran très terre à terre, où les gens luttent pour leur liberté, dans une révolution qui résonne étrangement après le printemps arabe de 2011 (il est d'ailleurs intéressant de signaler que Zendegi fut publié en 2010). Aucune hypothèse scientifique ou mathématique poussée ici, juste le combat vital pour la dignité. Greg Egan peut alors se lancer dans la deuxième partie avec des personnages faits de chair et de sang, auxquels on s'identifie sans mal. Et c'est tant mieux, car l'auteur nous mène tout droit au cœur d'une tragédie humaine, que l'on n'aurait pu apprécier si les personnages avaient été de carton-pâte. Bien sûr, les interrogations ontologiques sont au centre du propos d'Egan, il n'oublie pas d'où il vient, et les tentatives de Nasim pour construire un être humain virtuel qui soit la réplique exacte d'une véritable personne, et non pas simplement un système expert qui puisse apprendre à se comporter de la même manière que son modèle, sont passionnantes. Mais le romancier ne s'arrête pas là et transcende littéralement son intrigue par des sentiments humains beaucoup plus universels que sont l'amour d'un père pour son fils, et la crainte pour son avenir. Les plus hardcore des fans d'Egan trouveront très certainement que l'auteur reste à un niveau de spéculation bien moindre – et donc moins bien ébouriffant – que dans ses précédents livres, et que la conclusion est un peu trop sibylline ; j'ai pour ma part grandement apprécié ce mélange des thématiques eganiennes typiques avec un vrai talent pour dépeindre les tourments de Marttin, homme en plein drame personnel, mais qui garde intacte sa foi en l'avenir. Tout juste ai-je trouvé dommage que l'auteur n'utilise pas davantage sa première partie – la révolution iranienne – dans la suite de l'ouvrage ; j'ai eu l'impression que l'Iran vivant du début était ensuite réduit au rang de simple décor, sans réel écho avec le monde virtuel de Zendegi, malgré les splendides passages d'apprentissage du Shâhnâmeh, poème épique retraçant la construction du pays. Bref, Zendegi marque le retour au premier plan d'Egan romancier, qu'on avait perdu de vue depuis dix ans au profit du nouvelliste. Beaucoup moins hard science, mais davantage humain, ce roman a en outre un énorme potentiel pour faire découvrir l'auteur aux lecteurs qui auraient pu être effrayés par l'aspect trop scientifique des précédents. Bruno PARA (lui écrire)
Le dernier roman traduit de Greg Egan suit la trajectoire de deux personnages : en 2012, Nasim Golestani, Iranienne exilée aux Etats-Unis, travaille sur le PCH, un projet de cartographie des cerveaux, et Martin Seymour, journaliste à Téhéran au moment où un scandale politique entraîne la fin du régime des ayatollahs. La cartographie pourrait permettre de lire les pensées, voire de dupliquer une personnalité : le lecteur qui a La Cité des permutants en tête attend de voir dans quelle direction se développera l'histoire ; le petit air de déjà vu est compensé par une étude plus fouillée des difficultés, qui ne sont pas que technologiques ou éthiques mais aussi financières. Greg Egan fournit ici une description assez réaliste et décourageante des arcanes des milieux scientifiques. Contre toute attente, le roman s'attache pourtant à la trajectoire de Martin, lequel tombe amoureux de la culture iranienne en même temps que de Mahnoosh, une opposante au régime des mollahs avec qui il refait sa vie et a un enfant, Jareed. La seconde partie, qui occupe les deux tiers du roman et se déroule quinze ans après la révolution, dans un proche futur, donc, s'ouvre sur un drame qui va opérer le lien entre les deux intrigues : Nasim, parente de Mahnoosh, est retournée en Iran après la révolution et développe un système de jeu d'immersion virtuelle, Zendegi, dont le principal avantage est la fluidité et le haut degré de réalisme, jeu dans lequel elle injecte ses travaux sur le PCH en réalisant des personnages virtuels quasi autonomes. Martin sait que son fils sera appelé à vivre avec la famille d'Omar, ami de longue date, mais n'est pas persuadé que ce dernier lui transmettra les valeurs auxquelles il est attaché. D'où le projet fou de l'éduquer jusqu'à sa majorité en se scannant le cerveau pour devenir un partenaire de jeu dans Zendegi. C'est donc une course contre la montre qui commence, encore contrariée par des factions réclamant l'autonomie des logiciels conscients, et des sabotages destinés à ruiner Zendegi dont il faut rapidement trouver les auteurs. Si les vertigineuses interrogations métaphysiques sont bien évoquées, elles sont à peine approfondies, au risque de désarçonner le lecteur. L'auteur privilégie clairement la dimension humaine du récit, réellement poignante. L'impression de dispersion qui résulte d'une intrigue apparaissant tardivement donne à la charpente du roman la colonne vertébrale d'une girafe, avec les apparentes digressions, pourtant nécessaires, de la première partie, étirant le roman jusqu'au démarrage effectif à mi-chemin du livre. En réalité, c'est avec brio que l'auteur déjoue les attentes de son lectorat sans cesser de spéculer sur les mêmes thèmes, à un niveau plus profond, de façon moins spectaculaire sans doute, mais assurément plus subtile. Dès le départ, l'auteur annonce la couleur : exit les facilités de la culture dominante, Martin bazarde ses disques rock, qu'il troque pour des versions numériques nettoyées au résultat, et c'est un indice, finalement décevant, tandis que les classiques intrigues de numérisation de cerveaux sont contrariées par les manques de budget. A la place, il propose une plongée dans la culture de la Perse antique, avec de fascinants jeux de miroirs où réel et virtuel s'interpénètrent (car c'est une adaptation d'un célèbre poème épique de l'an mil, le Shâh Nâmeh, qu'on découvre dans Zendegi), les décors orientaux devenant les fractales exotiques répétant les motifs récurrents du récit, chacun éclairant l'autre de façon fascinante. En mariant davantage spéculations audacieuses et intrigue intimiste, Greg Egan devient accessible à un plus grand nombre de lecteurs, mais sa virtuosité est intacte. Ajoutons que le roman, écrit avant les révolutions arabes, présente un Iran mal connu mais réaliste, l'auteur ayant fait le voyage pour s'imprégner de sa culture. Claude ECKEN (lui écrire) |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |