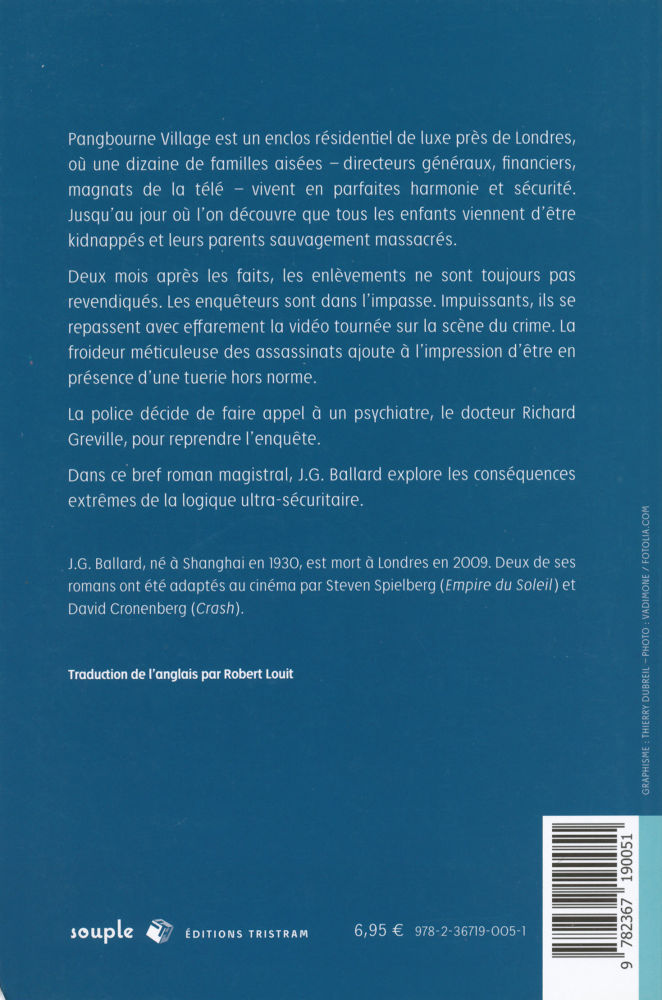|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Sauvagerie
James Graham BALLARD Titre original : Running Wild, 1988 Première parution : Londres, Royaume-Uni : Hutchinson, novembre 1988 ISFDB Traduction de Robert LOUIT TRISTRAM (Auch, France), coll. Souple n° (1)  Dépôt légal : janvier 2013, Achevé d'imprimer : mars 2017 Retirage Novella, 96 pages, catégorie / prix : 6,95 € ISBN : 978-2-36719-005-1 Format : 12,5 x 19,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Graphisme de couverture : Thierry Dubreil ; photo : vadimone/fotolia.com.
Autres éditions
Sous le titre Le Massacre de Pangbourne BELFOND, 1992 MILLE ET UNE NUITS, 1995 Sous le titre Sauvagerie TRISTRAM, 2008, 2021
Quatrième de couverture
Pangbourne Village est un enclos résidentiel de luxe près de Londres, où une dizaine de familles aisées - directeurs généraux, financiers, magnats de la télé - vivent en parfaites harmonie et sécurité. Jusqu'au jour où l'on découvre que tous les enfants viennent d'être kidnappés et leurs parents sauvagement massacrés. J.G. Ballard, né à Shanghai en 1930, est mort à Londres en 2009. Deux de ses romans ont été adaptés au cinéma par Steven Spielberg (Empire du soleil) et David Cronenberg (Crash). Critiques des autres éditions ou de la série
Sauvagerie est la réédition d'un texte déjà publié en 1992 chez Belfond sous le titre Le Massacre de Pangbourne. Écrit en 1988, soit quelques mois après la tuerie de Hungerford, dans le Berkshire, ce récit davantage une longue nouvelle qu'un roman suit les traces de Richard Greville, un psychiatre. Celui-ci est chargé d'enquêter sur les sinistres événements advenue à Pangbourne Village, une charmante résidence surveillée peuplée d'une quinzaine de familles aisées. Un jour, au petit matin, tous les adultes du village sont tués en très peu de temps ; les enfants sont quant à eux kidnappés, tout cela sans qu'aucune caméra de surveillance ait filmé quoi que ce soit. Et, deux mois après les faits, aucune demande de rançon n'ayant été faite, toutes les pistes ont été explorées sans succès, la police décide donc de faire appel à Greville pour revisiter d'un œil neuf les éléments à disposition. Le propos de Ballard n'est pas ici de livrer un roman à suspense où l'identité des meurtriers / kidnappeurs serait dévoilée peu à peu ; le lecteur aura d'ailleurs vite fait de deviner qui sont les responsables de ces actes de barbarie. Ce qui intéresse l'auteur, ce sont au contraire les mécanismes qui vont mener à cette débauche de violence. Mais pas tant les mécanismes humains (sentiments, envies, hantises...) que les mécanismes sociaux. Car la tuerie de Pangbourne, comme celle de Hungerford, et toutes celles qui l'ont suivie, en Angleterre, aux États-Unis ou plus récemment en Finlande, sont selon Ballard clairement des émanations de notre société ultra-sécuritaire, un carcan invivable pour la nature humaine, et dont on ne peut sortir que par la violence. Une sorte de renaissance par la douleur, nécessaire à l'épanouissement de l'espèce humaine. Un constat très âpre, qui prend à contre-pied beaucoup d'idées reçues, et qui ne manquera pas de prêter à polémique. Pour donner encore plus de force à son propos, Ballard emploie ici son ton habituel, froid et détaché le métier du narrateur est à ce titre révélateur , ce qui fait de ce livre presque autant un essai qu'une œuvre de fiction. Sans que cela nuise à la lecture, car l'enquête de Greville reste quand même au centre de Sauvagerie, et sa reconstitution des faits survenus est d'une extrême minutie ; ce qui au passage met mal à l'aise le lecteur, qui subit tout autant qu'il découvre les mises à mort toutes plus ignobles les unes que les autres. Il y a tout juste vingt ans, Ballard tirait la sonnette d'alarme à propos d'une certaine dérive sécuritaire du monde et de ses conséquences les plus sordides ; vingt ans après, on constate que rien n'a changé, et que le phénomène s'est même amplifié. Glaçant. Bruno PARA (lui écrire)
Sauvagerie s'inscrit encore dans ce vaste projet d'exploration littéraire de ce que l'auteur avait appelé dans un article de New Worlds en 1962 (à lire dans Millénaire mode d'emploi) les « espaces intérieurs ». Ici, c'est la télésurveillance et le retranchement de familles aisées dans des résidences paradisiaques surprotégées qui fournissent le cadre d'une intrigue sans suspense — l'on identifie rapidement les coupables — , mais d'une remarquable densité. En cent vingt pages, J. G. Ballard nous introduit dans un enfer hyperfonctionnel où rien ne distingue une image de sitcom d'une image de charnier. Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles de riches propriétaires, symboles de la réussite capitaliste, vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d'alarmes électriques, aux allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des patrouilles et des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu'une équipe de la BBC s'apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l'assassinat des trente-deux adultes, et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C'est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, mais aucune n'est jugée réaliste. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l'identité des coupables, et n'a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d'abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu'il s'imprègne de l'atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante... Greville insiste très tôt dans son journal sur le caractère aseptisé de la résidence, et dessine peu à peu l'image d'une vie parfaitement saine, raisonnable et bienveillante — à laquelle fait d'ailleurs écho le style clinique du texte — , débarrassée de toutes les impuretés et zones d'ombres du monde extérieur. L'endroit va cependant finir par révéler son envers. Et pour commencer, on y reste entre soi, sans pour autant se fréquenter. En rétrécissant leur univers, les habitants de Pangbourne ont effacé de leur conscience tout élément indésirable... Ainsi n'ont-ils rien vu de ce qui se tramait dans leurs propres résidences. Aux riches heures du thatchérisme, quelques années avant American Psycho de Bret Easton Ellis — et avant le massacre de Columbine — , J. G. Ballard laissait déjà entendre dans ce stupéfiant roman, inspiré des meurtres de Michael Ryan à Hungerford, que dans les paradis sains, civilisés, fermés sur eux-mêmes et étanches au bruissement du monde, dans ces microcosmes hyperréels auxquels aspire l'homme postmoderne, la sauvagerie s'impose comme la dernière forme de subversion, la dernière liberté à sa disposition. Glaçant. Olivier NOËL |
| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112190 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |