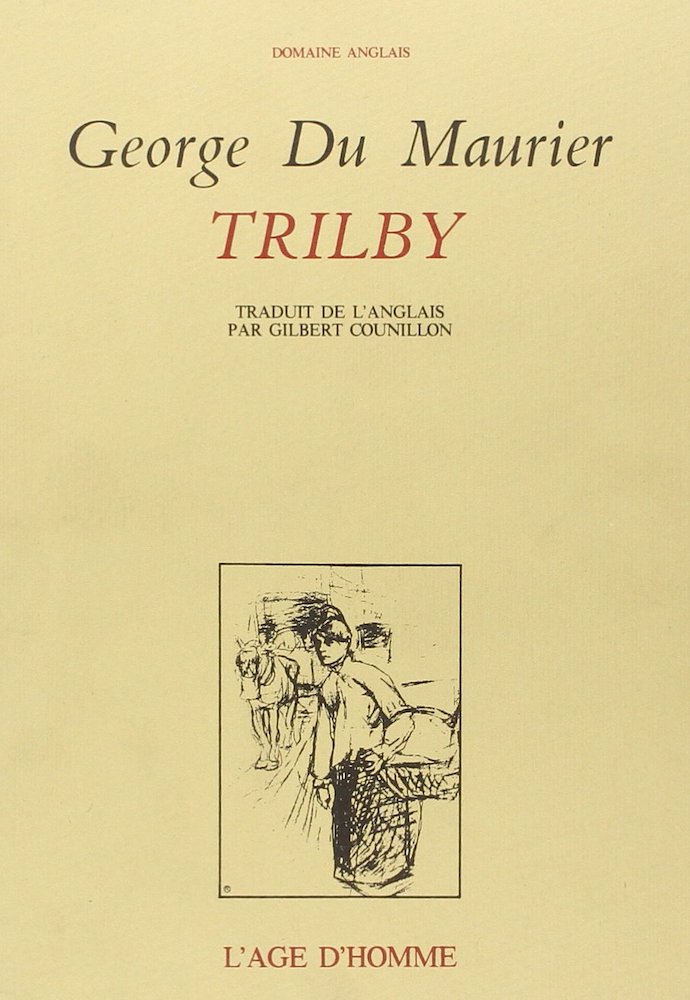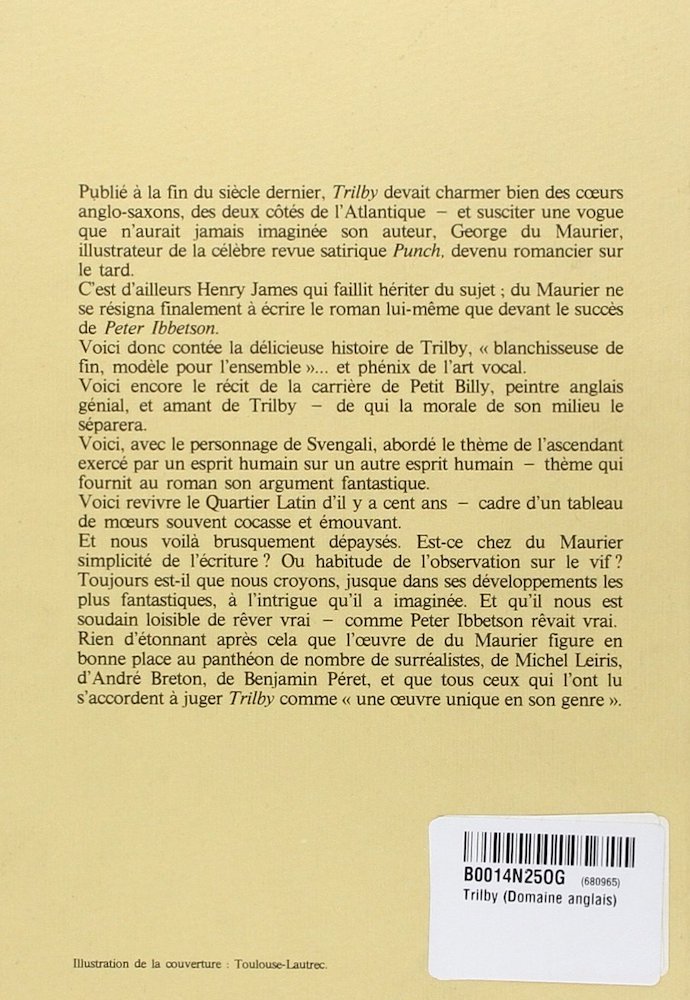|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Trilby
George DU MAURIER Titre original : Trilby, 1985 Première parution : New York : U.S.A. : Harper's Magazine, 1894 ISFDB Traduction de Gilbert COUNILLON Illustration de TOULOUSE-LAUTREC JULLIARD - L'ÂGE D'HOMME (Paris, France), coll. Domaine anglais Dépôt légal : 1985 Première édition Roman, 232 pages Format : 16,0 x 23,0 cm❌ Genre : Fantastique EAN : 9782825122952.
Quatrième de couverture
Publié à la fin du siècle dernier, Trilby devait charmer bien des cœurs anglo-saxons, des deux côtés de l’Atlantique — et susciter une vogue que n’aurait jamais imaginée son auteur, George du Maurier, illustrateur de la célèbre revue satirique Punch, devenu romancier sur le tard. Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)
Trilby , 1912, Jacob Fleck, Luise Fleck, Anton Kolm, Claudius Veltée Trilby , 1914, Harold M. Shaw Trilby , 1915, Maurice Tourneur Trilby , 1923, James Young Svengali , 1927, Gennaro Righelli Svengali , 1931, Archie Mayo Studio One (Saison 3 Episode 4 : Trilby ) , 1950, Paul Nickell (épisode de série) Svengali , 1954, Noel Langley Saturday Playhouse ( Saison 1 Episode 26 : Trilby ) , 1959, inconnu (épisode de série) BBC Play of the Month ( Saison 11 Episode 5 : Trilby ) , 1976, Piers Haggard (épisode de série) Svengali , 1983, Anthony Harvey (Téléfilm) |
| Dans la nooSFere : 87273 livres, 112165 photos de couvertures, 83709 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |