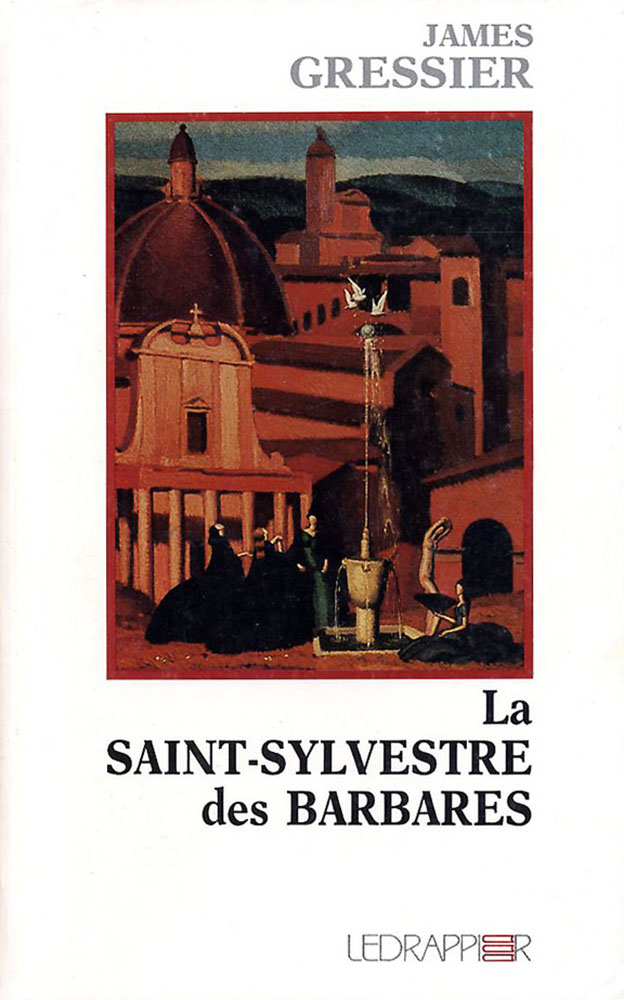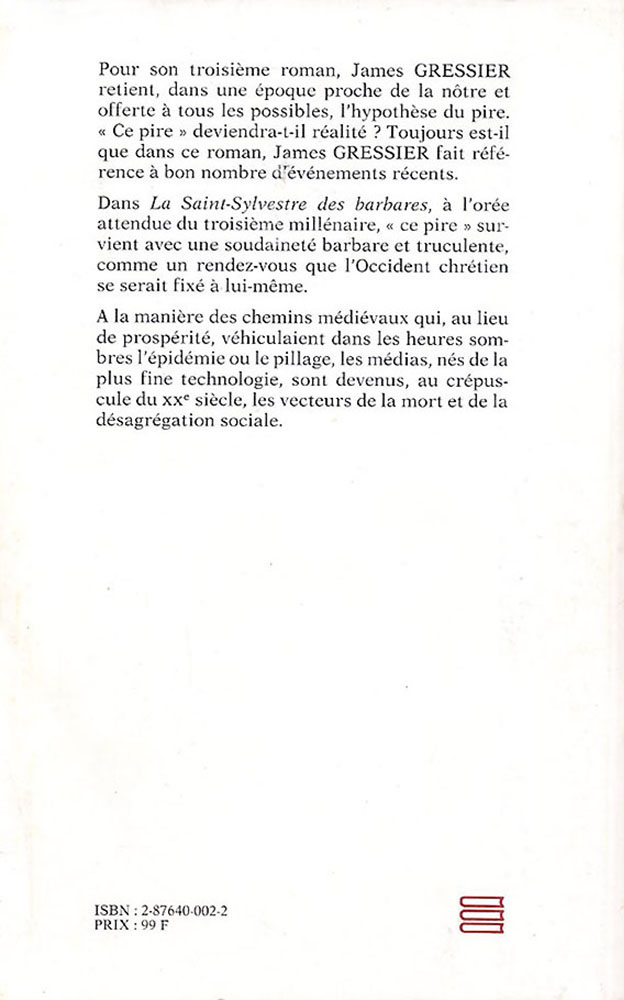|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Saint-Sylvestre des barbares
James GRESSIER Première parution : Paris, France : Ledrappier, 1987 Illustration de Jean DUPAS LEDRAPPIER (Paris, France) Dépôt légal : 1er trimestre 1987, Achevé d'imprimer : mars 1987 Première édition Roman, 224 pages, catégorie / prix : 99 FF ISBN : 2-87640-002-2 Format : 14,0 x 22,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Le livre fait 224 pages, mais la pagination commence à la page 3.
Quatrième de couverture
Pour son troisième roman, James GRESSIER retient, dans une époque proche de la nôtre et offerte à tous les possibles, l'hypothèse du pire. « Ce pire » deviendra-t-il réalité ? Toujours est-il que dans ce roman, James GRESSIER fait référence à bon nombre d'événements récents. Dans La Saint-Sylvestre des barbares, à l'orée attendue du troisième millénaire, « ce pire » survient avec une soudaineté barbare et truculente, comme un rendez-vous que l'Occident chrétien se serait fixé à lui-même. À la manière des chemins médiévaux qui, au lieu de prospérité, véhiculaient dans les heures sombres l'épidémie ou le pillage, les médias, nés de la plus fine technologie, sont devenus, au crépuscule du XXe siècle, les vecteurs de la mort et de la désagrégation sociale.
Critiques
Sorti hors collection, chez une jeune maison d'édition qui n'a qu'un an d'âge mais déjà un joli catalogue, et sous une couverture reproduisant un beau tableau de Jean Dupas (style Chirico), cette Saint-Sylvestre-là trace le dessin d'une décomposition et d'une renaissance. « Le siècle qui venait de mourir avait été celui d'une prodigieuse accélération qui déferlait en paroxysme sur ce premier printemps du nouveau millénaire », écrit l'auteur au départ de son chapitre deux, où est expliqué que de nouvelles élections n'ont rien changé, mais que des partis d'ordre aux noms belliqueux, le P.O.R., le P.U.R. se font une guerre qui n'est pas que de mots, tandis que des bandes armées (qui ont l'apparence des motards californiens et de nos punks) déferlent sur l'hexagone en proie à la pénurie... Politique-fiction ? Malgré le cadre, pas du tout. Plutôt une philosophie-fiction où, entre la crainte exacerbée de la « décadence » (un thème idéologique à la mode) et l'espoir d'un renouveau (dernière phrase du roman : « il naît partout de plus en plus d'enfants »), l'auteur s'essaye à décrire une utopie-Phénix s'élevant des cendres du « vieux monde ». Ce n'est pas très original. Les ingrédients non plus : le narrateur fait partie d'une communauté élargie retranchée dans un château de la France profonde, que dirige un médecin, Saint-Léger. Le camp subit de nombreuses attaques, repoussées, et, à la suite de la mort de Saint-Léger, son jeune poulain prendra la relève. Il faut des chefs ! Ces quelques indices, alliés à d'autres (p.194, Gressier n'hésite pas à écrire que les trois cavaliers de la décadence sont « la guerre, le génocide, et... l'avortement »), nous font comprendre que nous avons là un récit de droite (lapsus caractéristique, la compagne que se choisit le narrateur est surnommée « Droite »). Ce n'est bien évidemment pas répréhensible en soi : chacun ses opinions. Et le style de l'auteur, très littéraire, très fleuri, n'est pas désagréable à absorber, bien qu'il produise un effet de distanciation qui gêne l'accroche. Plus grave est la poursuite du récit qui, même si son point de départ est différent (mort lente au lieu de mort brutale), fait irrésistiblement penser à Malevil de Robert Merle. Et là, bien sûr, la comparaison est écrasante. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |
| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |