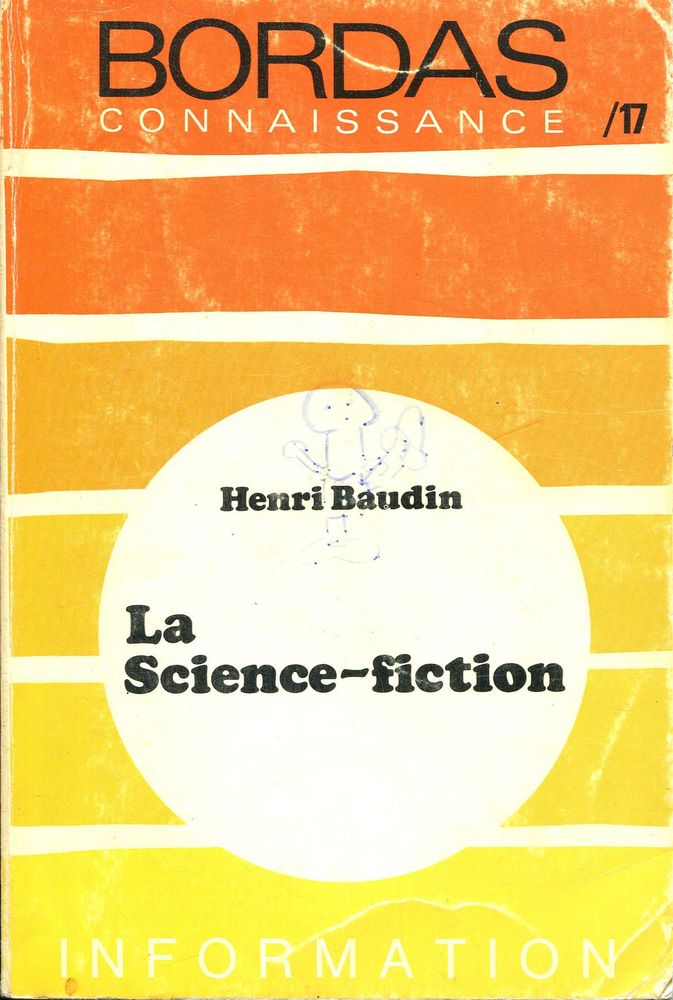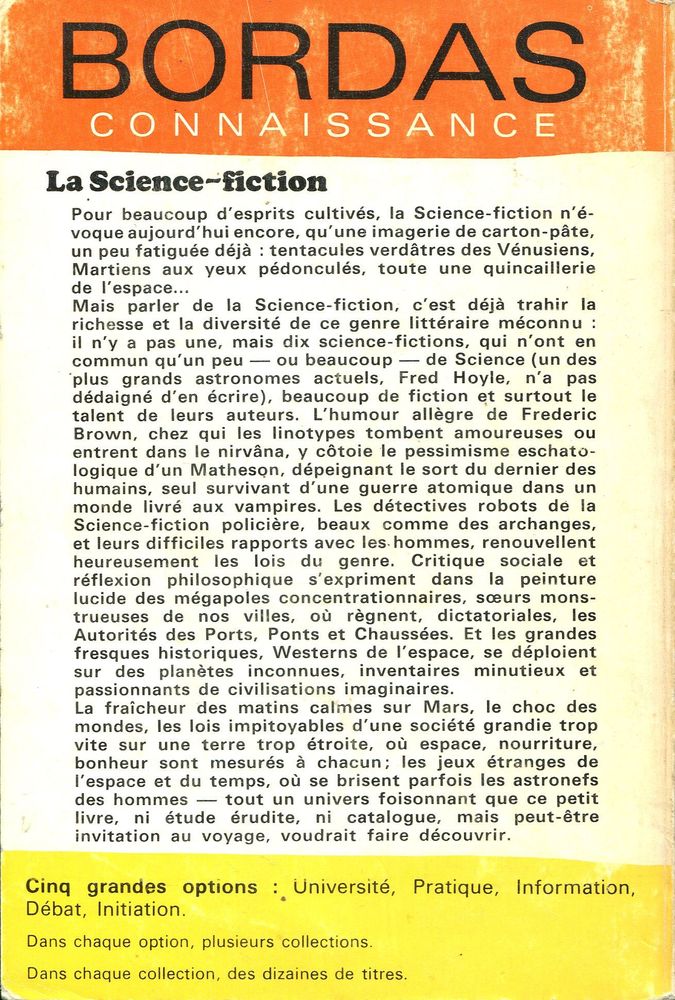|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Science-fiction
Henri BAUDIN BORDAS (Paris, France), coll. Bordas Connaissance n° 17 Dépôt légal : 2ème trimestre 1971 Première édition Ouvrage de référence, 160 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,1 x 16,6 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
Pour beaucoup d'esprits cultivés, la Science-fiction n'évoque aujourd'hui encore, qu'une imagerie de carton-pâte, un peu fatiguée déjà : tentacules verdâtres des Vénusiens, Martiens aux yeux pédonculés, toute une quincaillerie de l'espace...
Mais parler de la Science-fiction, c'est déjà trahir la richesse et la diversité de ce genre littéraire méconnu : il n'y a pas une, mais dix science-fictions, qui n'ont en commun qu'un peu — ou beaucoup — de Science (un des plus grands astronomes actuels, Fred Hoyle, n'a pas dédaigné d'en écrire), beaucoup de fiction et surtout le talent de leurs auteurs. L'humour allègre de Frederic Brown, chez qui les linotypes tombent amoureuses ou entrent dans le nirvâna, y côtoie le pessimisme eschatologique d'un Matheson, dépeignant le sort du dernier des humains, seul survivant d'une guerre atomique dans un monde livré aux vampires. Les détectives robots de la Science-fiction policière, beaux comme des archanges, et leurs difficiles rapports avec les hommes, renouvellent heureusement les lois du genre. Critique sociale et réflexion philosophique s'expriment dans la peinture lucide des mégapoles concentrationnaires, sœurs monstrueuses de nos villes, où régnent, dictatoriales, les Autorités des Ports, Ponts et Chaussées. Et les grandes fresques historiques, Westerns de l'espace, se déploient sur des planètes inconnues, inventaires minutieux et passionnants de civilisations imaginaires.
La fraîcheur des matins calmes sur Mars, le choc des mondes, les lois impitoyables d'une société grandie trop vite sur une terre trop étroite, où espace, nourriture, bonheur sont mesurés à chacun ; les jeux étranges de l'espace et du temps, où se brisent parfois les astronefs des hommes — tout un univers foisonnant que ce petit livre, ni étude érudite, ni catalogue, mais peut-être invitation au voyage, voudrait faire découvrir.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Avertissement, pages 3 à 4, introduction 2 - Approches de la science-fiction, pages 5 à 19, article 3 - La Science-fiction rationaliste, pages 20 à 49, article 4 - S.-F. et vulgarisation, pages 21 à 25, article 5 - S.-F. et anticipation, pages 25 à 29, article 6 - S.-F. et prospective, pages 30 à 34, article 7 - S.-F. et extrapolation, pages 34 à 49, article 8 - La Science-fiction philosophique, pages 50 à 79, article 9 - S.-F. et récupération allégorique, pages 51 à 59, article 10 - S.-F. et projection idéologique, pages 60 à 67, article 11 - S.-F. et exploration utopique, pages 67 à 79, article 12 - La Science-fiction littéraire (Un fantastique pour notre temps), pages 80 à 139, article 13 - S.-F. et science, pages 84 à 98, article 14 - S.-F. et fiction, pages 98 à 117, article 15 - S.-F. et littérature, pages 117 à 136, article 16 - S.-F. et culture, pages 136 à 139, article 17 - Science-fiction et réalité, pages 140 à 152, conclusion 18 - Annexe : chronologie 2020-4000, pages 153 à 156, notes 19 - Notes, pages 157 à 160, notes
Critiques
La science-fiction d'Henri Baudin (Bordas) a succédé à La science-fiction de Jean Gattégno (Presses Universitaires de France ; voir critique dans notre n° 219). Ce sont deux livres très comparables par la présentation et par le volume (150 pages environ), par les intentions (faire un tour rapide de la littérature de SF) et, enfin, par la personnalité des auteurs : Gattégno et Baudin sont tous deux universitaires et dirigent des diplômes et des maîtrises sur la SF, le premier à Vincennes, le second à Grenoble (deux bastions rouges bien connus). Que fait un vulgarisateur en SF pour donner à ses lecteurs une première idée du genre ? Il cherche, dans sa tête ou dans les livres, une définition acceptable et entame un combat désespéré avec le mot « science » qui, dans le terme science-fiction, récolte toutes les indignités, accroche toutes les réticences. Dès son Avertissement, Henri Baudin tourne la difficulté en écrivant : « Il peut sembler curieux que les noces de la science avec la création littéraire aboutissent à mettre l'imagination au pouvoir. C'est que la science elle-même, empire de certitudes établies ou imminentes pour le scientisme du siècle dernier, est devenue au nôtre le comble de l'aléatoire et du paradoxal, et que l'imagination créatrice y est reconnue comme une faculté majeure » (p. 4). Cette réflexion lui permet (même si le rôle — ou les rôles — de la science en SF sera abordé sous des angles différents dans le développement de l'ouvrage) de passer immédiatement à un essai de définition qui ne saurait être appuyé que par des exemples concrets, introduits par l'expression cabalistique : « C'est quand... » La SF selon Baudin, donc, c'est quand... Et l'auteur de nous donner, pendant cinq ou six pages, des exemples de têtes de chapitres tirés des romans des meilleurs auteurs. Ce qui lui permet de conclure en dressant un échantillonnage (non exhaustif) des principaux ressorts de la SF : « D'abord le grossissement, obtenu par l'éloignement spatial ou temporel extrême (vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit, comme vers le futur ou le passé), par le fondamental (vital, élémentaire ou terminal), par l'intensité (sensations, expressions ) et par la pureté exemplaire des aspects abordés (détails, gratuité esthétique, apories intellectuelles). Puis l'insolite, lié à l'exotisme (vocabulaire, détails descriptifs, anticipation technique) et à l'innovation intellectuelle (esthétique, paradoxes, osmose ou indistinction des catégories). Enfin l'impact psychique, marqué dans la projection des angoisses (monstres, catastrophe, régression ) ou des espoirs f pouvoirs accrus, intégration socio-politique, communion), ainsi que dans l'irrationnel (du cosmique au mystique) » (pp. 12 et 13). Mais, peu satisfait tout de même de cette définition par un montage de thèmes, Baudin va ensuite chercher chez Todorov, Caillois, Kingsley Amis, des essais de définition du genre, par rapport au fantastique ou par rapport à la littérature en général. Nous retiendrons, d'après Todorov, cette bien charmante classification sylvestre par une synecdoque très imagée : « L'étrange, ce peut être le fait d'un sous-bois aux aspects funèbres réductibles à l'obscurité froide et humide, au parfum lourd des champignons et de l'humus ; le fantastique, c'est souvent le manoir hanté dont on ne peut prouver ni qu'il l'est ni qu'il ne l'est pas ; le merveilleux, c'est la forêt de Brocéliande, enchantée par Merlin ou Viviane ; la SF, c'est la planète lointaine aux forêts pétrifiées, ou métalliques, ou carnivores » (pp. 14 et 15). Mais cette métaphore est encore trop évasive pour Baudin qui, après avoir survolé Caillois, coupable selon lui d'ignorer la part métaphysique de la SF, se rabat finalement sur Kingsley Amis et sa définition (dans L'univers de la science-fiction) : « Récit en prose traitant d'une situation qui ne pourrait se présenter dans le monde que nous connaissons, mais dont l'existence se fonde sur l'hypothèse d'une innovation quelconque d'origine humaine ou extraterrestre, dans le domaine de la science ou de la technologie, disons même de la pseudo-science ou de la pseudo-technologie » (pp. 17 et 18). L'ouvrage proprement dit s'organise ensuite en quatre chapitres : La SF rationaliste (où l'auteur analyse ses rapports avec la science) ; La SF philosophique (rapports avec les systèmes de pensée ou idéologies) ; La SF littéraire (étudiée en tant que littérature) ; enfin, SF et réalité (qui tend à rendre compte de ses attaches avec le présent). Il y aurait eu peut-être avantage pour Baudin à structurer son ouvrage en deux parties bien distinctes, selon les deux premiers et les deux derniers chapitres qui, présentés en continuité, entretiennent une certaine confusion de nature. SF rationaliste et SF philosophique sont en effet une étude des thèmes (donc une vision de l'intérieur), alors que SF et littérature et SF et réalité sont plutôt une étude de rapports et de points de convergence (donc vision de l'extérieur), étude qui recoupe d'ailleurs en certains points la matière des deux premiers chapitres. Avant d'aborder plus en détail l'analyse de Baudin, il est bon de signaler que celui-ci n'oublie pas qu'il est un auteur écrivant en France pour des lecteurs français. Cette optique l'a poussé è choisir, comme références, au moins autant de textes nationaux (Wul, Steiner, Carsac, Barjavel, Henneberg, Sternberg, Klein... la fine fleur des écrivains du terroir !) que de récits étrangers. C'est là un point de départ à la fois objectif et sympathique pour nos amis écrivains, et qui se devait, sans chauvinisme aucun, d'être signalé. Abordant La sicence-fiction rationaliste, Baudin opte, dès le départ, pour une subdivision en quatre paragraphes : « La vulgarisation, transmission d'un savoir par des spécialistes de ce savoir à des non-spécialistes (...) ; l'anticipation, confrontation ordonnée, pour une action future, des diverses connaissances qu'elle devra mettre en jeu ; la prospective, prévision cohérente, à plus long terme, des implications inhérentes à l'état prochain ou présent des connaissances ; l'extrapolation, déduction ou analogie plus ou moins aventureuse à partir des connaissances acquises ou d'un domaine voisin » (p. 20). Si on ne peut guère suivre l'auteur quand, parlant de vulgarisation, il est bien obligé d'inclure dans cette catégorie des ouvrages non-romanesques qui n'ont rien à faire ici, on suit par contre sans réticence son exploration de la SF vue du cours de plus en plus large du fleuve science. Ainsi Wells et Verne sont-ils à ranger dans l'anticipation, tandis qu'à l'autre bout du parcours les histoires traitant de voyage dans le temps ou dans d'autres dimensions, ainsi que celles reposant sur des technologies aléatoires (le « vire-matière »), sont à placer dans le paragraphe extrapolation. On peut encore une fois accuser Baudin d'amalgame lorsqu'il range sous l'étiquette prospective (considérée bien sûr comme un stade du romanesque) le calendrier du futur de la Rand Corporation — mais au fait, la prospective à l'américaine étant une « science » des plus fantaisistes, pourquoi ne pas la compter parmi les œuvres d'imagination ? La « science-fiction philosophique », objet du second chapitre, est scindée en trois parties. L'allégorie commence par Gilgamesh, passe par Cyrano, Swift, Wells encore, Huxley, pour aboutir — et pourquoi non ? — à Sternberg, dont Baudin semble apprécier particulièrement l'humour caustique et les visions désespérées. Dans tous ces cas, écrit-il, « on a affaire à une attitude consciente et délibérée qui récupère l'imagination au profit de l'idéologique et l'efface devant ce dernier promu au rôle de « message » (p. 53). En cas de projection idéologique, la SF se charge comme malgré elle d'une sursignification : « Même pure au départ, la fiction en vient souvent à se charger de hantises (soit craintes, soit espoirs) propres au créateur ou diffuses dans son époque, quand elles ne sont pas les deux à la fois. Il n'y a plus cette fois préméditation, intention fondamentale d'exprimer telle hantise ; c'est une attitude soit inconsciente, soit accessoire, qui fond intimement imaginaire et idéologique » (p. 60). A cette catégorie ressortissent des œuvres aussi disparates que Ravage, Les cavernes d'acier, Planète à gogos, les Galaxiales de Michel Demuth. Cependant, je pense qu'entre la première et la deuxième catégorie de récits, les frontières ne sont pas aussi nettement délimitées que semble le croire Baudin. L'inconscient des auteurs a en général bon dos, les critiques littéraires adorant prétendre « découvrir » dans un texte tout ce que l'auteur a censément mis sans s'en rendre compte... Le « deuxième degré. » n'est pas qu'une affaire d'inconscient vagabond et d'influences souterraines, et il faut malgré tout faire confiance aux écrivains quant au travail en profondeur qu'ils effectuent dans leurs écrits ! L'exploration utopique, enfin, comprend ces larges tranches d'histoire du futur passées au moule d'une idéologie (consciemment exprimée ou non ?), dont certains écrivains ont leur spécialité : Un cantique pour Leibowitz, et surtout Fondation et ses suites, que Baudin examine tout particulièrement. Il est plus difficile de rendre compte du large chapitre consacré à La SF littéraire car, ainsi que je l'ai souligné, il est question ici de manière plus que de matière (ce qui n'empêche pas certains développements d'interférer avec des points évoqués dans les deux chapitres précédents). Baudin s'y préoccupe en tout cas de privilégier, non plus les thèmes, mais les critères littéraires, ceci dans l'intention militante de « défendre » la SF contre l'assaut de ses détracteurs : « Je ne vois pas en quoi la SF a quoi que ce soit de mineur par rapport au roman en général ; comme celui-ci, la SF comporte une production de masse vouée à la grosse consommation, dont les lettrés oublient de tenir compte quand ils pensent au roman en soi et dont ils tiennent exclusivement compte quand ils pensent à la SF... » (p. 131 ). Ce que veut mettre en lumière Baudin, c'est que l'apport des thèmes nouveaux de la SF insuffle aux romans qui les utilisent un sang nouveau, un style nouveau, des idées nouvelles. En ce qui concerne la science (encore elle !), l'auteur écrit avec justesse : « Les spéculations scientifiques suggèrent des problèmes ou des solutions. Ainsi se confirme la mise au service de la fiction que subit la science dans la SF » (p. 98), Dans son paragraphe intitulé SF et fiction, Baudin analyse surtout les implications morales de certaines situations créées par la SF ( Blish, Farmer, Ortog et les ténèbres). Mais alors pourquoi n'avoir pas tout simplement titré : SF et morale ? SF et littérature (troisième paragraphe) rend compte de l'insertion de la SF dans la littérature générale, et Baudin conclut par cette citation empruntée à Asimov (préface des Histoires mystérieuses) : « Beaucoup de profanes ont tendance à ne voir dans la science-fiction qu'un genre spécialisé au même titre que le policier, le western (... etc.) — Ce parti-pris a toujours paru étrange à ceux qui connaissent bien la science-fiction, car celle-ci est la réponse littéraire à un changement des structures scientifiques, réponse qui engage la totalité de l'expérience humaine » (p. 136). Dans SF et culture enfin, et se référant cette fois aux travaux de Gérard Klein, l'auteur analyse brièvement l'effet dialectique produit par l'envahissement de notre monde par des objets SF, et par l'acquisition, par la science-fiction, d'éléments empruntés au monde réel. Cela l'amène très logiquement à conclure par le court chapitre intitulé SF et réalité, introduit par cette citation de Vladimir Pozner (revue Europe) : « La littérature de science-fiction n'est pas nécessairement une littérature progressiste ni une littérature réactionnaire ; du reste, elle reflète l'idéologie des auteurs » (p. 141). Ici, Baudin fait une sorte de retour à l'idéologie comme mouvement de la SF (un peu trop timidement à mon avis), mais l'important est toutefois qu'il ait compris que la science-fiction, reflet et dépassement de la réalité, a un effet pédagogique sur ses lecteurs qui, grâce à elle, acquièrent une vision d'un monde tel qu'il devrait être et tel qu'il ne devrait pas être. L'auteur jette donc les bases d'une sorte de praxis de la SF et, bien qu'il n'aille pas jusque-là, on le sent prêt à défendre une sorte de militantisme qui pousserait les lecteurs à descendre dans la rue ! Je terminerai en signalant deux lacunes dans la « culture SF » de Baudin : l'une se rapporte à la politique-fiction, qui aurait eu une place toute trouvée dans son paragraphe consacré à la projection idéologique, l'autre à la new thing, dont la connaissance aurait permis à l'auteur d'enrichir son chapitre SF et littérature. Mais, malgré ses trous, un certain manque de rigueur dans la structure du livre et certains points mineurs qui m'ont semblé discutables et ont été discutés, l'ouvrage de Baudin est d'un apport largement positif. Son langage clair et élégant en rend la lecture aisée, et on sent constamment que l'auteur aime son sujet et est porté par un enthousiasme communicatif. Il est probable que Baudin ne lit pas l'anglais (ou n'a pas eu l'occasion de lire beaucoup d'œuvres non traduites), mais je gage qu'il a par contre lu tout ce qui est paru en France sous l'étiquette SF (Fleuve Noir compris, ce qui n'est pas si fréquent). Cette exhaustivité (nationale !) lui a permis d'aborder son sujet avec tout le recul désirable, et à lire Henri Baudin, on n'a pas du tout l'impression d'absorber un sec exposé universitaire mais, tout simplement, les « carnets d'un amateur de SF ». C'est, je crois, le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Denis PHILIPPE |
| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |