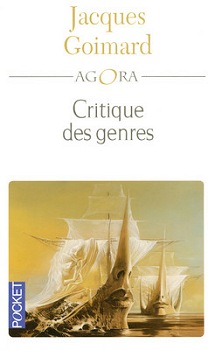|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Critique des genres
Jacques GOIMARD Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Agora  n° 252 n° 252 Dépôt légal : mai 2004 Recueil d'articles, 768 pages ISBN : 2-266-11857-9 ❌ Genre : Imaginaire
Quatrième de couverture
Quand La Fontaine écrit une fable et Racine une tragédie, ils se soucient d’observer les règles d’Aristote. Mais Aristote s’est seulement efforcé de décrire les genres littéraires tels qu’on les pratiquait en son temps. Jacques Goimard a allumé sa torche à la même flamme que les aristotéliciens d’aujourd’hui – Jean-Yves Tadié, Gérard Genette ou Tzvetan Todorov. Après avoir étudié les littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique, merveilleux et fantasy), il se penche à présent sur d’autres genres où l’auteur construit le vraisemblable en multipliant les indices : fiction historique (Dumas), d’aventures (Stevenson) ou policière. Il montre comment Nagisa Oshima se situe par rapport aux bienséances et comment les cinéastes viennois dispersés ont fini par se retrouver presque tous à Hollywood où ils ont fait école ; comment le public des théâtres du Boulevard du Crime avait en commun avec les lecteurs de romans-feuilletons le désir d’éprouver le « grand frisson ». Dans ce volume s’agite, vit et s’exprime tout un univers formé de mille mondes.
Critiques
Après avoir abordé, dans ses recueils d'articles, la science-fiction, le fantastique et la fantasy, Jacques Goimard réunit ici divers écrits touchant à la critique des genres. La notion de genre est ici surtout abordée à travers le cinéma mais permet d'esquisser des propositions pour la constitution d'une taxinomie digne d'un intérêt scientifique, à l'image des travaux menés par Propp sur les contes. Considéré comme pauvre par rapport au reste de la littérature, leur classement typologique ou thématique des genres finit par révéler une épaisseur qu'on ne leur soupçonnait pas ou de considérer la question à partir de l'effet recherché. C'est essentiellement à une étude en même temps qu'une défense et illustration des genres populaires que se livre ici Goimard. Sont successivement abordés le mélodrame, le roman feuilleton, le roman historique (Les Trois Mousquetaires de Dumas se taille la part du lion) et d'aventures (notamment avec Stevenson), la fiction policière et ses multiples visages. La science-fiction n'est présente qu'à travers deux brefs articles sur la nouvelle brève et les livres-univers (à propos de Laurent Genefort). Ces genres pris dans leur ordre d'apparition chronologique, opposés au roman réaliste, montrent une progression de la dilution du vraisemblable qui semble être le véritable territoire de lutte entre la culture classique et moderne. Divers articles, regroupés dans une partie intitulée Sous-ensembles éphémères dans le flot de l'espace-temps regroupent des écrits plus datés dans le temps sur la production cinématographique concentrée à Hollywood, dispersée avec les cinéastes viennois, censurée à travers l'œuvre d'Oshima (L'Empire des sens) et sur la BD francophone, autre genre populaire multiforme. On y voit Goimard s'insurger contre les décisions de la commission paritaire qui menaçaient à l'époque les revues comme Pilote et À suivre. Les articles appartenant trop nettement à une période historique donnée ne représentent pas un problème en soi : ils permettent au contraire de suivre l'évolution d'un genre à travers le temps ; mais le déséquilibre entre les diverses parties, trop ou pas assez développées, donne de l'ensemble une image plus disparate. On aurait aimé que cette réflexion qui se poursuit sur plusieurs décennies et à travers maints sujets fût plus structurée. A noter cependant un important index et un début de constitution de l'imposante bibliographie de Jacques Goimard, dispersée dans d'innombrables supports. Claude ECKEN (lui écrire) Après Critique de la science-fiction, Critique du fantastique et de l'insolite, et Critique du merveilleux et de la fantasy, Jacques Goimard boucle ici ses « Univers sans limites ». Ces essais compilent les articles, préfaces, publications universitaires et diverses de ce grand spécialiste de la SF. Ce dernier tome s'écarte des chemins familiers des amateurs de littératures de l'imaginaire puisqu'il s'attarde, via le thème fédérateur de la notion de genre, sur tout ce qui n'a pas été traité dans les volumes précédents. Cinéma, bande dessinée, romans policiers et d'aventures, analyses thématiques des Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas se retrouvent donc pêle-mêle dans cet ouvrage où les chapitres se suivent et ne se ressemblent pas. Par leur ton, tout d'abord. Si la première partie, qui explicite longuement la notion de genre — se référant inévitablement à la théorie d'Aristote — est très universitaire, les préfaces des recueils « Histoires de... » du Livre noir du crime sont plus enjouées. L'auteur montre cependant une grande cohésion dans ses réflexions, et l'on sent au fil des pages des idées lancinantes qui reviennent, à chaque fois plus fouillées ou abordées sous un angle différent. S'il aborde bel et bien au détour d'une phrase des oeuvres qui relèvent de notre genre de prédilection, la SF, Jacques Goimard nous rappelle ici que nous sommes aussi des amateurs de littérature tout court, et qu'elle a de multiples visages... Ce livre parfois aride mais à vrai dire passionnant peut donc se lire de bout en bout ; il incite cependant, de par ses index minutieux, à papillonner d'un sujet à un autre ; et il donne envie de se replonger dans Dumas, Stevenson, et bien d'autres maîtres encore. Marie-Laure VAUGE |
| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |