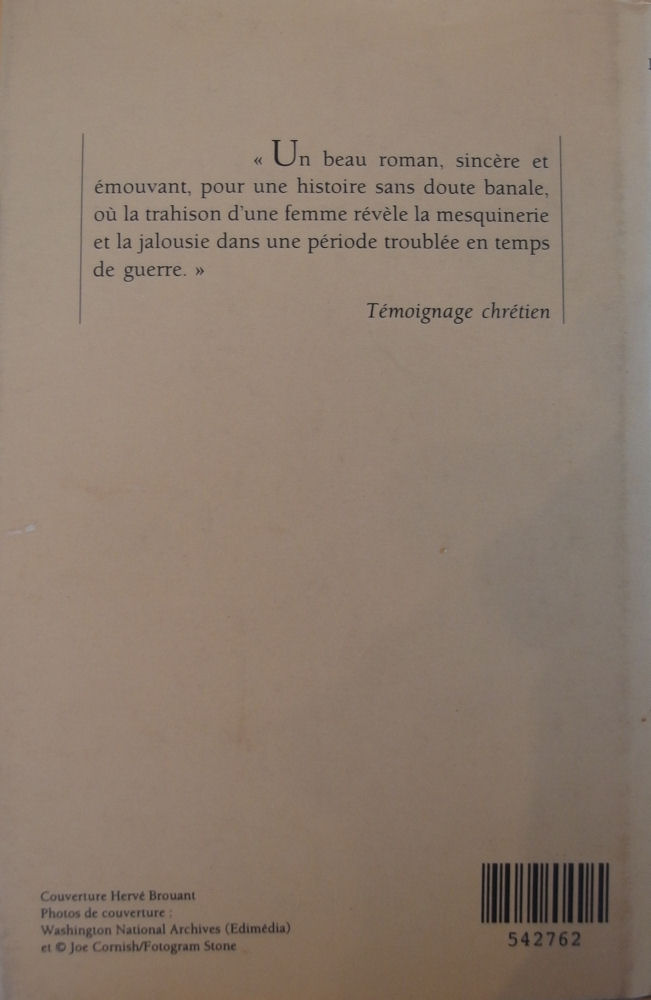|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
L'Ombre d'un soldat
Francis BERTHELOT Cycle : Le Rêve du démiurge  vol. 1 vol. 1  Illustration de Hervé BROUANT FRANCE LOISIRS (Paris, France) Dépôt légal : mai 1995, Achevé d'imprimer : mai 1995 Roman, 210 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7242-8532-8 ✅ Genre : Fantastique Photographies de couverture : Washington National Archives (Edimédia) et © Joe Cornish / Fotogram Stone.
Autres éditions
DENOËL, 1994 in Le Rêve du Démiurge, l'intégrale - 1/3, DYSTOPIA (association), 2015
Quatrième de couverture
« Un beau roman, sincère et émouvant, pour une histoire sans doute banale, où la trahison d'une femme révèle la mesquinerie et la jalousie dans une période troublée en temps de guerre. » [textes des rabats de couverture] La veille de Noël 1952, à Montaiguière, petit bourg de la Drôme où l’existence paraît douce et tranquille, un petit garçon de sept ans, Olivier, fait trois découvertes : la neige, en un instant, rend son village méconnaissable. Qu’y a-t-il derrière les apparences ? Puis le cadeau qu’on a déposé pour lui au pied du sapin : un pantin “hussard” qui va l’inciter à regarder là où c’est interdit. Il découvrira alors le vrai secret de sa mère : un crâne nu, véritable vision de cauchemar pour lui qui est fou de sa magnifique chevelure. Francis Berthelot est né à Paris en 1946. Polytechnicien, docteur ès sciences, il poursuit au C.N.R.S. des recherches en narratologie. Il a publié quatre romans de science-fiction dont le dernier, Rivage des intouchables, a obtenu le Grand Prix de la science-fiction française 1991. Il est également l’auteur d’un essai, La Métamorphose généralisée. Critiques des autres éditions ou de la série
Avec L'Ombre du soldat, paru en 1994, Francis Berthelot semblait tourner le dos aux littératures de l'Imaginaire pour se lancer dans celle dite « blanche » ou « générale ». Quelque dix ans plus tard, cette démarche n'apparaît plus comme un « abandon » ni comme un « nouveau départ » mais comme l'aboutissement logique d'une démarche personnelle de l'auteur, commencée avec sa participation au groupe Limite — un mouvement qui, dans les années 1980, se proposait d'abolir les frontières entre les différentes formes de littérature. En effet, Francis Berthelot a développé au fil des années le concept de « fiction transgressive » qui tend à regrouper des œuvres aux limites des genres et du mainstream, des livres auxquels il est habituellement difficile d'apposer des étiquettes — notion à distinguer de la « fusion », où plusieurs genres sont amalgamés (SF, fantastique, polar, Histoire...) mais avec un relatif respect des codes de chacun de ces genres. Ainsi, si L'ombre d'un soldat est un roman « réaliste », il constitue finalement la première pierre d'un cycle de « fiction transgressive » globalement intitulé « Le Rêve du démiurge » où « malgré le quasi-réalisme de son univers — l'Europe des années 1950 à 2000 — , le surnaturel fait sans cesse irruption ». Pour le savoir, il aura presque fallu attendre une décennie et la sortie de Nuit de colère, le cinquième roman d'une série qui devrait en comporter neuf au total. L'auteur y explicite enfin son projet dans une brève note de fin d'ouvrage, alors que le nom du cycle n'apparaît dans aucun de ses romans — publiés chez trois éditeurs différents et qui, soulignons-le, peuvent être lus de façon tout à fait indépendantes, seuls quelques personnages tissant un lien ténu entre les différents volumes. Mais venons-en à l'histoire de L'Ombre du soldat. Il s'agit d'un drame qui met en scène le difficile passage de l'enfance à l'adolescence — de sept à quinze ans - d'un garçon qui souffre d'un secret que lui dissimulent les adultes du petit village de Montaiguière. L'intérêt du récit ne réside cependant pas dans la résolution de ce mystère caché dont la nature sera vite éventée par le lecteur, et à peine moins rapidement par le jeune Olivier — même s'il aura, lui, besoin d'une explication adulte pour pleinement concevoir ce qu'il a déjà pressenti. Ce secret, c'est tout simplement qu'une femme — sa mère — est tombée amoureuse d'un soldat de l'autre camp durant la Seconde Guerre Mondiale : « le genre d'affaire qui traîne dans tous les livres d'Histoire » (p.72) Plus qu'à la découverte de cette vérité somme toute « ordinaire », Berthelot s'intéresse aux séquelles de cette idylle « fautive », d'une part chez ceux qui l'ont vécue, mais surtout chez l'enfant qui pourtant l'ignore : l'ombre de ce soldat inconnu étouffe le jeune Olivier sans que celui-ci comprenne encore la nature de son angoisse... A l'évidence, L'Ombre du soldat est solidement ancré dans le réalisme : le « dérapage contrôlé vers le fantastique » n'est d'ailleurs annoncé officiellement qu'à partir de Mélusath, troisième roman du cycle. Pourtant, les lecteurs qui aiment naviguer aux franges du mainstream et qui s'attachent moins aux étiquettes qu'à la qualité du récit et de l'écriture sauront apprécier ce roman qui, à partir d'une thématique classique, évoque un conte ambigu d'où le surnaturel n'est pas tout à fait absent... En effet, dès les premières pages, l'atmosphère est inquiétante, suscitant un malaise proche de celui que procure le fantastique : « Le nouveau visage de Montaiguière n'a rien d'affable : pétrifié, glacial, ancré dans le mutisme, peuplé de choses invisibles qui, par leur absence même, deviennent menaçantes. » (p.16) De même, le rapport de l'enfant à la réalité fait souvent appel à l'imaginaire : « Il voudrait que les histoires vraies soient fausses ; et les fausses, vraies. Que les contes de fées, avec leur bimbeloterie de monstres et de princesses, deviennent la réalité de Montaiguière. » (p.39) Mais cet espoir sera déçu car il trouvera « le lien entre les contes de fées et le monde réel (...) La cruauté. » (p.91) C'est sur cet amer constat qu'Olivier passe de l'univers irrationnel — et ici inquiétant — de l'enfance vers celui de l'adulte — un passage qui répond peut-être à celui de l'auteur de SF vers l'auteur de littérature générale, abandonnant lui aussi l'habillage de l'imaginaire pour une réalité plus nue et plus crue ? Mais Olivier n'y arrive pas seul ; il a besoin de l'assistance d'un hussard de bois qui lui sert d'abord de confident et de conseiller, avant de devenir une voix intérieure récurrente. Là encore, le fantastique n'est pas loin, même si une explication rationnelle peut être apportée à cette obsédante présence, d'abord par le seul jeu de l'enfant, ensuite par la probable dérive schizophrénique de l'adolescent. Pourtant la lecture a posteriori de Mélusath — où un génie sortira d'une peinture pour prendre chair — n'interdit pas une réinterprétation purement surnaturelle du rôle du jouet soldat. Mais ce qui est vraiment fantastique, n'est-ce pas l'absurdité de ce drame, de ces vies brisées par des événements pourtant bien antérieurs, de cette guerre inconcevable qui a précipité le vingtième siècle dans une horreur bien pire que toutes celles imaginées par les auteurs de gore et qui a ensuite laissé planer son ombre sinistre sur les cinquante années qui lui ont survécues ? « L'horreur qui le submerge est d'un ordre qu'il n'avait jamais rencontré. Une araignée noire. Abstraite. Immortelle. Capable d'infiltrer ses pattes dans des millions d'âmes. » (p.103) Une « horreur abstraite », quasi-impossible à appréhender, mais qui a pourtant fait d'innombrables victimes, même à distance. Des victimes comme Olivier, si incompréhensiblement meurtries qu'elles ne pourront plus jamais vivre de façon « normale ». Ces séquelles font l'objet de l'une des interrogations centrales du roman : « De l'innocent ou du coupable, il voudrait bien savoir, en fin de compte, lequel est réellement un monstre. » (p.142) Une interrogation sur laquelle l'auteur reviendra plusieurs fois, notamment dans Nuit de colère. Les lecteurs exclusifs de science-fiction préféreront sans doute Rivage des intouchables ou La Ville au fond de l'œil. Ceux qui ne jurent que par la Fantasy adopteront Khanaor sans se faire prier. Mais pour ceux qui ne s'en tiennent pas à ces limites, L'Ombre d'un soldat permet de retrouver le charme du style et des personnages de Berthelot au sein d'une fresque contemporaine qui doit beaucoup à la tragédie classique. Ce récit, malgré l'apparente simplicité de son argument initial, s'avère profondément marquant ! Pascal PATOZ (lui écrire) |
| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |