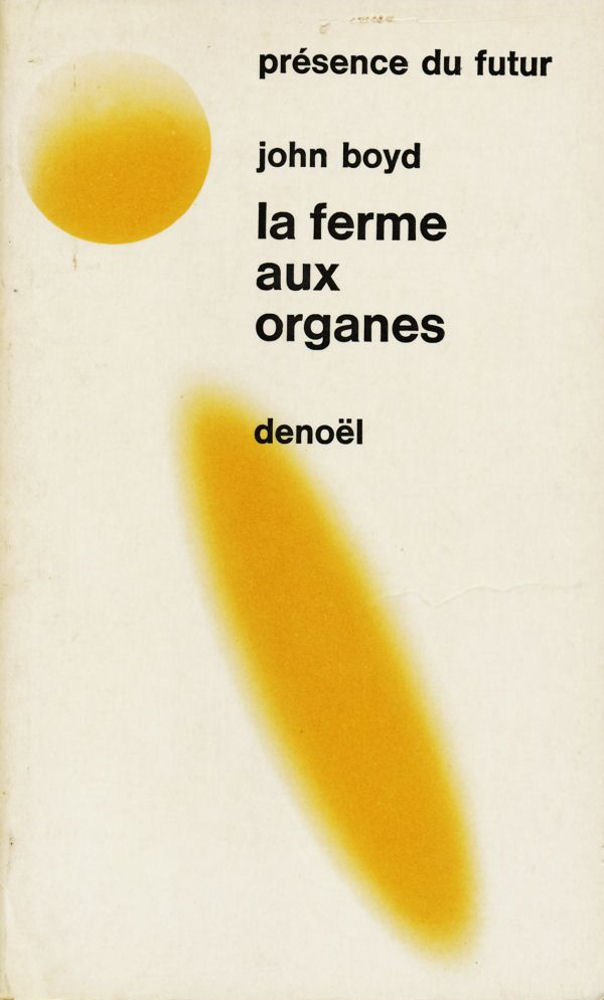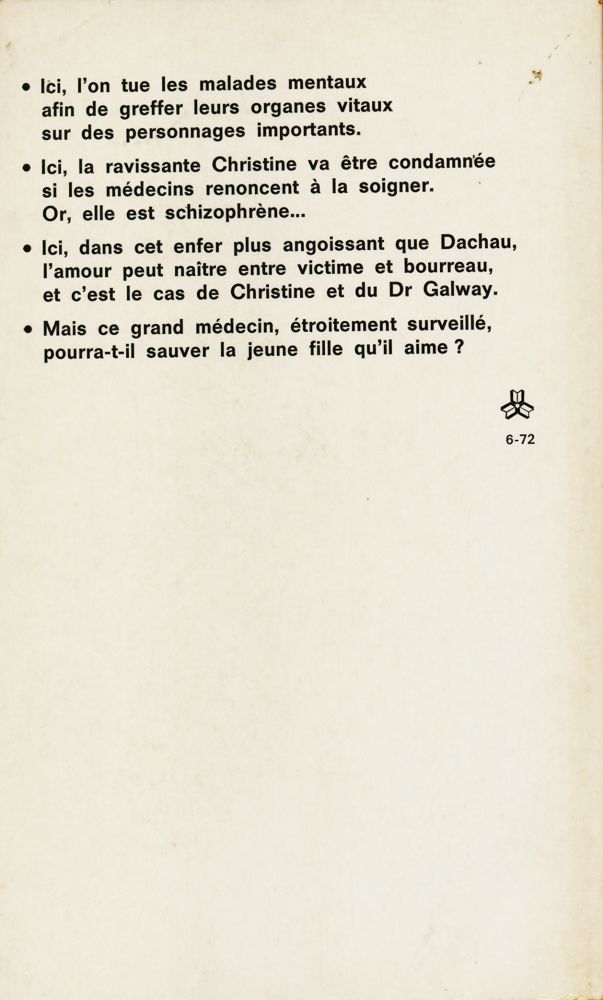|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Ferme aux organes
John BOYD Titre original : The Organ Bank Farm, 1970 Première parution : Philadelphie, U.S.A. : Weybright and Talley, 1970 ISFDB Traduction de Claire POOLE DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 147-148 n° 147-148 Dépôt légal : 2ème trimestre 1972, Achevé d'imprimer : 22 mai 1972 Première édition Roman, 288 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
• Ici, l'on tue les malades mentaux afin de greffer leurs organes vitaux sur des personnages importants.
• Ici, la ravissante Christine va être condamnée si les médecins renoncent à la soigner. Or, elle est schizophrène...
• Ici, dans cet enfer plus angoissant que Dachau, l'amour peut naître entre victime et bourreau, et c'est le cas de Christine et du Dr Galway.
• Mais ce grand médecin, étroitement surveillé, pourra-t-il sauver la jeune fille qu'il aime ?
Critiques
La ferme aux organes, quatrième roman traduit en français de John Boyd, ne fera probablement pas changer d'avis ses nombreux détracteurs. « Exemple de faux talent gonflé », écrivait il y a quelque temps dans sa chronique mon confrère et néanmoins adversaire Serge-André Bertrand. Si Boyd a véritablement été gonflé, c'est ici même dans Fiction, par Jean-Pierre Andrevon (Dernier vaisseau pour l'enfer et Lysistrata 80 : n° 217) et par moi (La planète fleur : n° 221). Ce qui prouve bien que toutes les opinions ont cours dans notre éclectique revue.
Mais Boyd n'a pas besoin d'être gonflé. !i va au contraire son petit bonhomme de chemin, sans jeter de grands éclats, il est vrai qu'il se situe dans une voie médiane, qui le met en porte — à-faux par rapport aux deux grands courants qui se partagent aujourd'hui les lecteurs de SF : celui des traditionalistes, celui des modernistes. On ne trouve pas trace de space-opera parmi les Boyd connus chez nous, et si ses thèmes sont bien contemporains {guerre mondiale III, société totalitaire, critique du pouvoir et de la bureaucratie), ainsi que certains des ingrédients qu'il utilise (audaces en matière sexuelle), il ne va pas assez loin dans ces directions pour rameuter les fans de la new thing. D'autre part, son écriture très classique, son style de narration basé sur une rigoureuse chronologie, ainsi qu'un recours constant à la psychologie comme élément moteur des personnages, font qu'il se situe aux antipodes d'un Ellison ou d'un Zelazny. Placé ainsi entre deux chaises, Boyd irrite « à gauche comme à droite » — ces notions étant ici toutes relatives et peu politiques. Si des comparaisons devaient être tentées, je placerais cet auteur dans la lignée des Asimov, des Kuttner, de certains Heinlein, à cause du sérieux apporté à l'élaboration de la partie scientifique et sociale de ses romans, qui leur donne certes un côté pesant. Mais ce côté est combattu par l'humanité et l'humour dont sont dotés les personnages...
La ferme aux organes décrit un « après » situé aux environs de l'an 2000, et qui n'a pas surgi des foudres atomiques mais d'une banale maladie virale. (« Le cataclysme mondial que l'humanité redoutait depuis Hiroshima et attendait depuis Eniwetok débuta de façon ridicule par des rhumes, des maux de tête et une légère augmentation de l'absentéisme » : p. 9) Etendue à toute la Terre et causée sans doute par une arme biologique expérimentale ayant échappé à tout contrôle (« On parlait de menées des Rouges, on accusait les Chinois. Mais les Rouges mouraient avec les Blancs, les Noirs avec les moins noirs, et les Chinois demandaient des bulldozers pour pouvoir enterrer leurs cadavres » : p. 10), l'épidémie laisse, au bout de sept ans, un globe qui pleure huit milliards de victimes mais compte tout de même, la surpopulation aidant, trois milliards de survivants. Ce qui est beaucoup et permet à la Terre d'échapper à un âge sombre tel que celui décrit par Edmund Cooper dans Le jour des fous, par exemple. Au contraire, la situation s'est même par certains côtés améliorée. (« Mais cette perte quantitative avait rehaussé la qualité de la vie. Les autoroutes se déroulaient sur des kilomètres, entièrement vides, sous un ciel que ne salissaient plus les traînées des jets. Les fleurs remplissaient à nouveau l'air de leurs parfums, le printemps ramenait les chants d'oiseaux, les ruisseaux gazouillants et limpides se jetaient dans des rivières non polluées » : p. 11).
A l'intérieur de ce tableau, rapidement brossé dans les trois premières pages du livre, s'insère l'aventure personnelle du docteur James Galway, neurologue spécialisé dans la rééducation d'enfants souffrant du « trauma de la mort ». Car l'hécatombe a eu des effets, des « retombées », sur le psychisme des jeunes êtres exposés dans les premières années de leur vie (ces années dont on sait maintenant qu'elles fixent de manière décisive le comportement et la personnalité pour toute une vie) à l'environnement cataclysmal. Beaucoup d'entre eux sont devenus aphasiques, autistiques. C'est-à-dire qu'ils souffrent de la perte totale ou partielle de la fonction verbale, qu'ils sont détachés du monde extérieur et vivent repliés sur leur univers interne.
Le docteur Galway est atteint d'un fort complexe de culpabilité, parce qu'il a autrefois travaillé sur des préparations virales et croit être un des responsables de la catastrophe — bien que Boyd n'explicite jamais clairement ce qu'il en est en réalité. Mais le neurologue, qui veut se racheter en soignant des enfants psychotiques, a mis au point une thérapie basée sur des stimuli cérébraux engendrant toute une série de réactions allant du plaisir à la douleur. C'est au titre de ces expériences qu'il est nommé, par le « Département de la Santé, de l'Education et de la Protection sociale », dais un établissement californien, Paradise Valley, en vérité une petite ville où sont soi-disant traités les enfants anormaux. Réticent au départ, Galway accepte te poste quand il apprend que le directeur du Centre est un vieil ami à lui, Bob English, et que ce dernier lui lance un véritable S.O.S. codé.
Une fois à Paradise Valley, Galway se rend compte que l'endroit n'est rien d'autre qu'une « banque d'organes », où les enfants, rapidement classés incurables, sont mis en hibernateurs en attendant que leur cœur ou leur foie servent pour effectuer des transplantations sur des sénateurs ou autres pontes du Gouvernement ou de l'industrie cancéreux ou cardiaques,.. C'est dans cet endroit à la fois aseptisé, calme et, sous cette surface trompeuse, cauchemardesque, où de nombreux soignants ou fonctionnaires sont en réalité des agents de la C.I.A., et où le comportement futur de tout le personnel a été mis en cartes perforées par l'O.A.C. (Ordinateur pour l'Analyse du Comportement), que Galway va lutter pour guérir un groupe d'enfants, afin de les arracher au sort horrible qui les attend. En fait, la présence de Galway au Centre sert en quelque sorte de caution morale à ceux qui en assurent la véritable fonction. Le neurologue s'éprend lui-même d'une jeune schizophrène de seize ans, Christine Haskell, qui vit dans un Moyen Age mythique, mais qu'il parvient tout de même à guérir, malgré tous les obstacles dressés en travers de son action. Victoire d'ailleurs plus qu'ambiguë puisque ni Galway ni Christine ne survivent, bien que... Mais ce serait déflorer le suspense et la pirouette finale que de dire ce qu'il advient en fin de compte de ces deux sympathiques héros.
Tout le roman est basé sur la description minutieuse de la vie à Paradise Valley (avec les rapports souvent tendus entre soignants, l'existence collective sexualisée à l'extrême) et des expériences neuro-psychologiques de Galway. Cette concentration d'événements éthiques et médicaux en vase clos fait la force de l'ouvrage et, d'une certaine façon peut-être, sa faiblesse. Sa faiblesse, car il pourra sembler long, aride et confus à beaucoup ; j'ajoute que — ce n'est pas mon cas. Sa force, car il fallait tabler sur le réalisme et sur la mise en valeur de la notion de « temps » pour mener à bien une telle entreprise. On retrouve dans cette cité aux organes le même climat, presque le même décor et les mêmes personnages que dans le Département des Plantes exotiques de La planète Fleur, mais ces éléments sont ici distribués avec plus de rigueur, et le sempiternel conflit entre la Science en marche et le Pouvoir sclérosé, autoritaire et inhumain, est mieux intégré, moins caricatural que dans l'ouvrage précédent.
D'autre part, il paraît indéniable que Boyd « bûche » avec sérieux les sujets qu'il traite. De même qu'il avait su rendre intéressantes les longues digressions botaniques de La planète Fleur, tout ce qui a trait ici aux opérations neurologiques et aux traitements psycho-psychanalytiques paraît extrêmement vraisemblable. La lente découverte, par Galway, du traumatisme initial qui a fait de Christine une autistique, est tout à fait admirable :
« Galway se représentait très bien le bébé couché auprès de la masse, pareille à une montagne, de sa mère. Celle-ci s'était tournée vers lui, dans son sommeil ou dans un élan de tendresse. Un sein avait balayé les narines du nourrisson qui avait gigoté pour essayer de se libérer, peut-être en mordant sa mère jusqu'au sang (le vin de l'agneau) et en poussant ces hurlements d'angoisse qu'un adulte confond avec de la rage. La mère l'avait alors frappé et, dans l'imagination de l'enfant, ces seins étaient devenus des montagnes avec des sources qui pouvaient le noyer (l'étouffer) dans sa couche. L'allaitement était devenu un combat entre la faim et la peur, l'amour et la haine » (p. 202).
Et le traitement de choc de ce « traumatisme mammaire » n'est pas moins ingénieux, qui permet à Boyd, tout en restant dans le domaine sexuel où il se sent tellement à l'aise (mais en rejoignant Freud et en abandonnant ses habituelles plaisanteries salaces), de trouver une émotion neuve :
« Prestement, il emprisonna sa nuque de son bras droit. A nouveau, ses lèvres trouvèrent le sein.
Elle chercha à se libérer, sans toutefois lutter avec assez d'énergie pour lui dérober ce sein. Galway pouvait sentir le combat qui se livrait dans son esprit entre Eros et Thanatos et, par ses lèvres, il sut qu'Eros était en train de l'emporter. Peu à peu, elle 's'apaisa. (...)
Il se mit à sucer le sein et Christine se pencha un peu plus pour lui offrir une meilleure prise. (...) Avec stupéfaction, il constata que ces méthodes surannées avaient réussi à éveiller ses instincts maternels bien plus rapidement que la technologie » (p. 108).
Captivant, La ferme aux organes se termine tout de même par un point d'interrogation quant à la véritable personnalité de John Boyd ou, pour être plus clair, son idéologie. Si la science, dans ce qu'elle peut avoir de néfaste, est bien mise en accusation, c'est elle néanmoins qui permet la résurrection finale, et si l'ordre, quand il fonctionne mal, est dénoncé, un autre ordre, qui serait porteur d'harmonie, a toute la sympathie de l'auteur. D'autre part, la société dont il dénonce les tares n'est jamais mise en cause de manière globale, comme le fait par exemple Spinrad dans Bug Jack Barron. Alors cet ancien officier de marine, dont l'humour un peu forcé semble parfois être une technique de distanciation, est-il un homme de droite qui écrit à gauche ou un homme de gauche qui écrit à droite ?... Il nous importe peu de le savoir pour l'instant, son talent étant une garantie suffisante pour que nous puissions apprécier les portraits cliniques qu'il nous brosse d'une Amérique bien proche.
Denis PHILIPPE |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |