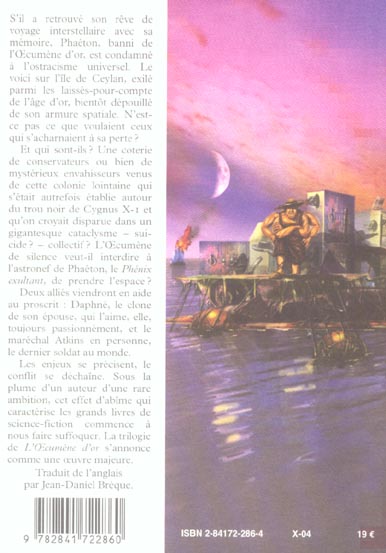|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Phénix exultant
John C. WRIGHT Titre original : The Phoenix Exultant: or, Dispossessed in Utopia, 2003 Première parution : New York, USA : Tor Books, Avril 2003 ISFDB Cycle : Âge d'or (trilogie de l')  vol. 2 vol. 2  Traduction de Jean-Daniel BRÈQUE Illustration de Gilles FRANCESCANO L'ATALANTE (Nantes, France), coll. La Dentelle du Cygne   Date de parution : 27 octobre 2004 Dépôt légal : octobre 2004 Première édition Roman, 352 pages, catégorie / prix : 19 € ISBN : 2-84172-286-4 Format : 14,5 x 20,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
S'il a retrouvé son rêve de voyage interstellaire avec sa mémoire, Phaéton, banni de l'Œcumène d'or, est condamné à l'ostracisme universel. Le voici sur l'île de Ceylan, exilé parmi les laissés-pour-compte de l'âge d'or, bientôt dépouillé de son armure spatiale. N'est-ce pas ce que voulaient ceux qui s'acharnaient à sa perte ?
Et qui sont-ils ? Une coterie de conservateurs ou bien de mystérieux envahisseurs venus de cette colonie lointaine qui s'était autrefois établie autour du trou noir de Cygnus X-i et qu'on croyait disparue dans un gigantesque cataclysme — suicide ? — collectif ? L'Œcumène de silence veut-il interdire à l'astronef de Phaéton, le Phénix exultant, de prendre l'espace ?
Deux alliés viendront en aide au proscrit : Daphné, le clone de son épouse, qui l'aime, elle, toujours passionnément, et le maréchal Atkins en personne, le dernier soldat au monde.
Les enjeux se précisent, le conflit se déchaîne. Sous la plume d'un auteur d'une rare ambition, cet effet d'abîme qui caractérise les grands livres de science-fiction commence à nous faire suffoquer. La trilogie de L'Œcumène d'or s'annonce comme une œuvre majeure.
Critiques
[Chronique commune aux tomes 2 Le Phénix exultant et 3 La Haute Transcendance du cycle] La trilogie dont les livres, objet de cette chronique, constituent les tomes second et dernier, est une œuvre complète qui doit se lire dans l'ordre. Ceux qui n'ont pas jeté l'éponge à la lecture du premier tome, L'Œcumène d'or (cf. critique in Bifrost n°35), sont armés pour affronter les suites. Quant aux autres, rebutés par l'abord rébarbatif induit par l'ambition de John C. Wright, on ne peut que les inviter à faire une nouvelle tentative pour pénétrer ce futur lointain tant le jeu en vaut la chandelle, car cette « Geste de l'avenir lointain » est un défi lancé à tout amateur véritable de science-fiction. Le challenge n'est pas tant littéraire que conceptuel, car Wright pose là un nouveau jalon dans l'élaboration imaginaire de l'avenir et, qui plus est, en propose une vision matérialiste. La société qu'il dépeint est la projection la plus lointaine possible à l'aune de notre XXIe siècle naissant. Il va sans dire que ceux qui ne trouvent pas leur bonheur chez John Varley ou Greg Egan peuvent passer leur chemin. Ce que j'ai pu écrire concernant le premier tome reste pertinent pour ces suites ; mais elles ne demandent pas d'effort supplémentaire. Comme dans la plupart des trilogies qui nous sont données à lire, le deuxième tome, Le Phénix exultant, est un livre de transition offrant un intérêt moindre que les deux autres. On y retrouve Phaéton subissant sa peine d'ostracisme qui n'est pas sans rappeler « Voir l'Homme invisible », la nouvelle de Robert Silverberg. Envers et contre tous, il parviendra, grâce à Daphné Tercius, la copie de son ex-femme, et au maréchal Atkins, le dernier soldat du monde, à récupérer le Phénix Exultant, son merveilleux astronef, tout en ayant su conserver sa précieuse armure. Le troisième tome est celui du dénouement où tombent les masques — d'où le double sens du sous-titre, La fin de la mascarade — comme des pelures d'oignon. Et désormais, c'est la guerre. Une guerre où des batailles sans merci ne durent que quelques microsecondes et s'étendent des dizaines de millions de fois en temps de lecture. La trilogie reste quelque peu verbeuse, incontournable défaut inhérent à un projet où Wright est contraint de nous abreuver de concepts futuristes et de néologismes indispensables pour mettre à la portée de nos pauvres intellects humains dépourvus d'extensions de l'aube de la 3e structure mentale ce que peut être la 7e. Et notons que pour une neuroforme basique — c'est-à-dire un humain pourvu d'extensions intellectuelles — , la pensée des sophotechs est aussi inaccessible que si l'on vous faisait affronter un de nos supercalculateurs contemporains en calcul mental. Pour avoir une autre idée de la technologie de « L'Œcumène d'or », il faut comparer la quantité d'énergie solaire que nous utilisons face à une civilisation qui serait en passe de l'utiliser en totalité et qui aurait commencé à construire à cette fin une sphère de Dyson. Peut-être un ordre de 1020. La vitesse de la lumière reste quant à elle une barrière infranchissable, qui permet d'étalonner cette histoire du futur. Ainsi, l'Œcumène du Silence, unique colonie stellaire établie autour du trou noir Cygnus X1, est-il distant de 10 000 années-lumière. Ce qui positionne l'ère de la 7e structure mentale à plusieurs dizaines de millénaires dans l'avenir, voire 100 000 ans... A l'instar de L'Orbe et la roue de Michel Jeury, la trilogie de « L'Œcumène d'or » de John C. Wright est l'une des très rares anticipations à très long terme qui en joue le jeu. Jamais encore on n'avait osé pareille spéculation sur le futur lointain de l'humanité sans implication métaphysique. Franz Werfel ou Olaf Stapledon n'ont pas vraiment abordé le problème sous le même angle. En règle générale, la S-F est comme prise de vertige face à l'avenir lointain. Quasiment toujours, le space opera, dont c'est le domaine de prédilection, renvoie à des modèles sociaux — et militaires — issus du passé. Wright n'a pas réellement élaboré un futur profond. Il a poussé dans l'avenir, de manière aussi cohérente que possible, la matière technique et sociale des spéculations sur le futur proche, dont des auteurs tels que Greg Egan font leurs choux gras. Son matériel spéculatif est essentiellement constitué d'intelligence artificielle, de science cognitive, de réalité virtuelle et de nanotechnologie, avec un zeste de quanta et de trous noirs pour compléter le paysage. Il est resté dans une approche hard science, n'a pas transigé avec les impossibilités physiques comme bien souvent se le permet le space opera, transformant l'espace en océan et la Galaxie en Far West. Par contre, il a shunté les limites du vivant et l'immortalité est de rigueur. Ainsi considéré comme de l'information, un esprit peut être immortel et affronter un voyage de 10 000 années-lumière ; d'autant qu'aux vitesses relativistes, il semblera bien plus court à ses passagers. Il ne s'agit ici nullement de minimiser le remarquable travail de John C. Wright mais, au contraire, de montrer par quelle méthode, en apparence, la seule pertinente, il a relevé et gagné le défi littéraire que représente l'imagination du futur lointain, inscrivant la trilogie de « L'Œcumène d'Or » au rang d'indéniable chef-d'œuvre. Ceux qui craindraient malgré tout l'ambition et l'envergure de la spéculation proposée ici ont aussi désormais la possibilité de s'essayer à la fantasy de John C. Wright (chez Calmann-Lévy). Avec Jeffrey Ford, John C. Wright est l'auteur le plus intéressant apparu en France depuis Greg Egan. On déplorera l'absence d'une récompense majeure pour une œuvre qui a réussi à renouveler le genre non avec du vieux, mais avec de l'actuel. Une trilogie incontournable. Jean-Pierre LION Quels que puissent être par ailleurs les qualités de ce roman de John C. Wright, ce n'est pas la lisibilité qui le caractérise en priorité. Lorsque l'humanité, sous la pression de l'exploration et de la terraformation du système solaire, s'est diversifiée au point que les « neuroformes basiques » doivent coexister avec des « neuroformes d'alterorganisation », des « neuroformes cérébellines », des « neuroformes à intégration corticothalamiques » et des « compositions à esprit de masse », quand le clonage corps-esprit et la maîtrise des nanomatériaux réparateurs a donné accès à l'immortalité, que l'intelligence artificielle a donné vie à des « entités conscientes électrophotoniques », les sophotechs, et a ouvert une porte vers de nouveaux niveaux de réalité, quand enfin les neurosciences ont progressé au point que l'on peut soi-même altérer ses états de conscience et calculer son degré d'émotivité en fonction des circonstances, il n'est guère surprenant de voir le monde devenir quelque peu compliqué, pour ne pas dire sibyllin. Ajoutez à cela que l'auteur se soucie davantage de nous immerger dans ladite complexité que de nous en donner les ficelles, et vous commencerez à entrevoir le tableau. Allez, un exemple pour la bonne bouche. « La personne présente s'identifie comme étant Vulpin Premier Joie-de-Fer, neuroforme basique avec extensions invariantes non-standard, sans composition ni école. Accompagné de Lester Néant Haaken, basique, éjecté d'un partenariat mental limité et non hiérarchique, l'école de la Réforme du meurtre rituel, d'une part, et de Drusillet Zéro Autoâme, neuroforme sous-cérébelline verrouillée en personnalité multiple, auto-école, d'autre part ». Encore un petit pour la route ? « Lors d'une séance d'apothéose sensorielle, le consommateur doit suractiver ses circuits en rêve médian, désactiver ses inhibiteurs et ouvrir les fichiers de son filtre sensoriel à toutes les sensations entrantes ». Comme toujours face à ce type de prose, deux réactions sont possibles : la fascination devant l'étrangeté d'un monde qui s'offre comme un Tout cohérent et ne s'abaisse jamais à se rendre accessible, ou l'agacement devant un style jargonnant, qui semble s'écouter enfiler à l'envi les mots de plus de dix lettres, ou s'efforcer de rendre fou le correcteur orthographique du traitement de texte. L'histoire, quant à elle, est paradoxalement (heureusement, peut-être) assez linéaire. Le héros, Phaéton, a beau être mis au ban de la société, coupé de la Mentalité et condamné à l'ostracisme universel (je vous avais prévenus), les flottis de la boutique mentale ont beau lui dérober l'armure de manorial qui lui fournit interfaceurs et nanomatériau (ben quoi ?), il peut bien être poursuivi par un étrange sophotech Rien, probablement issu de l'Oecumène de Silence, à moins qu'il ne relève d'un faux souvenir implanté par les Cacophiles via le rêve médian (oui ?), on ne doute que rarement de sa capacité à triompher encore et toujours de l'adversité. Ses ressources intellectuelles, ses acquis culturels, les capacités que lui donne son armure, l'amour qu'il porte à l'astronef qu'on lui a arraché, semblent en faire l'archétype du héros qui plie mais ne rompt pas. Pourtant, il ne faudrait pas en conclure que ce roman, cette trilogie, se contente de pontifier à grands coups de concepts abscons. Ce qui le sauve, c'est, tout d'abord, l'ironie mordante qui le traverse de part en part, et ensuite, l'extrême soin que prend l'auteur à enraciner les fantaisies de son univers dans la trame historique. L'ironie, d'abord. Le héros a beau être, de toute évidence, un être hautement cultivé et appuyé par les dernières technologies de pointe, il est aussi la proie d'une multitude de forces, réelles ou supposées, qui le manipulent aussi aisément qu'un enfant de cinq ans. Bien couillu, mais un peu couillon. Et parfois traversé d'éclairs de conscience qui lui permettent de s'en apercevoir, ce qui ne gâche rien. L'Oecumène d'Or a beau être la société la plus proche possible d'une utopie, selon ses propres dires, elle n'en a pas moins des défauts et des failles à faire frémir un Intouchable. Quant à l'auteur, il a beau enfiler les concepts avec toute l'aisance d'un vieux philosophe endurci, il ne manque pas de s'en amuser et de s'en faire la remarque, notamment à travers le personnage de Daphné, clone de l'épouse du héros, qui joue à ce titre un rôle révélateur. L'Histoire, ensuite. David Brin, dans la postface de la BD uchronique dont il signe le scénario, D-Day, le jour du désastre, soutient que la SF aurait dû s'appeler « spéculation historique », car c'est souvent davantage l'Histoire que la science dure qui lui donne sa spécificité. Voilà qui est symptomatique dans Le Phénix exultant. Par moment, en effet, le décalage entre l'Oecumène d'Or et notre réalité est si grand qu'on pourrait l'accuser de flirter avec la fantasy, notamment quand il met en scène des esprits collectifs qui ressemblent trait pour trait aux anciennes déités mythiques. Mais Phaéton, le passionné d'Histoire, est toujours là pour rattacher les ères, montrer pourquoi telle ou telle entité en est venue à exister. En somme, voici un roman qu'il vaut mieux éviter si l'on apprécie les histoires transparentes, où l'univers se dévoile peu à peu, avec son mode d'emploi et sa notice explicative. Et qu'il ne faut surtout pas rater si l'on aime se laisser séduire par la complexité, le foisonnement et l'étrangeté. Nathalie LABROUSSE (lui écrire) |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |