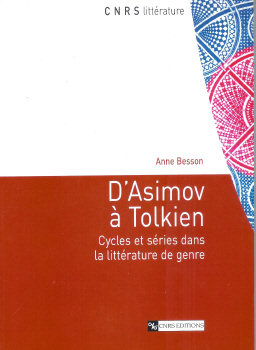|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
D'Asimov à Tolkien - Cycles et séries dans la littérature de genre
Anne BESSON CNRS , coll. CNRS littérature Dépôt légal : octobre 2004 Première édition Ouvrage universitaire, 256 pages, catégorie / prix : 24 € ISBN : 2-271-06277-2 ✅ Genre : Hors Genre
Quatrième de couverture
Harry Potter de Joanne K. Rowling, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien... Qui aujourd’hui, ne connaît pas un de ces ensembles romanesques à succès, florissant dans la littérature de genre ? Romans policiers, science-fiction, fantasy, des Cantos d’Hypérion à L.A. Quartet en passant par Fondation, tous ces genres nourrissent le questionnement d’Anne Besson. Un cycle, une série : comment les définir, les distinguer ? Dans le premier, la totalité des volumes prime, tandis que dans la seconde, chaque volume est indépendant. L’intrigue se développe au fur et à mesure dans l’un, elle est discontinue dans l’autre. Pour le bonheur du lecteur et l’enrichissement de la littérature, des croisements s’effectuent, se jouant des contraintes étroites. La conduite et l’expérience du lecteur, induites par ces caractéristiques formelles, sont aussi prises en compte. De ce point de vue, la chronologie joue un rôle décisif avec son réseau d’appels et d’annonces : elle propose une maîtrise idéale du temps. L'ouvrage pionnier d'Anne Besson, qui intéressera tant les amateurs que les lecteurs ouverts et curieux, associe agréablement la rigueur à une approche revigorante de la littérature : un livre invitant au dialogue et à un electure éclairée et vivante. Anne BESSON, ancienne élève de l’ENS-Fontenay St-Cloud, agrégée, docteur en Littérature Comparée, est Maître de Conférences à l’Université d’Artois (Arras), spécialisée dans les littératures contemporaines de genre et de grande diffusion.
Critiques
Qui pense encore que l'université française est sourde aux littératures de l'imaginaire ? Voici un essai qui les étudie avec ferveur et rigueur, et pas par le petit bout de la lorgnette : Anne Besson, maître de conférences en littérature comparée à Arras, ne s'est pas contentée d'une petite analyse timide, du bout des lèvres, mais a embrassé les cycles les plus vastes dans une thèse brillante dont ce livre est la version « grand public ». Les Cantos d'Hypérion, le cycle des Robots et celui de Fondation, le cycle de la Ligue de tous les mondes de Le Guin, lus et étudiés in extenso, n'en constituent qu'une petite partie du corpus, qui compte aussi, par exemple, un cycle de Stephen King, la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo, la série de Fantômas ou des Brigitte, celle des Princes d'Ambre... ou le cycle de la Terre du Milieu de Tolkien. D'Asimov à Tolkien a gardé le meilleur de la thèse en allégeant ce que ce genre de production académique peut avoir d'un peu lourd. Deux parties répartissent une analyse qui va des faits aux interprétations : « Le cycle romanesque : définitions et analyses » pose les méthodes et les termes de l'enquête, avant que « Cycles et passage du temps » propose une interprétation des ensembles romanesques fondée sur une lecture du temps qui s'y déroule, s'y épaissit, y prend forme et y fait sens. Du début à la fin de l'ouvrage, une question fort simple mais essentielle guide le travail : pourquoi lit-on des cycles ? En décidant de chercher la réponse en étudiant comment on lit le cycle, Anne Besson obéit au principe de base qui donne aux études littéraires une méthode scientifique : ici, pas de postulat, mais une hypothèse critique fondamentale (les cycles romanesques répondent à un besoin existentiel plus profond que la simple rentabilité commerciale), et le test de cette hypothèse sur le corpus le plus représentatif possible, avant une proposition de réponse qui synthétise les résultats : les cycles littéraires opèrent la mise en cohérence d'une continuité gagnée sur le discontinu. Et s'il a fallu une thèse de 720 pages pour le démontrer, c'est parce que chaque cycle a été observé précisément dans ses continuités et dans ses discontinuités, et dans les différents étages de cette mise en cohérence qu'il accomplit : comment les accidents des péripéties et des rebondissements sont peu à peu intégrés dans une narration qui leur donne une nécessité, ou pour le dire plus simplement, comment l'inconnu est progressivement intégré au connu. Bien entendu, l'étude peut se poursuivre, et on peut se donner le plaisir de chipoter sur deux ou trois détails de cette énorme enquête (les universitaires ne s'en sont pas privés, et continueront...) : par exemple, pourquoi ne considérer que les « littératures de genre » ? Les cycles médiévaux, les Rougon-Macquart ou autres cycles de la littérature légitimée ont-ils une spécificité ? On peut aussi réfléchir à l'opposition que fait Anne Besson entre cycle et série, dont elle oppose les deux visions du temps : temps figé dans la série, temps orienté dans le cycle. Certaines propositions des chercheurs en études médiatiques, notamment au Québec, suggèrent que la série possède bien une temporalité, mais qui demande à être analysée dans la dynamique d'une lecture originale : le lecteur de séries constitue peu à peu une sorte de compétence, ou de connaissance, qui modifie ses attentes au fil des volumes successifs ; du coup, même si la série répond à des impératifs de stabilité qui annulent la progression du temps dans ses récits (Superman ou Perry Rhodan demeurent à peu près les mêmes au fil des ans et des épisodes), c'est la consommation qui en est faite qui change et atteint progressivement les seuils d'une lecture (délicieusement) « perverse », lecture d'initiés ou de « fans » capables de tirer un plaisir spécifique du moindre détail interprété sur le fond stable des récits. Mais que ce débat puisse être ouvert n'est pas le moindre mérite de l'excellent livre d'Anne Besson. Un autre, que l'universitaire qui signe cette critique veut souligner dans Galaxies, sera peut-être de fissurer les murs des « ghettos » ou des « forteresses » dans lesquels les littératures dites de l'imaginaire restent entre soi... en s'isolant des études littéraires générales. Irène LANGLET |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |