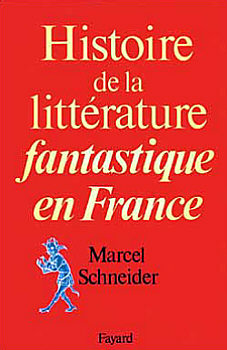|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Histoire de la Littérature Fantastique en France
Marcel SCHNEIDER FAYARD (Paris, France) Dépôt légal : décembre 1985 Première édition Essai, 464 pages, catégorie / prix : 160 F ISBN : 2-213-01676-3 ❌ Genre : Fantastique
Quatrième de couverture
« Le fantastique serait-il aujourd'hui désamorcé ? Mais en quoi consistait l'amorce ? La terreur, les ténèbres, le magique, tout ce qui se présente comme rare, exceptionnel, mais que les auteurs ont donné comme vérité vraie ? « Où est l'amorce ? Où est l'incendie ? Quand le mystère est découvert, il faut le transporter ailleurs et le cacher à la vue des profanes. Le fantastique reste un secret, quelque chose que l'on devine, mais qu'on ne pénètre jamais. C'est toujours ailleurs qu'il se tient. « S'il a perdu les apparences inquiétantes sous lesquelles il se produisait jadis, les diableries, les vampires et les morts-vivants, c'est parce qu'il se manifeste en nous de façon obsédante, sournoise et tout aussi terrifiante. » Marcel Schneider, né à Paris en 1913, est agrégé de Lettres. Il quitte l'enseignement en 1960 pour se consacrer à la littérature et à la musique. Il a publié un Schubert et un Wagner dans la collection « Solfèges » des éditions du Seuil et chez Grasset des romans et des recueils de nouvelles qui relèvent tous du merveilleux et du fantastique (Le Guerrier de pierre, Mère Merveille, Les Colonnes du temple, La Lumière du Nord, Histoires à mourir debout). Sa biographie de Hoffmann (Julliard) et son Histoire de la littérature fantastique en France précisent l'orientation de sa pensée. A la suite de différents prix, il a reçu en 1980 pour l'ensemble de son oeuvre le Prix Pierre de Monaco.
Critiques
Avec la réédition de ce livre de 1964, Marcel Schneider en donne plus qu'il n'en annonce, et il y a là quelques irrésolutions de sa part. D'emblée, sa préface date avec précision le mouvement fantastique en France : de 1825 (sous l'impulsion d'Hoffmann) jusqu'à 1870. Pourtant, ce fantastique annoncé en couverture n'occupe qu'une centaine des 442 pages de l'étude, laquelle s'étend du Xlle siècle à nos contemporains, et analyse bien des manières connexes : merveilleux, féerie, frénétique, symbolisme, décadent, surréalisme, j'abrège. Par ailleurs, ce travail thématique en principe limité à la France fait la part belle et obligée à plusieurs influences extérieures : Hoffmann, le roman noir anglais, Poe, Kafka, Beckett. Et puis, en passant, Maeterlinck, Franz Hellens et Jacques Sternberg sont des écrivains belges. On ne peut donc parler d'une approche strictement centrée sur un domaine national, même s'il est vrai que le français a la tête plus fantastique qu'il n'y paraît. Et afficher « histoire de l'irrationnel en littérature » aurait mieux mis en rapport contenant et contenu. De plus, l'appellation « irrationnel », pour vague qu'elle soit, a le mérite d'être englobante, d'éviter les querelles individuelles ou de chapelle qui ont tant fait couler d'encre autour des définitions de genres et sous-genres compartimentés à outrance. Voir les joutes de Caillois, de Todorov, de Louis Vax sur la notion de fantastique. Et de Schneider lui-même, tellement passionné par son champ de prédilection qu'il écorche en finale la consœur science-fiction, la disant inféodée à la science et de piètre valeur littéraire. Tout cela sent ses années 60. Ces mises au point faites, on ne se plaindra pas de l'ambition d'un tel livre. Plus qu'une histoire exhaustive, il se présente comme une suite structurée de monographies remises à jour parmi lesquelles papillonner, au gré de son plaisir et à l'aide d'un index qui regroupe quand même plus de 800 noms. Excellente introduction à un domaine aussi repérable qu'un archipel flottant. Alain DARTEVELLE Critiques des autres éditions ou de la série
Celui qui vient de refermer un livre qui figure dans une collection d'études est en droit de se demander : « Qu'est-ce que cette lecture m'a apporté ? » Dans le cas du présent ouvrage, une réponse sèche pourrait être contenue en deux mots : pratiquement rien. Une réponse plus nuancée serait la suivante : quelques opinions de l'auteur sur un certain nombre d'œuvres littéraires. La lecture de ce volume ne se justifie qu'en fonction de l'intérêt que présentent ces opinions ; force est de constater que cet intérêt demeure extrêmement limité. Les raisons principales de cet échec sont au nombre de deux. D'une part, Marcel Schneider ne donne aucune définition précise du fantastique ; il est possible qu'il n'en ait pas lui-même, qu'une telle définition ne lui soit même pas nécessaire. Mais cette absence de précision se traduit, pour le lecteur, par une impression d'arbitraire. Les raisons de l'inclusion ou de l'exclusion d'une œuvre donnée ne sont pas toujours apparentes. La seconde raison procède d'un même défaut : les critères de l'auteur, ceux qui lui font juger une œuvre bonne ou mauvaise, intéressante ou plate, ne sont énoncés nulle part. Comme ils sont manifestement subjectifs, le lecteur ne les connaît pas. Il serait sans doute possible de les reconstituer à partir des affirmations et des opinions contenues dans le livre, mais l'intérêt de ce dernier n'est pas suffisant pour que l'on ait envie de se lancer dans une telle entreprise. Essayons pourtant de dégager les principales considérations qui ont pu guider Marcel Schneider dans son travail. Dans son introduction, on trouve quelques indications assez révélatrices à cet égard. « Seuls le fabuleux, le merveilleux et le féerique s'apparentent au fantastique. » C'est bien possible, à condition de fixer le sens dans lequel ces termes sont employés, ce qui n'est pas le cas ici. Un peu plus loin, une autre affirmation : «…Le fantastique ne recherche ni cause ni explication. La science-fiction se situe à l'opposé. » Là aussi, on veut bien, tant que fantastique et science-fiction restent de simples étiquettes que Marcel Schneider n'a fixées nulle part. Mais voici qui est un peu moins flou : « Le fantastique ne regarde que nous, le corps et l'âme de l'homme vivant sur la planète Terre. Il se propose d'explorer l'espace du dedans, théâtre d'événements bien plus importants pour chacun d'entre nous que ceux qui remplissent la première page des journaux. » Cette dernière phrase tendrait à établir que la psychanalyse est une simple succursale du fantastique, et aussi que les archétypes de Jung se rattachent à celui-ci. Lorsque Marcel Schneider affirme (p. 148-149) que « le fantastique explore l'espace du dedans » et qu'« il a partie liée avec l'imagination, l'angoisse de vivre et l'espoir du salut », il fait le plus grand pas que l'on puisse trouver, en ces pages, dans la direction générale d'une définition. Mais non dans celle de la précision, puisqu'on peut considérer que la science-fiction, elle aussi, a partie liée avec l'imagination, l'angoisse de vivre et l'espoir du salut. Il reste cependant acquis que le fantastique semble être, pour l'auteur, quelque chose qui relève de 1'« espace intérieur » de l'homme. Il est regrettable que l'auteur, à partir de définitions aussi imprécises, s'arroge le droit d'émettre des sentences d'autant plus tranchantes qu'elles sont plus générales. Écoutons-le (p. 233) : « Stendlhal, lui, n'avait aucune inquiétude religieuse, ni métaphysique : aussi n'a-t-il jamais écrit un conte fantastique. » Et Jean Ray ? Possède-t-il, pour sa part, une inquiétude religieuse ou métaphysique ? Il a pourtant écrit nombre de contes (auxquels Marcel Schneider accorde d'ailleurs une mention tolérante) qui se rattachent clairement au fantastique. Le fantastique tiendrait-il plutôt à une façon de raconter, à un simple ton ? Cela aussi, Marcel Schneider paraît le sous-entendre (p. 333) : «…le ton acerbe et goguenard de Marcel Aymé glace le fantastique et le réduit à la satire. » Et il faut encore citer ici la distinction, également arbitraire, que l'auteur établit entre les romanciers et les auteurs de nouvelles (p. 231) : « Dans une nouvelle, ce qui intéresse, plus que le sujet, c'est l'auteur, sa finesse de fabrique ou son tempérament, son langage ; dans un roman, ce sont les personnages. » D'où il apparaît clairement que le sujet ne saurait constituer l'intérêt principal ni d'une nouvelle, ni d'un roman. Or, comme c'est au sujet que se rattache en général la notion de fantastique… Si les critères utilisés par Marcel Schneider sont souvent confus ou contestables, peut-on du moins avoir confiance en son érudition ? À première vue, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Il est clair que l'auteur connaît son sujet beaucoup mieux que R.M. Albérès ou Kingsley Amis ne connaissaient le leur lorsqu'ils entreprirent de parler de la science-fiction. Et le fait est que la promenade à laquelle Marcel Schneider convie son lecteur à travers la littérature française permet d'apercevoir un certain nombre de perspectives qui pourront lui donner envie d'approfondir ailleurs le sujet. L'auteur parle du roman médiéval et de Cyrano de Bergerac (auquel, paradoxalement, il attribue une place dans le fantastique quelques lignes après avoir expliqué pourquoi Cyrano est un des précurseurs de la science-fiction…), de la féerie et du fantastique des romantiques allemands, de Mérimée et des surréalistes. Le domaine est vaste, et Marcel Schneider parle de certains de ses secteurs en connaissance de cause. Mais son érudition se révèle par moments superficielle. Lorsque Marcel Schneider affirme (p. 178) que « Séraphitus-Séraphita n'est pas un hermaphrodite, un être bisexué », il paraît ignorer que Balzac a écrit, dans une des Lettres à l'étrangère, que son personnage « serait les deux natures en un seul être ». Lorsqu'il déclare tranquillement (p. 244) que « les Histoires de Poe ne font jamais appel aux fées, aux magiciens, ni aux démons, à tous ces êtres surnaturels », il oublie Metzengerstein, Le masque de la Mort Rouge, Silence et L'ange du bizarre. Lorsqu'il écrit à propos de Jules Verne (p. 324) que « l'aventure devient fantastique », il joue – dans le cas le plus favorable – d'une noire malchance, puisque les romans qu'il cite en guise d'exemples, L'île mystérieuse, Vingt mille lieues sous les mers et Voyage au centre de la terre comprennent tous de ces explications scientifiques ou pseudo-scientifiques dont Marcel Schneider dit qu'elles font disparaître le fantastique. Lorsqu'il oppose (p. 244-245) le roman policier au fantastique qui « a toujours partie liée avec la poésie », il biffe d'un trait de plume l'œuvre de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, fondée précisément sur une poésie précise, celle de l'angoisse. Lorsqu'il parle du « disque accusateur dans ce Meurtre de Roger Ackroyd qui rendit célèbre du jour au lendemain Agatha Christie » (p. 377), la confusion est complète : il n'y a aucun « disque accusateur » dans ce roman, mais, tout au contraire, un dictaphone que l'assassin utilise pour l'établissement de son alibi. Quant aux connaissances de l'auteur en matière de science-fiction, ce qu'il dit des extra-terrestres à propos des Xipéhuz de Rosny (p. 325) suffit à montrer que Marcel Schneider n'a guère dépassé le stade des Martiens-croquemitaines, ennemis aussi jurés qu'arbitraires des humains, et qu'il ignore par exemple complètement l'œuvre d'un Clifford Simak (dont il cite d'ailleurs le nom – en l'orthographiant, il est vrai, Simack) même s'il mentionne généreusement René Barjavel, Jacques Sternberg et Gérard Klein. C'est sans doute un même manque de connaissance des domaines qui ne relèvent pas directement de son sujet – mais qu'il aime bien invoquer au passage – qui amène Marcel Schneider à citer gravement un charabia de Charles-Noël Martin sur les particules élémentaires (p. 391). On se fût passé de celui-ci, tout comme des paragraphes dans lesquels l'auteur présente sans sourciller ses propres récits fantastiques, en échange d'une documentation un peu plus sérieuse sur la science-fiction, par exemple, ou même d'une définition moins imprécise de ce que Marcel Schneider appelle le fantastique. Celui qui chercherait en ces pages une étude littéraire (au sens du titre de la collection) serait déçu. L'auteur l'en prévient d'ailleurs explicitement (p. 12) : « Ce n'est ni une histoire des idées, ni un répertoire des auteurs et de leurs œuvres, ni une compilation érudite, mais une suite de réflexions sur la littérature parallèle. » Saluant au passage cette dernière tournure, élégant pendant à la littérature différente chère à quelques fantaisistes, on peut regretter que le ton de ces pages demeure précisément celui d'une étude, grave, affecté et dépourvu de fantaisie : correct, certes, mais froid. Et lorsque l'auteur, parlant de la mémorable étude de Pierre Castex, affirme très pertinemment que « on ne peut se dispenser de lire Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant », le lecteur est fortement tenté d'ajouter que l'on peut très bien, en revanche, se dispenser de lire l'ouvrage de Marcel Schneider. Demètre IOAKIMIDIS |
| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |