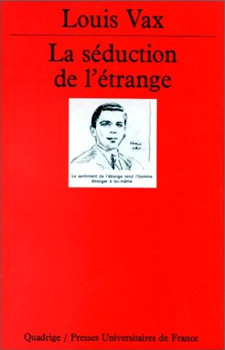|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Séduction de l'étrange
Louis VAX PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE , coll. Quadrige Dépôt légal : février 1987 Ouvrage universitaire, 330 pages ISBN : 2-13-039892-8 ❌ Genre : Fantastique Pas de texte sur la quatrième de couverture.
Critiques
Je n'ai point la tête philosophique. Aussi se pourrait-il que je ne fusse pas spécialement qualifié pour parler, comme il conviendrait, de La séduction de l'étrange de M. Louis Vax. Car il s'agit bel et bien là d'une étude consacrée à la philosophie du fantastique, et qui déjà s'esquissait dans un précédent ouvrage du même auteur. Mais puisque aussi bien j'ai pris à sa lecture un plaisir et un Intérêt quasi constants, je vais tout de même essayer d'éclairer ma lanterne. Le propos de M. Vax est à la fois modeste et ambitieux : il ne vise point tant à définir le fantastique – tâche réputée Impossible – qu'à analyser les composants qui font qu'il nous séduit et nous attire. Pour lui, « le sentiment du fantastique ne jaillit pas d'une connaissance de l'extraordinaire, mais d'une participation à une situation qui, tout à la fois, déconcerte et menace ». Et il précise : « Caillois semble croire qu'il existe un fantastique en soi et qu'on peut l'atteindre du dehors. Il n'est de fantastique que vécu ». C'est bien pourquoi il récuse Freud quand celui-ci prétend expliquer le sentiment du fantastique ou de l'étrange – c'est tout un – par le moyen de la psychanalyse. En fait, pour qui lit attentivement M. Vax, il est clair que le sentiment de l'étrange lui apparaît comme un sentiment actuel, un sentiment que la séduction présente suffit à expliquer, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une expérience en propre, et nous ne saurions faire davantage que simplement ie reconnaître. Tout recours à la psychanalyse lui semble superflu. Cela posé, quels sont – en simplifiant beaucoup – les cheminements du présent ouvrage, à quoi aboutissent-ils ? M. Vax, qui, je l'ai dit, n'a point dessein de définir le fantastique, a cependant – on l'a vu plus haut – été contraint de le faire « par la bande ». Et plutôt deux fois qu'une, car on sait du reste que toute définition, ou simplement toute tentative de définition, en appelle immanquablement une deuxième, une troisième, d'autres encore. Si bien qu'on se met à tourner en rond et qu'on revient à son point de départ, autrement dit à zéro. « Définir, » nous dit M. Vax, « ce n'est pas nécessairement donner une définition ». Pas plus qu'on ne définit vraiment le fantastique, on ne peut en classer les motifs et les thèmes. D'autant que ce qui est fantastique pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Chacun voit midi à sa porte. En tout état de cause, M. Vax en est réduit à nous résumer des catalogues de thèmes dressés respectivement par Dorothy L. Sayers, Moningue Summers, Roger Caillois (pour le fantastique littéraire), Marcel Brion (pour le fantastique pictural) et Michel Laclos (pour le fantastique cinématographique), sans en adopter aucun. Pourtant l'auteur de La séduction de l'étrange n'en poursuit pas moins vaillamment sa route. Et les chapitres se succèdent (Le « champ – fantastique ; Ambiguïtés et antinomies ; Fantastique et croyance ; La dynamisme de l'expressif ; L'univers fantastique ; etc.) qui, tous, abondent en formules heureuses « L'étrange eût une tentation : en souffrir c'est en jouir. Voilà bien son ambivalence. Conscience de l'étrange, séduction de l'étrange et horreur de l'étrange, c'est tout un ». « Seuls des parapsychologues prétendent croire aux spectres à neuf heures du matin ». « Il n'est point d'art qui ne veuille donner une conscience d'artifice ». « Le sujet d'une aventure fantastique est toujours le héros-victime ; son objet est toujours le monstre. Mais cet objet qui le menace n'est qu'une part révoltée de lui-même »… Mais voilà déjà que je tourne court. C'est que l'ouvrage de M. Vax se lit plus facilement qu'il ne se résume, car il est riche et foisonnant. Les exemples n'y font point seulement état des « grands ancêtres – d'Hoffmann à Maupassant – mais ils se réclament principalement d'autres auteurs encore, français ou d'expression française, anglo-saxons, hispano-américains même. Presque tous contemporains et toujours judicieusement choisis. Citons au hasard : Jean Ray ; Mandiargues ; Brion ; Jean-Louis Bouquet ; Thomas Owen ; De Ghelderode ; Le Fanu ; Bram Stoker ; Henry James ; Hichens ; Saki ; De La Maro ; M. R. James ; Blackwood ; Machen ; Hartley ; Bierce ; Edith Wharton ; Lovecraft ; Bradbury ; Matheson ; Borges ; Cortazar… C'est assez dire que nous nous trouvons là devant un travail d'importance, foncièrement original, le premier, peut-être, en son genre6 , et qui ouvre largement à la philosophie des domaines que nous n'avions encore fait qu'entrevoir. Des domaines que d'autres disciplines – psychanalyse, psychiatrie, rnétapsychique, parapsychologie, etc. – s'étaient un peu trop empressées d'annexer à leur seul profit. Bien sûr, ces trois cents grandes pages ne vont point sans quelques truismes, mais il serait absurde de s'en formaliser. On sait de toute éternité que c'est chez les philosophes, plus qu'ailleurs, qu'« il pleut des vérités premières ». Elles y sont irremplaçables : elles servent tout autant à expliciter le discours qu'à étayer les conclusions. Une bibliographie méthodique de plus de trois cents titres, et qu'on aurait tort de vouloir exhaustive – car elle ne prétend qu'à nous donner les seules sources de La séduction de l'étrange – complète excellemment le volume. Signalons cependant à M. Vax que lorsqu'il nous dit (au bas de la page 85), à propos de Gottfried Wolfgang, que « cette nouvelle de Pétrus Borel a été plagiée par Washington Irving », il aurait dû en bonne justice – s'il ne s'était fié à l'unique témoignage d'un cahier des Quatre Vents – nous dire exactement le contraire. En effet, ce récit, qui fait partie des Histoires étranges d'un gentleman nerveux, figure déjà, dès 1824 et sous le titre d'Aventure d'un étudiant allemand, dans l'édition originale anglo-américaine des Contes d'un voyageur (Tales of a traveller) d'Irving. Or, Borel savait l'anglais – sa traduction de Robinson Crusoé en fait foi – et ce n'est qu'en 1843 qu'il a publié « son » Gottfried Wolfgang, dans le tome VIII de La Sylphide. Mais comme Irving lui-même n'avait point hésité à démarquer impudemment Potocki, en rebaptisant Le grand prieur de Minorque un récit de cet auteur polonais, l'Histoire du commandeur de Toralva, qu'il était allé chercher dans le Manuscrit trouvé à Saragosse… Au terme de son ouvrage, M. Vax s'interroge, tel le voyageur de l'Ulalume de Poe. Et il n'est pas loin de s'écrier comme lui : « Ah ! quel démon m'a tenté vers ces lieux » quand, ayant spécifié qu'une philosophie du fantastique ne saurait être une philosophie fantastique, il conclut : « Le philosophe, qui analyse la notion et les œuvres, est incapable d'opérer la synthèse du fantastique, c'est-à-dire d'éveiller le sentiment d'étrangeté. C'est à la littérature et à l'art que ce rôle est dévolu ». Faut-il en déduire comme semble le penser M. Robert Kanters7 , qu'à vouloir trop prouver, l'auteur de La séduction de l'étrange n'a qu'à demi atteint son but ? Je le crois d'autant moins qu'il ne me paraît guère possible de l'atteindre mieux. Au reste, M. Vax s'en explique une fois encore, par ailleurs, dans un texte que j'ai sous les yeux : « La plus savante philosophie de l'étrange, » écrit-il, « est incapable de nous donner un sentiment d'étrangeté. L'étrange est par nature inaccessible à l'intelligence. Pour reprendre une remarque de Kent sur l'idée de Dieu, je dirais que l'intelligence peut penser l'étrange, mais qu'elle ne peut le comprendre. C'est au sens esthétique ou affectif, qui est une faculté spéciale – comme l'a bien vu l'esthétique allemande du XVIIIe siècle – qu'il faut faire appel ». On ne peut que lui donner raison. M. Vax, j'espère l'avoir montré, possède parfaitement son sujet. On l'y sent à l'aise « comme un poisson dans l'eau ». Il y témoigne d'une dialectique virevoltant, souvent irréfutable, et qui n'est pas sans rappeler celle des cours en Sorbonne d'un autre philosophe, l'éblouissant, l'étourdissant M. Vladimir Jankélévitch. Au surplus, l'auteur de La séduction de l'étrange écrit fort agréablement : sa phrase généralement courte, toujours nerveuse, laissa malicieusement affleurer, çà et là, un humour des plus plaisants. Dans une discipline où l'on se prend traditionnellement au sérieux, où l'on aime à se gargariser de longues et lourdes périodes à l'allemande, cela tient presque du miracle. C'est une autre séduction. Roland STRAGLIATI |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |