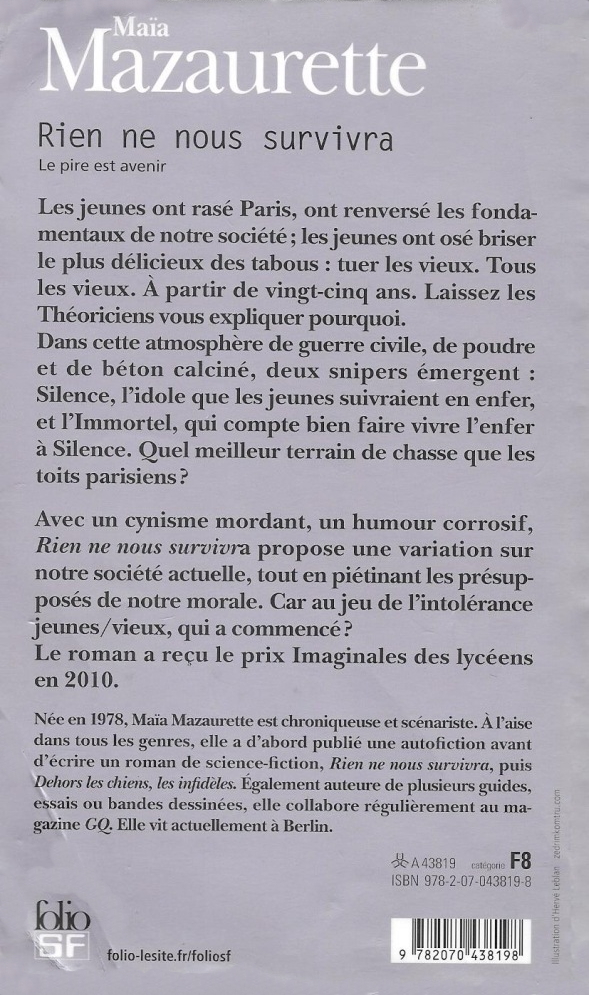|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Rien ne nous survivra - Le Pire est avenir
Maïa MAZAURETTE Illustration de Hervé LEBLAN GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio SF  n° 403 n° 403  Date de parution : 1er septembre 2011 Dépôt légal : septembre 2011, Achevé d'imprimer : 1 septembre 2011 Réédition Roman, 384 pages, catégorie / prix : F8 ISBN : 978-2-07-043819-8 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction
Autres éditions
Sous le titre Le Pire est avenir Jacques-Marie LAFFONT, 2004 Sous le titre Rien ne nous survivra - Le Pire est avenir MNÉMOS, 2009 Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
Les jeunes ont rasé Paris, ont renversé les fondamentaux de notre société ; les jeunes ont osé briser le plus délicieux des tabous : tuer les vieux. Tous les vieux. À partir de vingt-cinq ans. Laissez les Théoriciens vous expliquer pourquoi.
Dans cette atmosphère de guerre civile, de poudre et de béton calciné, deux snipers émergent : Silence, l'idole que les jeunes suivraient en enfer, et l'Immortel, qui compte bien faire vivre l'enfer à Silence. Quel meilleur terrain de chasse que les toits parisiens ?
Avec un cynisme mordant, un humour corrosif, Rien ne nous survivra propose une variation sur notre société actuelle, tout en piétinant les présupposés de notre morale. Car au jeu de l'intolérance jeunes / vieux, qui a commencé ?
Le roman a reçu le prix Imaginales des lycéens en 2010.
Née en 1978, Maïa Mazaurette est chroniqueuse et scénariste. À l'aise dans tous les genres, elle a d'abord publié une autofiction avant d'écrire un roman de science-fiction, Rien ne nous survivra, puis Dehors les chiens, les infidèles. Également auteure de plusieurs guides, essais ou bandes dessinées, elle collabore régulièrement au magazine GQ. Elle vit actuellement à Berlin.
Critiques des autres éditions ou de la série
No future. Il y aura bientôt 30 ans... Et les ex-punks aigris se retrouvent aux enterrements d'anciens combattants d'une guerre perdue sans même avoir eu lieu. Avant même que Maïa Mazaurette ne goûte au douteux privilège de venir au monde, des Lords Of The New Church, en veine prophétique, chantaient « Army chic in high fashion stores » car la rébellion est devenue un marché porteur dont on profite tout en la neutralisant. Et voilà que Le pire est avenir. CQFD. L'avenir, c'est la vieillesse. Une vieillesse en quête d'éternelle jeunesse, définitivement incapable de laisser la place à des jeunes de moins en moins jeunes. Une vieillesse qui détient tous les pouvoirs et tous les avoirs. Une vieillesse qui joue d'injonctions paradoxales taxant d'immaturité une jeunesse qu'elle confine dans une infantilisante irresponsabilité. Que les héritages se transmettent de mourrant à vieillards... Maïa Mazaurette envisage la révolte aussi radicale qu'insensée des jeunes contre les vieux. Le livre a le mérite de poser le problème d'une gérontocratie où les jeunes ne se voient proposer que l'entretien de vieillards acariâtres mais friqués — les sans-le-sou, on débranche — pour des salaires à ce point dérisoires qu'ils ne leur procurent pas même l'indépendance sociale... Deux snipers. L'Immortel et Silence. Deux points de vue. Deux trames plus digressives que narratives. Un journal intime d'ado à deux voix alternées, parsemé de quelques lettres d'une vieille. Entre les deux, un jeu de fascination, d'amour et de mort. Un journal à la fin prédéterminée. Un compte à rebours. Celui des jours qu'il reste à la révolte des jeunes avant l'éradication. No future. L'histoire ? Celle d'une révolution. Non, d'une révolte, d'une rébellion. De l'idéalisme nihiliste naïf au cynique pragmatisme contre-révolutionnaire. De la Bastille à Napoléon. Du passé faisons table rase pour que l'avenir soit à son image. On assiste ainsi à la renaissance, sur le terreau d'un nihilisme individualiste, d'une structure militaire dans toute sa stalinienne splendeur. Parce que voilà, la mort à 25 ans, l'age de notre auteur, c'est très punk mais suicidaire. Shoot them up, c'est très fun ; flinguer les vieux, très œdipien mais très irréaliste sans ADM. Or, bien entendu, ça ne traîne pas dans toutes les mains... Tant l'Immortel que Silence perçoivent la menace pour leur individualisme que représente l'ascension de l'Armée, mais l'inéluctabilité du processus leur échappe, d'autant qu'il est largement le fait de vieux infiltrés. Ils ne comprennent pas qu'un conflit tend à restaurer la stabilité en opérant au besoin le transfert du pouvoir. Que la conquête de celui-ci, fût-il dérisoire et éphémère, implique la lutte pour sa pérennisation. D'où Cronstadt et la répression de Trotski qui sera à son tour liquidé au Mexique sur ordre de Staline, La Nuit des Longs Couteaux ou la Terreur, Danton, Robespierre... De plus, le pouvoir a une vocation collective et une vision d'avenir, une perspective historique. Son essence même fait tant de l'individualisme que du nihilisme des concepts qui lui sont irréductiblement antagonistes. Les jeunes du roman mènent leur guerre comme un jeu vidéo, ils tirent du vieux comme un Baron Rouge comptabilisait ses victoires. Ils sont davantage dans un illogisme d'impulsion criminelle collective que dans une stratégie logique. Les conflits sexuels et générationnels sont apparus parce qu'ils ont perdu leur critère d'absurdité. Des « armes » sont mises au point qui permettent de voir le mâle et le jeune comme inutiles, dépassés. Par armes, il n'est pas nécessaire de concevoir celles imaginées par Michael Cordy dans Le Projet conscience (Robert Laffont) et qui auraient été bien utiles aux jeunes du roman de Mazaurette. Simplement, on peut croire que la reproduction pourra se passer totalement des mâles et que l'immortalité est envisageable. La S-F traite le plus souvent l'immortalité par le biais d'une renonciation à la progéniture, mais si, comme dans le roman de Sterling, Le Feu sacré (Presses de la Cité, « Rendez-vous ailleurs »), l'héroïne retrouve avec la jeunesse la libido de ses vingt ans, le problème se posera. Et le but de l'immortalité n'est pas une éternité sur le grabat ! Avec Le Pire est avenir, Maïa Mazaurette décoche un livre coup de poing. D'une incorrection politique telle qu'on peine à l'imaginer féministe. Elle livre un roman violent mais pensé ; à 180 degrés de la bien-pensance, aux antipodes de la mièvrerie. De la littérature, quoi ! Peut-être pas la meilleure, mais de la vraie. De la salutaire qui fait tourner les neurones comme des totons et décape les cervelles de la guimauve qui les englue. Seul bémol : la fin, banale. L'écrasement pur et simple sous les bombes d'une poche de résistance avec massacre et reddition. Rien d'une Némésis implacable impliquant un compte à rebours fatal. A défaut de le résoudre, Mazaurette pose le problème. Ce roman où la problématique prend le dessus tant sur la stylistique que sur la narration, s'apparente par là à la feue S-F politique de la fin des années 70, et cette fois, le pire n'est pas à lire. Véritable mine d'épigrammes pour romanciers et essayistes, voilà enfin un vrai roman de S-F, un roman plein d'idées comme on aimerait pouvoir en lire plus souvent. Jean-Pierre LION
Rien ne nous survivra est un roman qui traite du conflit entre les générations. Conflit à prendre ici au sens le plus primaire : les jeunes décident un jour de tuer leurs aînés, de se débarrasser manu militari de la génération précédente, ces baby-boomers qu'ils accusent de tous les maux. Lorsque s'ouvre le récit, Paris est coupé en deux. Au sud, les moins de 25 ans, au nord, les vieux, le troisième âge, qui est resté dans la capitale et rend coup pour coup, tandis que les quadragénaires qui n'ont pas été tués par leurs enfants ont fui. Entre les deux camps, une guérilla à mort : mines antipersonnel, blindés, tireurs embusqués, escarmouches... L'histoire se concentre sur deux snipers du camp des jeunes, Silence et l'Immortel (pour couper tout lien avec leurs ascendants, les révoltés se sont aussi donné de nouveaux noms). Silence est une légende parmi les jeunes, un tueur que personne n'a jamais vu, dont nul ne connaît le visage, ni même le sexe. Un jour, la copine de l'Immortel revendique un coup d'éclat commis par Silence. Celui-ci la tue. L'Immortel décide alors de la venger. Le conflit entre les deux snipers va se superposer à l'évolution de la guerre entre jeunes et vieux, qui commence dans un joyeux anarchisme optimiste, avant de s'enfoncer dans la paranoïa et la terreur, les purges et les complots contre-révolutionnaires décimant les rangs des chefs du mouvement. Le tout converge vers une fin inéluctable au bout de trois mois, lorsque l'ultimatum donné par l'Union européenne expirera. Cet horizon indépassable est constamment rappelé par la numérotation des chapitres qui égrène le compte à rebours, du jour J-100 au jour J. Le roman est structuré sur un schéma répétitif composé de courts chapitres alternativement centrés sur Silence et l'Immortel, où chacun se raconte à la première personne, et régulièrement ponctués par des Théories, extraits de tracts justifiant la révolte gérontocide. Construit sur une idée forte — le parricide comme programme politique — , Rien ne nous survivra peine cependant à tenir ses promesses. Au bout de quelques chapitres, il apparaît que l'auteure manque de matériau pour remplir un roman entier, même un livre de 270 pages avec des paragraphes plutôt aérés. Le conflit entre jeunes et vieux prend vite un aspect répétitif et finit par lasser : peu de péripéties, des ellipses brutales qui rendent le récit parfois difficile à suivre, un flou sur les aspects tactiques et politiciens qui anéantit toute « suspension of disbelief »... À chaque nouveau chapitre, le lecteur se surprend à compter les jours qui le séparent encore du dénouement. La déception est aussi au rendez-vous quant à l'affrontement entre Silence et l'Immortel. Alors que les deux personnages sont décrits avec une profondeur qui laissait présager une intrigue complexe, quelque chose de grand et de tragique dans le subtil mélange de haine et d'amour que l'Immortel voue à Silence, une relation sado-masochiste où aligner l'autre dans le viseur de son fusil tient lieu d'étreinte, on finit par être exaspéré de la valse-hésitation du premier, de cette course-poursuite à travers les toits de Paris qui semble bientôt tourner en rond et dont la résolution fait appel à un Deus ex machina des moins convaincants. S'ajoutent à cela des personnages secondaires trop peu développés pour être attachants (Vatican, l'Esthète...) et une fin qui laisse une partie de l'intrigue non résolue. Il n'y a vraiment que dans les chapitres intitulés Théorie que Maïa Mazaurette réussit à préserver l'intérêt du lecteur jusqu'à la fin. Ces longs extraits de tracts (qui, petit à petit, prendront leur place au coeur même de l'intrigue) sont l'occasion d'une vraie réflexion sur le bilan de la génération des baby-boomers et sur le manque de perspectives politiques de la suivante, celle-là même à laquelle l'auteure appartient. Il est crucial d'exterminer en premier lieu les quinquagénaires et sexagénaires — et à travers eux, la génération 68 à fort pouvoir politique et parental. (...) nos parents nous ont appris très tôt que rêver ne sert à rien.(...) ils n'avaient foi en rien et nous ont enfantés quand même.(Théorie 4 : Autodéfense face au Mur 68) Derrière l'outrance de la propagande guerrière (certains passages rappellent les dazibaos de la Révolution culturelle), s'exprime une vraie angoisse, un constat désabusé sur la mort de l'idée de Révolution. Il est paradoxal de constater que c'est dans les pages les moins « romanesques » que Rien ne nous survivra se montre le plus captivant. Pour le reste, on regrettera que ce qui aurait pu constituer une excellente novella ait été étiré au format d'un roman. Jean-François SEIGNOL (lui écrire)
Voilà un auteur qui a le sens du titre. Qu'on en juge : en 2008, Mnémos publiait Dehors les chiens, les infidèles, fantasy crépusculaire atypique centrée sur le fondamentalisme religieux. Roman ambitieux mais insatisfaisant, inabouti sans doute (cf. critique in Bifrost 54), mais qui confirmait la place de Maïa Mazaurette sur la liste des auteurs à suivre, place que lui avait valu la parution en 2004 de son premier roman, Le Pire est avenir (cf. Bifrost 37). Et voici que Mnémos nous propose, avec Rien ne nous survivra (le pire est avenir) de (re)découvrir dans une version entièrement remaniée ce texte qui avait souffert d'une diffusion confidentielle. Rien ne nous survivra dresse le portrait d'une jeunesse en révolte — littéralement : à Paris, comme dans les autres métropoles françaises et peut-être ailleurs, les jeunes ont pris les armes et tuent les vieux (entendre : tuent tout ce qui a l'air d'avoir plus de 25 ans). Face à l'inébranlable mainmise de ces vieux sur la société, confrontée à la certitude que rien ne lui sera possible avant que d'être vieille à son tour, guidée par d'obscurs « Théoriciens » qui ont su capitaliser le succès médiatique de quelques parricides, de quelques fusillades, une génération s'est soulevée, résolue à détruire puisqu'on ne lui laisse rien construire... Une génération entièrement consacrée à vivre au présent, à être, qui dans l'euphorie anarchique des premières heures refuse d'admettre qu'avec le temps, rythmé par l'ultimatum (109 jours avant l'inéluctable écrasement sous les bombes), le mouvement puisse dégénérer et s'organiser, empruntant les voies du pouvoir dans lesquelles tant d'autres « vieilles » révoltes, tant de révolutions se sont enlisées. Si le réquisitoire contre le « jeunisme » et la gérontocratie — étayé par les « théories » qui ponctuent le texte — s'avère riche et pertinent, Maïa Mazaurette se montre moins à l'aise lorsqu'il s'agit de mettre en scène la révolte. Alternant de chapitre en chapitre les points de vue de deux snipers, Silence et l'Immortel, personnalités emblématiques parmi les jeunes, le récit souffre de quelques invraisemblances et d'ellipses qui, malgré le compte à rebours (un chapitre par jour jusqu'à l'expiration de l'ultimatum), nuisent au rythme et parfois à la clarté de l'ensemble... ce qu'on pardonnera d'autant plus aisément que l'auteur a l'intelligence de ne pas jouer la carte de la crédibilité au point de sombrer dans l'absurde. Sa guerre civile est avant tout un décor, moins un motif qu'un cadre où évoquer ce qui est peut-être le seul programme politique à la portée des héritiers de la génération 68, et développer l'autre versant du livre, la relation qui petit à petit naît et grandit entre les deux snipers. Silence : froid, calculateur et cynique, l'un des piliers du mouvement, le meilleur sniper et le premier parricide politique, que tous connaissent sans pouvoir l'identifier. L'Immortel : tout en rage plus ou moins contenue, brûlant de connaître l'amour avant la fin de l'ultimatum. Deux individualistes, mus par la volonté de s'exclure de schémas sociaux aliénants, les manipulant et les fuyant tour à tour, chacun incarnant à sa manière l'esprit de la révolte juvénile. Quand dans un règlement de comptes Silence supprime la petite amie de l'Immortel, ce dernier va retourner sa rage de vivre et d'aimer vers celui qu'il accuse d'avoir irrémédiablement gâché ses derniers jours. Dès lors, une relation complexe se développe entre les deux jeunes gens, toute en approches et en esquives, en feintes et en provocations, oscillant sans cesse à la limite du sadomasochisme. Il s'agit pour l'Immortel de se dresser face à Silence, de surpasser le sniper et réduire l'individu à sa merci. Encore faudrait-il que le toujours anonyme Silence, l'idole, le fondateur, l'incarnation même du mouvement, accepte de lui offrir cette confrontation avant que la raison ne rende les armes face à l'obsession grandissante de son challenger. Ainsi la relation entre les deux jeunes gens se fait-elle l'écho de la lutte en cours. Sclérose des mécanismes et dynamiques des sociétés occidentales, impasse des relations à sens unique, les deux faces du roman se répondant sans cesse, renvoyant l'âge mûr à son inertie mortifère et l'adolescence à ses incohérences, ses faiblesses et ses doutes autant qu'à son formidable potentiel. Navigant à vue entre réalisme et fantastique, Rien ne nous survivra fonce dans son sujet bille en tête, porté par des personnages forts et convaincants. Si le résultat manque parfois de liant, si quelques angles mériteraient d'être arrondis, Maïa Mazaurette prouve qu'elle sait suffisamment composer avec ses faiblesses pour les faire oublier. Reste maintenant à les surmonter. Gageons qu'elle saura se donner les moyens de son ambition, et ne boudons pas notre plaisir : en dépit de quelques défauts (de jeunesse ?) et d'une mise en page pour le moins indigeste, Rien ne nous survivra (le pire est avenir) s'avère un roman grinçant et réjouissant. Avec un titre pareil, on pouvait s'en douter, non ? Olivier LEGENDRE |
| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |