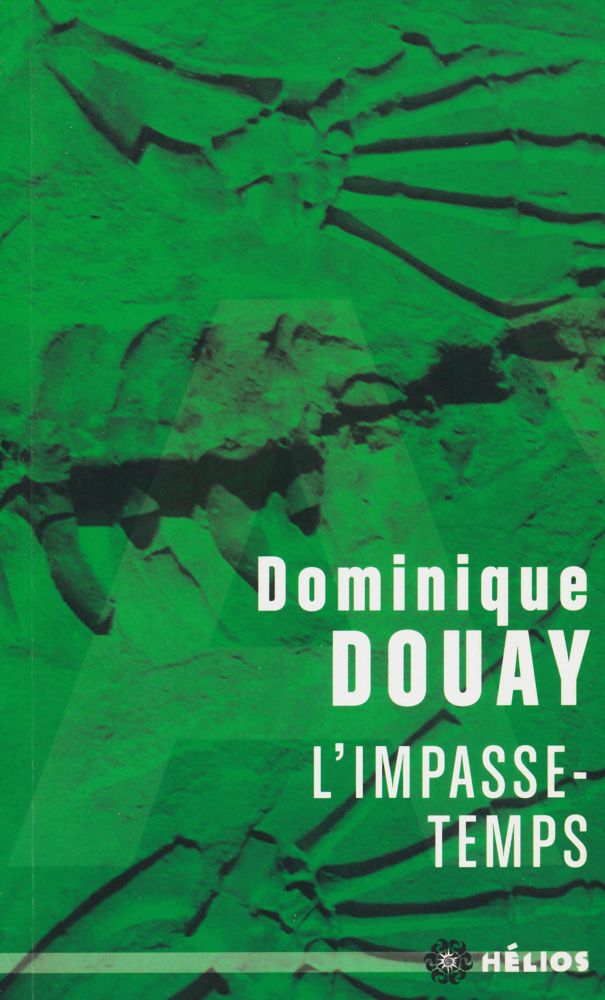|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
L'Impasse-temps
Dominique DOUAY Première parution : Paris, France : Denoël, coll. Présence du futur, 1980 Illustration de Sylvie CHÊNE LES MOUTONS ÉLECTRIQUES (Montélimar, France), coll. Hélios  n° 3 n° 3  Date de parution : 7 mars 2014 Dépôt légal : 2014 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 7,90 € ISBN : 978-2-36183-165-3 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
« Gigantesque éclat de rire grinçant et dévastateur. » Jean-Pierre Andrevon
C'est peut-être le fantasme ultime, c’est en tout cas le plus puissant des pouvoirs : parce qu’un jour il a trouvé ce qui ressemblait à un briquet, Serge Grivat un homme timoré, vaincu d’avance, tout le contraire d’un battant, voit l’impossible arriver : désormais, il peut quitter le cours du temps. Virtuellement invisible, il peut donner libre cours à tous ses penchants, tous ses désirs : dîner gratuitement à la Tour d’Argent, soulever les jupes des belles passantes immobilisées, vider le contenu du portefeuille des messieurs... Mais quel est le revers de ce pouvoir, quelle malédiction se trouve à l’œuvre ?
Dominique Douay, écrivain d’origine lyonnaise, fut l’une des plumes françaises les plus en vue durant les décennies 1970-80, récompensée par deux Grand Prix de la SF Française (1975 et 1989). Il fait aujourd'hui son retour, avec ce roman qu’il a légèrement retouché et qui est l’un de ses principaux. Un chef-d’œuvre entre rire grinçant et fantastique contemporain.
Critiques des autres éditions ou de la série
Le sixième roman de Dominique Douay nous arrive emballé dans de fallacieuses considérations critiques : le « dos » de l'ouvrage (on sait bien que ce sont les auteurs qui l'écrivent) parle de « La plus terrible des malédictions pèse sur vous : elle a pour nom LE POUVOIR » ; et mon journal favori (Libération, bien sûr), dans sa « Page SF » du mardi 17 juin signée comme d'habitude Docteur Sourire (mais est-ce Antoine Griset ou Daniel Chave qui tenait la plume ?), évoque le destin du héros de l'histoire en prétendant... « qu'il va expérimenter la toute-puissance, ses vertiges et ses impasses ». Ah !... Connaissant les opinions de gauche (mais quel courageux en a aujourd'hui de droite ?) de Dominique Douay, on se dit : enfin un bouquin de SF sur le POUVOIR POLITIQUE — sujet épineux qu'en dix ans de travaux aucun auteur français, fût-il (dans ses interviews ou dans sa pratique personnelle) invétéré gauchiste, n'a jamais réussi à véritablement traiter. Tremblant de joie prospective, la bave idéologique aux lèvres, on ouvre le roman de Douay en attendant d'y lire le développement de la pensée de Lord Acton : « Le pouvoir tend à la corruption, le pouvoir absolu corrompt absolument » (qu'on cite faussement en général, et qu'on attribue le plus souvent à Brecht). Or, qu'y trouve-t-on ? Un auteur provincial de bandes dessinées, plutôt miteux (ce genre de personnage que tout auteur qui réussit prend un énorme et sadique plaisir à dessiner : voir aussi Malzberg), nanti d'une femme charmante et d'une maîtresse parisienne épisodique qu'il rencontre en même temps que ses éditeurs quand il monte à l'assaut de la capitale, trouve un soir dans sa (miteuse) chambre d'hôtel une sorte de briquet qui possède le pouvoir de figer le temps. Sauf pour son possesseur, bien sûr. Serge Grivat, après un nombre raisonnable de pages destinées à montrer son incompréhension du phénomène, puis son étonnement, décide de profiter de l'aubaine. D'abord en regardant (les tableaux vivants des scènes figées), puis en touchant : le dessous des jupes des belles passantes immobilisées, et le contenu du portefeuille des messieurs (avec lequel il finira par s'acheter le château de ses rêves). En somme Serge Grivat, le minable (son nom évoque à la fois grisâtre et grivois), viole et vole, deux mamelles que l'impunité rend jumelles. Devrait-on alors, plutôt qu'à Lord Acton, chercher chez Alain une pensée philosophique digne de cerner au mieux L'impasse-temps : « Tout pouvoir sans contrôle rend fou, » par exemple ? On s'approcherait déjà plus du propos apparent de Douay, qui prend naturellement la précaution de parsemer son récit de pensées moralisantes du genre : « Déjà, mes pouvoirs me faisaient peur. Je commençais à y discerner confusément une malédiction. » (p. 122). Mais en réalité, sous le cours linéaire d'une histoire qui effectivement se boucle dans le cataclysme (on y reviendra plus loin), perce la prodigieuse satisfaction du « je-fais-ce-que-je-veux ». Commune à la créature et à son créateur ? Allons ! Qui n'a pas rêvé, au moins de temps à autre, de pouvoir posséder toutes les jolies femmes entrevues, de pouvoir fouiller dans toutes les bourses bien garnies ? Il est là, le vrai pouvoir, et pas dans la domination politique. Ce que met en œuvre Douay, c'est un fantasme, LE fantasme à l'état brut, libéré de tout blocage socio-culturel, le fantasme qu'hélas on ne peut assouvir que sur le papier, par le biais d'un récit de science-fiction. Et la force de Douay n'est autre que la force de ses obsessions, qui recoupent si bien les nôtres ! (Que les vertueux me lancent la première pierre, que l'auteur ose me faire un procès en diffamation...). Bien sûr, Serge Grivat, et c'est l'autre adresse de Douay, finit par avoir la jouissance triste. (« Le train-train habituel : les portefeuilles, les femmes, la bouffe » p. 140). Et cet être humain qui n'agit que selon les pulsions élémentaires de son cerveau reptilien (voir Laborit) : manger (ce qui comprend l'anthropophagie), baiser, dormir va se transformer en reptile, à qui il ne reste plus qu'à disparaître, tout en sachant bien qu'il a laissé dans le ventre de centaines de femmes... « du sperme de lézard gris qui possède la particularité de vivre hors du temps » (p. 215 et dernière). C'est la catastrophe annoncée {mais elle ne fait que rester suspendue au-delà du temps propre au récit), qui propulse le roman dans cette catégorie d'histoires très datées (les années 40), où l'exercice d'un pouvoir assumé jusqu'à plus soif-précipitait le héros dans les pires cataclysmes, où l'humanité ne restait pas indemne — et dont les exemples les plus réussis sont L'œil du purgatoire de Jacques Spitz et La chute dans le néant de Marc Wersinger. Mais, pour ce qui est du plus évident redoublement thématique, il faut citer La planète pétrifiée de Vargo Statten (publié au Fleuve Noir « Anticipation » en 1952, et jamais réédité), où un cerveau électronique expérimental figeait le temps sur toute la planète... Seulement, la où les conteurs des années 40 ou 50 nous présentaient des expériences scientifiques tournant mal, et des héros positifs essayant de réparer leurs « défis à Dieu ou à la Nature », Douay, en bon iconoclaste des années 80, ne cherche pas la moindre justification scientifique (son briquet temporel, dont la provenance ne sera jamais élucidée, n'est qu'une baguette magique utilisable à merci), ni la moindre justification morale : son « reptile » bouffe à la Tour d'Argent, sodomise des vedettes de cinéma, amasse les billets de banque dans un triporteur... C'est à cause de ce gigantesque éclat de rire grinçant et dévastateur, ce défi à la morale judéo-chrétienne et aux antiennes révolutionnaires à la mode, que L'impasse-temps est non seulement le meilleur roman de Douay (la froideur empesée, les soucis stylistiques, les constructions compliquées de ses débuts sont bien loin !), mais aussi une bouffée d'air pur dans la SF française contemporaine. Vive l'anarchie, et merde à celui qui lira !.. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |
| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |