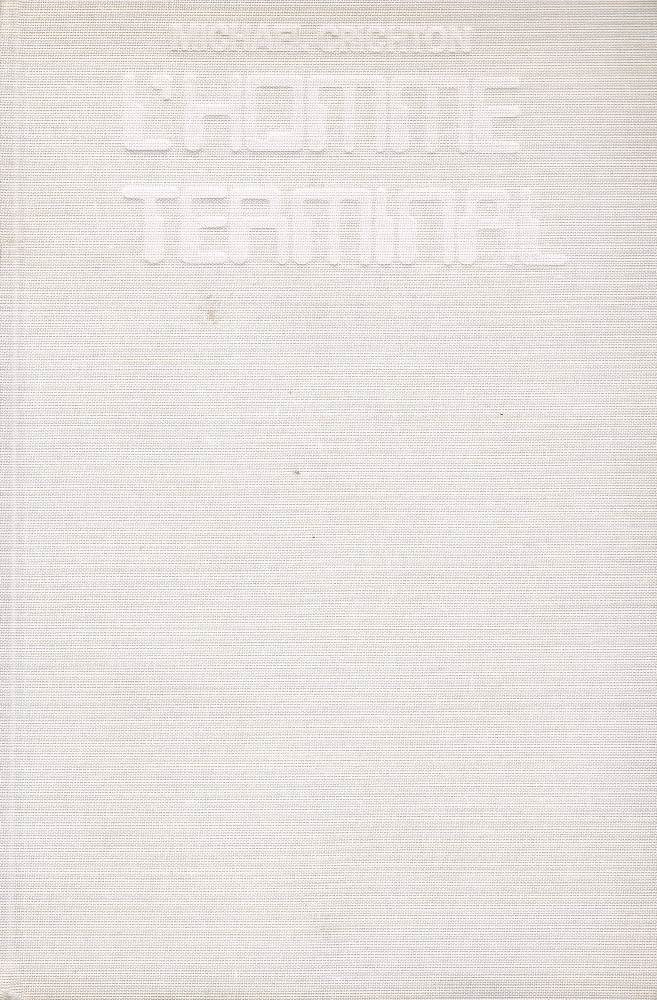|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
L'Homme terminal
Michael CRICHTON Titre original : The Terminal Man, 1972 Première parution : États-Unis, New York : Alfred A. Knopf, mars 1972 (publié aussi dans Playboy de mars à mai 1972) ISFDB Traduction de M. MATIGNON FAYARD (Paris, France) Dépôt légal : août 1974 Roman, 266 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-213-00161-8 ✅ Genre : Science-Fiction Pas de texte sur la quatrième de couverture.
Critiques
Publié en 1972 chez Jonathan Cape, The Terminal Man raconte une opération du cerveau censée se passer en mars 1971. Dans ces conditions, peut-on parler de science-fiction ? De fait, la traduction de M. Matignon sort en France sous l'étiquette « un thriller Fayard » (sic). Mais, pour ce faire, on a éliminé tout ce qui, dans les éditions anglaises et américaines, relevait de la science : schémas de l'encéphale, graphique fourni par ordinateur des stimulations électriques du patient. Restent, cependant, la chronologie des recherches sur l'épilepsie psychomotrice et son traitement chirurgical et électrique depuis un siècle au début du volume, et, à la fin, la bibliographie des ouvrages et communications sur ces sujets : à défaut de science-fiction, il s'agit donc du moins de fiction scientifique. Le traitement d'Harold Benson est présenté comme une suite logique des travaux effectués jusqu'à présent en réalité, et tous les efforts de l'auteur de The Andromeda Strain et de Westworld ont été consacrés à donner le plus de vraisemblance possible à ce récit. Après la découverte de la localisation de l'épilepsie psychomotrice, qui cause de brusques accès de violence, après le traitement par ablation, après l'implantation d'électrodes et l'étude des résultats des stimulations électriques de diverses zones du cerveau sur des animaux puis même sur des hommes, le pas suivant s'impose : le contrôle permanent par ordinateur de l'électro-encéphalogramme du malade, et le déclenchement d'une contre-stimulation dès qu'une nouvelle crise s'annonce. On voit le parallélisme avec Orange mécanique d'Anthony Burgess, ou il s'agissait également, dans une anticipation à très court terme, de confier à l'hôpital et non plus à la prison ou à la chaise électrique le soin d'empêcher un dangereux criminel de nuire. Mais le thème est traité par Crichton de façon bien plus scientifique que par Burgess. Il y a d'abord ici le postulat que, de fait, beaucoup de violents sont des malades ; l'épilepsie psychomotrice pourrait bien être beaucoup plus répandue qu'on ne le soupçonne — et l'auteur cite pêle-mêle gangsters, policiers, casseurs, Hell's Angels. Il y a ensuite une méthode beaucoup plus avancée que le « traitement Ludovico », qui reposait sur le simple conditionnement pavlovien — beaucoup plus avancée même que la lobotomie pratiquée dans Limbo de Bernard Wolfe comme prolégomènes à la non-violence : ici sont mis en jeu, chirurgie, électronique, informatique, cybernétique, énergie nucléaire (pour le régulateur portatif). Enfin, dans le jugement, Crichton n'est pas a priori hostile à ces techniques antiviolence comme Burgess : il consacre au contraire de longs paragraphes à montrer comme est aveugle la réaction courante contre tout contrôle psychique : comme si chacun de nous n'y était pas plus ou moins soumis, comme si les premiers, les principaux, et potentiellement les plus dangereux des conditionneurs, n'étaient pas... les parents ; et l'auteur, par la bouche de Janet Ross, très féminine pourtant, et rien moins que brutale, pose une question très proche de l'objection que je faisais à Burgess dans « Fiction » 232 : vaut-il mieux laisser la violence faire rage ? Et si l'expérience est finalement condamnée, c'est sur le plan purement scientifique et non métaphysique : très rapidement Benson devient une sorte de drogué, et pour obtenir ses stimulations électriques il multiplie les débuts de crise, jusqu'au moment où, le remède n'ayant fait qu'aggraver le mal, et étant désormais impuissant, il vit en état de violence chronique. Par son esprit autant que par son hypothèse de base, le livre de Crichton mérite donc déjà le nom de science-fiction, au sens premier du terme, plus que celui de Burgess qui est plutôt de la social-fiction. Mais de plus, on y trouve à l'état naissant, tout proche encore des faits réels et des notions scientifiques authentiques, nombre de thèmes qui se sont épanouis en suppositions beaucoup plus hardies chez les grands maîtres de l'anticipation à plus longue échéance. L'ordinateur est puéril à force d'être littéral : thème cher à Asimov, notamment dans Lenny. Du régulateur implanté à Benson, on passera un jour à un minuscule ordinateur organique capable d'être greffé : nous voici tout près de Van Vogt avec le « cerveau second » de Gosseyn, de même d'ailleurs que les expériences sur l'apprentissage autonomique (action sur les fonctions censées échapper à la volonté : tension, rythme cardiaque) ne sont pas sans rapport avec la fameuse « pause corticothalamique ». La jouissance par les stimulations électriques du cerveau, c'est les « bonnets à plaisir » de Cordwainer Smith dans la Planète Shayol. La statistique selon laquelle dix millions d'Américains ont des lésions cérébrales évidentes et cinq millions des atteintes plus subtiles ouvre directement sur le monde hallucinant et halluciné de Mais si les papillons trichent de Pierre Suragne. Et quelles envolées ne permet pas l'idée que, lors des crises de violence (quand en somme Mr Hyde se substitue au Dr Jekyll), c'est la domination du système limbique, partie très ancienne du cerveau contrôlant la conduite la plus primitive, colère et peur, désir et faim, attaque et retraite, et spécialisée à l'origine dans l'odorat (cf. « je ne peux pas le sentir »), que l'on peut appeler le cerveau — saurien ! Mais surtout, au centre du livre, c'est bien sûr le thème de la machine, de plus en plus indispensable, autonome et omnipotente — et là, faute de pouvoir tout citer, on rappellera seulement le passage des Voix de James E. Gunn dans « Fiction » 241 : « Toutes les civilisations ont leurs fantômes. En général ce sont les dieux de la précédente... Les fantômes de cette civilisation sont dans ses machines » ; et l'histoire de Fritz Wood (Galaxie 20) ou le Pense-bête conçu à l'origine pour pallier les distractions, mais aussi assurer l'équilibre endocrinien et rendre l'humeur égale (tout à fait comme le régulateur de l'Homme terminal, donc) se met à penser pour lui-même et réduit l'homme en esclavage. Telle est précisément l'obsession de Benson après qu'un accident d'automobile a perturbé ses facultés mentales. Comme il était spécialiste des ordinateurs, il se considère comme traître pour avoir contribué à rendre plus intelligentes les machines, qui se disposent à prendre la relève. Pour lui, une date-clé est juillet 1969, où la capacité de traitement de connaissances de tous les ordinateurs du monde a dépassé celle de tous les cerveaux humains. Il a une fascination ambiguë pour les danseuses et les strip-teaseuses, qui sont « du mécanique plaqué sur du vivant » : en est une la première personne qu'il tue, avec un tournevis, et après avoir fait l'amour avec elle ; ses victimes ont d'ailleurs généralement quelque rapport avec les machines. Bien entendu, l'opération qu'il a subie ne fait qu'accroître sa paranoïa, car le voici relié à un ordinateur, soumis à lui, transformé en terminal humain — d'où le titre. Et voici que cette machine fait de lui, inexorablement, une machine à tuer. Alors, bien sûr, on peut lire le livre comme un « thriller » semblable au fameux Psychose d'Hitchcock, et frémir de pitié et de terreur avec l'héroïne. Mais il y a aussi une réflexion profonde et vaste sur l'avenir qu'ouvre à notre société son orientation scientifico-technologique : n'est-ce pas une définition de la science-fiction ? George W. BARLOW Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)
Terminal Man (The) , 1974, Mike Hodges |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |