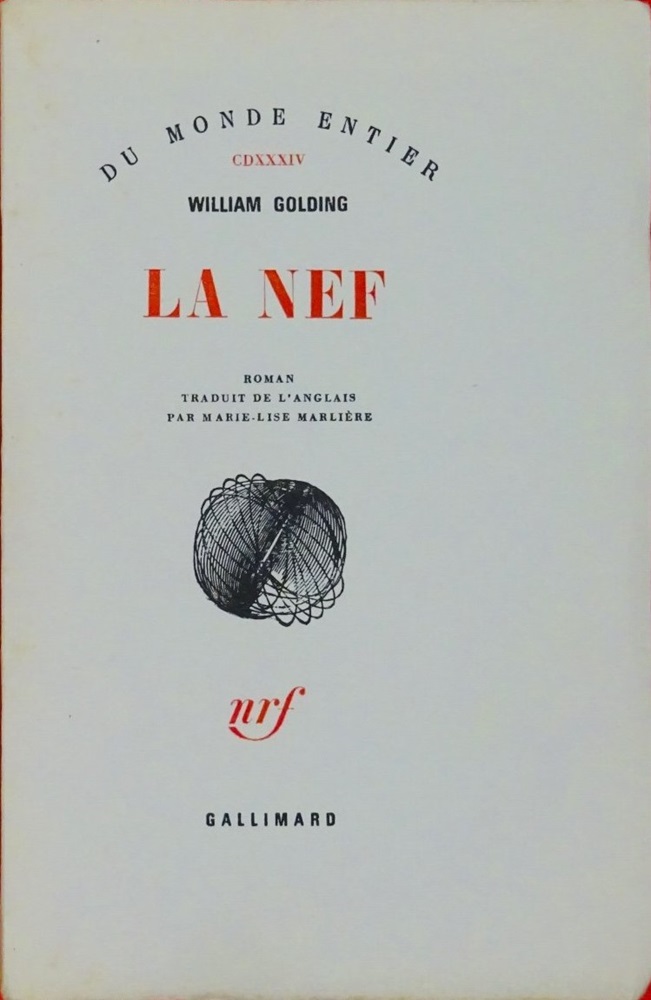|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Nef
William GOLDING Titre original : The Spire, 1964 Première parution : Faber and Faber, 1964 ISFDB Traduction de Marie-Lise MARLIÈRE GALLIMARD (Paris, France), coll. Du monde entier   Date de parution : 1966 Roman, 280 pages, catégorie / prix : 16 F ISBN : néant ❌ Genre : Fantastique Pas de texte sur la quatrième de couverture.
Critiques
C’est un roman paradoxal dans une atmosphère fantastique que nous donne une nouvelle fois William Golding. Et c’est au fond le même démon qu’il pourfend ici et qu’il poursuivait déjà dans Le Dieu des Mouches, un démon qui ôte toute humanité à celui qu’il possède et qui se nomme isolement. Il est remarquable qui ni les héros adolescents du Dieu des Mouches, ni Jocelin, le bâtisseur de cathédrale de La nef, ne soient tentés par ce démon de s’abandonner à cette part animale que les classiques voyaient volontiers dans l’homme. Du mal, Golding ne se fait pas l’idée d’un retour à la bestialité, d’un abandon aux instincts, il n’oppose pas, en l’homme, l’ange et la bête. Il oppose l’homme hors de la société à l’homme dans la société. Le premier est aliéné, autre chose qu’humain au sens où nous l’entendons dans notre culture, c’est-à-dire moins qu’humain. Mais son isolement ne le rend pas pour autant à un état de nature. Il n’est qu’un préhumain, un présocialisé. Il aura à faire ou plutôt il aura à refaire les étapes qui ont conduit à l’homme social, dont la mémoire dépasse les souvenirs de l’individu, dont la morale transcende les dégoûts ou les émotions spontanées de l’individu. Et s’il n’y parvient pas, il est perdu. Au mythe rousseauiste du « bon sauvage », Golding opposait les adolescents du Dieu des Mouches. Parce que la marque de la société n’est pas en la plupart d’entre eux suffisamment profonde, ils l’oublient et évoluent vers quelque chose d’autre, qui n’est que superficiellement primitif, qui est en fait abhumain. Au mysticisme qui est une façon de sortir de l’humanité par le haut, de se mettre à part ou de se croire mis à part, Golding oppose la déraison de Jocelin. Ainsi définit-il l’humain de deux côtés, l’un qui est antérieur à la civilisation et l’autre qui est dans la culture, mais qui est tentation d’échapper à l’Histoire, à ses misères et à ses limitations. Jocelin, doyen de Salisbury, veut doter sa cathédrale de la plus haute flèche d’Angleterre. Il a réuni l’argent et peu lui importe que sa source soit impure. Dieu le purifiera, il a réuni le meilleur maître d’œuvre et les meilleurs ouvriers et ne se soucie pas que leurs vies soient brisées pourvu que la flèche s’élève. Dieu sanctifiera leur sacrifice. Mais le chœur que la flèche doit surmonter n’a pas de fondations. Il ne peut supporter le poids, celui de la sainteté, que Jocelin veut lui imposer. Ses fines colonnes ont été édifiées sur des fascines et sur de la boue, sur un marais. Et les pierres crissent, les nervures se tordent et la terre se convulse tandis que grandit la tour. Jocelin n’en a cure. Un ange, pense-t-il, lui est apparu et il se croit élu. Qu’importent les fondations puisque, pour lui, le moteur du monde, c’est le miracle ? Le plus grand péché d’orgueil, celui de Jocelin, c’est de croire que Dieu existe, et que les hommes peuvent s’en trouver déchargés du poids des réalités, c’est de faire comme si, au-delà du labeur et du génie humains, il y avait autre chose qui serait à soi seul une solution. Jocelin se meut dans un univers de plus en plus éthéré, il s’asphyxie de plus en plus dans l’altitude, il croit s’élever au-dessus des hommes alors qu’il ne fait que se retrancher d’eux et se retrancher de lui-même. Il devient un maudit et il entraîne dans cette damnation temporelle qu’est la folie les artisans de sa cathédrale. La flèche est devenue pleinement la Folie de Jocelin, comme on la nomme dans tout la pays. Ainsi, comme Le Dieu des Mouches, La nef est une fable tragique. Golding ne profite ni de l’époque ni du décor pour en faire un « roman historique ». Il décrit seulement – ou plutôt démontre – le cheminement d’une aliénation particulière à une époque, avec peut-être moins de bonheur que dans son précédent livre. C’est sans doute qu’il est plus malaisé de traiter de l’aliénation de l’homme par l’imaginaire que de l’homme nu. Peut-être abordera-t-il dans son prochain roman l’aliénation de l’homme par la raison, ou plutôt par l’abstraction, par une logique anhistorique, c’est-à-dire, pour la situer dans notre temps, le vestige technocratique. Gérard KLEIN |
| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |