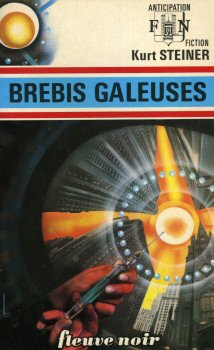|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Brebis galeuses
Kurt STEINER Illustration de René BRANTONNE FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 596 n° 596  Dépôt légal : 1er trimestre 1974 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
Rolf regardait à la dérobée celui qui semblait présider. II n'était pas rasé, portait un petit chapeau noir baissé sur le nez, et le col de sa chemise sale était largement ouvert. — Avancez, dit le Président en levant très haut la tête pour voir Rolf sous le bord de son chapeau. Rolf avança autant qu'il put, c'est-à-dire de la moitié d'un pas. Ainsi, il se trouva tout contre la table. — Alors, reprit le Président en levant encore plus haut la tête, on raconte des conneries à propos de la Terre et du Ciel ? En attendant la réponse de Rolf, il tira de sa poche un mégot qu'il alluma et se mit à mâchonner...
Critiques
Brebis galeuses de Kurt Steiner entretient de nombreuses relations thématiques et dramatiques avec Tunnel d'André Ruellan. Cela n'a rien d'étonnant puisque l'auteur de l'un est aussi l'auteur de l'autre, mais cela peut signifier en outre que les deux faces de ce Janus tendent à se rejoindre, que le monde sarcastique du Manuel du savoir-mourir s'intègre aux épopées épicosociologiques des Enfants de l'histoire et d'Ortog et les ténèbres. En d'autres termes, que la schizophrénie obligée des porteurs de pseudonyme s'ouvre sur un monde mental cohérent, qui témoigne des préoccupations psychosociales du citoyen écrivant Ruellan. En apparence, le monde de Brebis galeuses, c'est le nôtre quelque peu décalé, comme celui de Tunnel était le nôtre plus ou moins projeté dans le futur : surpopulation, pollution, misère psychique et sociale, omniprésence de la police, tout cela nous est familier, et remonte d'ailleurs pour le moins à Nous autres de Zamiatine, c'est-à-dire à l'époque où des écrivains commencèrent à se servir du roman de science-fiction pour décrire une société de contrainte et d'aliénation, celle-là même où ils vivaient. A ce titre, les réflexions abondent qui indiquent bien que Steiner parle de son époque et de sa société : « Il y a près de trente ans que tu es en vie et jamais tu n'as assisté à une telle offensive de la police, à une telle bousculade d'arrestations... Il ne sera bientôt plus possible de se déplacer... » (p. 86). On trouve naturellement au centre du roman le héros-type de ce genre d'histoire, l'individu qui prend conscience de son aliénation, se révolte, passe dans le camp des marginaux. Dans Tunnel, le docteur Manuel Dutôt rejoignait les Crânes dans les terrils d'ordures, dans Brebis galeuses Rolf B 40 s'échappe dans la zone pour vivre avec ces parias d'un nouveau genre que sont les malades. Car c'est également sur un concept médical que s'articule la prise de conscience : alors que Manuel voulait vaincre les tabous conjugués de la naissance et de la mort, Rolf veut lutter contre la maladie, qui fait office de châtiment dans un univers social où elle a été totalement vaincue. On sent ici, une nouvelle fois, l'empreinte du diabolique docteur Ruellan, et l'idée est en elle-même ingénieuse : le corps social « sain » rejette dans les enfers physiologiques ceux qu'il veut punir, et on voit ainsi Rolf (qui a subi la « piqûre n° 25 » parce qu'il a eu des paroles malheureuses à rencontre du gouvernement), assailli par les affres bénignes mais effrayantes parce qu'inconnues de la grippe, s'allier aux cancéreux et aux tuberculeux de la zone... Là encore, le lien avec notre société, où il faut paraître jeune et bien fait pour avoir du travail, et où vieillards et autres grabataires sont remisés dans les bas-fonds sociaux, est directement perceptible. Mais sur le simple plan thématique, l'ingéniosité de Steiner ne s'arrête pas là. Sans doute contaminé, à l'instar de Michel Jeury, par l'exemple du gigantesque Dick, il nous offre avec Brebis galeuses sa propre version de la plasticité de l'univers : le monde de Rolf, et Rolf lui-même, n'est que le rêve comateux d'un soldat d'une guerre bactériologique future, qui délire sur son lit d'hôpital. Rêve de fièvre, qui se concrétise en la création d'un univers fictif où le concept de maladie est partie intégrante, et même constituante, de la ségrégation sociale ! Et Rolf, projeté dans l'univers véritable, comprend qu'il est tombé de Charybde en Scylla : le monde d'où il vient n'était que la métaphore un peu incohérente de celui où il va vivre désormais, et qu'on devine plus implacable encore, tout simplement parce qu'il est vrai. On reprochera certes à Steiner l'aspect quelque peu parachuté de cette fin qui, pour astucieuse qu'elle soit, n'était peut-être pas indispensable, et fait penser à l'élucidation pareillement abrupte d'Odyssée sous contrôle de Wul. Mais les conditions de production du Fleuve Noir sont connues, et seuls les naïfs s'étonneront du fait que Brebis galeuses n'ait pas le fini de Tunnel, élaboré sous l'il redoutable de maître Klein. Cependant, quelques échappées typiquement steineriennes (« Au pays des aveugles, dit Rolf, on attrape les borgnes et on leur crève l'il ») viennent nous rappeler que l'auteur est toujours maître de sa plume, où qu'il la pose. Dorémieux écrivait récemment qu'André Ruellan était un « vrai écrivain », autant le dire deux fois qu'une. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |
| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |