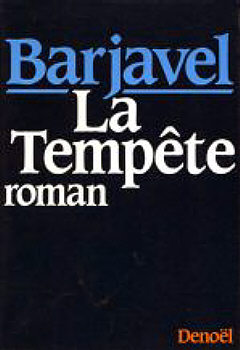|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Tempête
René BARJAVEL Première parution : Paris, France : Denoël, 1982 DENOËL (Paris, France) Dépôt légal : 1982 Roman, 282 pages, catégorie / prix : 74 F ISBN : 2-207-22829-0 ❌ Genre : Science-Fiction
Critiques
« Sous le Nuage. Neige. Pluie. Vapeur équatoriale. Atmosphère de frigo ou de machine à laver, baignant partout la terreur et le désespoir. (...) Vingt et une bombes, déjà. Quatre en Europe, trois en Russie, cinq en Chine, sept en Amérique du Nord, deux en Amérique du Sud. Après Rome, Marseille a disparu. Dans son échancrure, la Méditerranée monte maintenant jusqu'à Tarascon. Lyon a laissé un trou dans lequel le Rhône et la Saône tombent en cataractes (...) La Bombe destinée à New York était spécialement programmée ; elle s'est immergée dans l'Atlantique, a remonté l'Hudson puis les égouts et a sauté sous Manhattan. Les gratte-ciel ont jailli droit vers le Nuage, l'ont traversé et se sont épanouis en un bouquet de débris de béton et de ferraille qui sont retombés avec des trombes d'eau sur les New-Yorkais en fuite. » Voilà une prose de fin du monde qui a le goût de Barjavel. Mais pourquoi Barjavel a-t-il ainsi le goût de la fin du monde ? Ce n'est plus un cri d'avertissement, c'est maintenant devenu une habitude, sans doute aussi un plaisir... Rappelez-vous : en 1940 déjà, c'était Ravage, qu'on a voulu pétainiste, avant de le vouloir écolo. En 1946, Le diable l'emporte (à mes yeux le Barjavel le plus fort, le plus accompli), sur quoi la guerre était passée : plus d'utopie campagnarde, juste une arche enterrée avec un dernier couple. En 68 (mais oui : en 68), le retour, avec La nuit des temps, encore un couple, une arche enterrée, mais venant cette fois du passé. Un bon livre, que les pros — n'est-ce pas, Dorémieux ? — ont accueilli en faisant la fine bouche. En 80, après un détour par le journalisme, les petites fleurs et la collaboration (mais non : avec Olenka de Veer...), un quatrième maillon cataclysmique, le plus faible, et qui n a pas fait couler beaucoup d'encre, Une rose au paradis (qui vient d'être réédité chez Presses Pocket), encore un richissime qui sauve le dernier couple mais cette pâle resucée du Diable l'emporte n'est que prosisation (est-ce comme ça qu'on dit ?) d'une pièce de théâtre vieille d'une vingtaine d'années : Jonas dans la baleine... En 82, voilà donc La tempête, un titre qui en vaut bien un autre, mais on ne dira pas qui ça évoque parce que la perche est vraiment trop grosse. Et qu'est-ce que ça raconte. La tempête ? D'abord une guerre sino-américaine (vraiment datée) qui se termine dans la joie après la découverte d'une love molécule qui met tout le monde d'accord (vraiment facile). Ça redémarre avec une catastrophe écologique (la Terre se couvre d'un manteau de nuages causé par la pollution des nouveaux moteurs à hydrogène : là, ça devient pas mal) et ça se poursuit par l'inévitable fou (un amoureux éconduit) qui détourne des stocks de bombes nucléaires et les balance sur la Terre (c'est là où Barjavel est le plus à l'aise, dans le cataclysmique conté d'un ton sarcastique), jusqu'au moment où la Femme le séduit et où, d'amour à la mort, la planète sera sauvée mais vraiment de justesse (ça recommence à être facile, mais quoi, c'est du Barjavel). Au total ? Un roman bien sûr très lâchement, trop lâchement construit et fait d'un bout-à-bout de situations, un roman qu'on a déjà lu cinq fois (mais ça peut être aussi un plaisir), un roman qui s'avale comme du petit lait, parce qu'indéniablement l'auteur n'a (presque) rien perdu de sa verve, même s'il est non moins indéniable qu'il vise le commercial à poils mous. Ceci dit, on peut revenir à la case départ. Pourquoi Barjavel ne nous parle-t-il que de la fin du monde ? Parce qu'il en a peur ? Parce que ça se vend ? Parce qu'il ne sait faire que cela 7 Et pourquoi ses fins du monde sont-elles tracées d'une plume de plus en plus nonchalante, poète, abstraite, désengagée, jusqu'à décharger complètement ses apocalypses de tout contenu dramatique et idéologique ? Pourquoi une amusette (qui n'a rien à voir avec l'humour noir de Kubrick) sur la terreur à l'état brut ? Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |