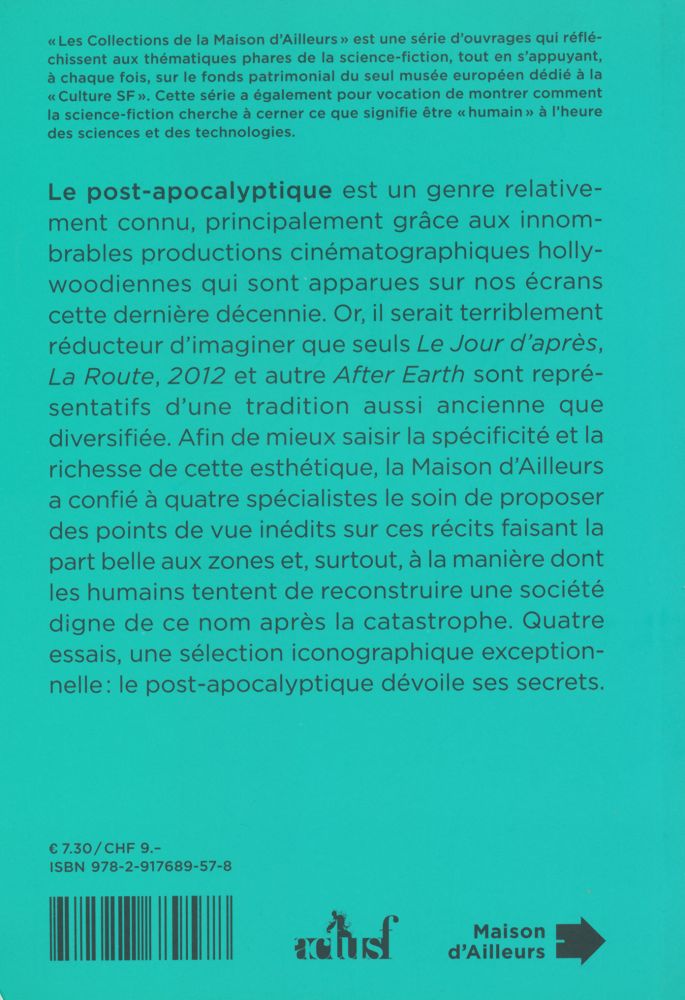|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Post-apocalyptique
COLLECTIF Textes réunis par Marc ATALLAH ActuSF (Chambéry, France), coll. Les Collections de la Maison d'Ailleurs n° 1  Dépôt légal : septembre 2013 Première édition Recueil d'articles, 96 pages, catégorie / prix : 7,30 € ISBN : 978-2-917689-57-8 Format : 12,0 x 17,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Graphisme : Notter + Vigne
Quatrième de couverture
« Les Collections de la Maison d'Ailleurs » est une série d'ouvrages qui réfléchissent aux thématiques phares de la science-fiction, tout en s'appuyant, à chaque fois, sur le fonds patrimonial du seul musée européen dédié à la « Culture SF ». Cette série a également pour vocation de montrer comment la science-fiction cherche à cerner ce que signifie être « humain » à l'heure des sciences et des technologies.
Le post-apocalyptique est un genre relativement connu, principalement grâce aux innombrables productions cinématographiques hollywoodiennes qui sont apparues sur nos écrans cette dernière décennie. Or, il serait terriblement réducteur d’imaginer que seuls Le Jour d’après, La Route, 2012 et autre After Earth sont représentatifs d’une tradition aussi ancienne que diversifiée. Afin de mieux saisir la spécificité et la richesse de cette esthétique, la Maison d’Ailleurs a confié à quatre spécialistes le soin de proposer des points de vue inédits sur ces récits faisant la part belle aux zones et, surtout, à la manière dont les humains tentent de reconstruire une société digne de ce nom après la catastrophe. Quatre essais, une sélection iconographique exceptionnelle : le post-apocalyptique dévoile ses secrets.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Marc ATALLAH, Raconter les zones dévastées..., pages 6 à 9, préface 2 - Francis VALÉRY, Des Fourmis et des Zones, pages 10 à 28, article 3 - Francis VALÉRY, Ce fut une bien belle Apocalypse !, pages 30 à 48, article 4 - Frédéric MAIRE, Boum, quand le cinéma fait boum, pages 50 à 74, article 5 - EUGÈNE & Alexandra KAOUROVA, Stalker. Expérimenter la Zone, pages 76 à 90, article 6 - (non mentionné), Pour aller plus loin..., pages 92 à 93, bibliographie
Critiques
Fruit de la collaboration entre les éditions ActuSF et la Maison d’Ailleurs, le présent ouvrage reprend quelques-uns des éléments présentés en septembre 2013, lors de l’exposition consacrée au film Stalker d’Andreï Tarkovski et à ses sources d’inspiration, notamment le roman des frères Strougatski (chez Denoël). À cette occasion, les organisateurs ont également présenté au public des documents issus des collections de l’institution helvète ressortissant de l’esthétique post-apocalyptique dont relève à la fois le roman et le film. On se trouve devant un bel objet – impression sur papier glacé, maquette sobre, abondante iconographie en couleurs – mais dont le format et la pagination (95 pages dans un petit livre de poche) ne permettent qu’un survol du sous-genre. Il ne faut pas s’attendre à une étude exhaustive, plutôt à une sélection éclairée par le propos de quelques spécialistes. L’ouvrage se compose de cinq textes, introduction y comprise, assortis de pistes bibliographiques. Parmi ceux-ci, les deux articles de Francis Valéry semblent les plus dignes d’intérêt. Il dresse dans « Des fourmis et des zones » un parallèle entre le corpus post-apocalyptique et l’étude entomologique, l’humain devenant l’insecte par une inversion des perspectives. Éradiquée parce qu’elle constitue un obstacle ou une menace, exploitée, soumise à une étude par le prélèvement régulier d’échantillons, ou plus simplement ignorée, l’espèce humaine est descendue de son piédestal, ravalée du sommet à la base de la pyramide de l’évolution. De quoi relativiser bien des jugements… Dans le deuxième article (« Ce fut une bien belle Apocalypse ! »), Francis Valéry, encore, met en relation le surgissement du sous-genre avec la crainte de l’anéantissement nucléaire, né durant la Guerre froide. Il pointe les convergences thématiques issues de la contre-culture avec celles nées des œuvres d’auteurs inquiets du devenir de l’humanité. Par l’intermédiaire de titres provenant essentiellement de la bande dessinée, Valéry démontre, non sans malice, que les apôtres de la fin du monde sont surtout de grands optimistes ne pouvant imaginer de fin définitive pour l’homme. La suite de l’ouvrage s’avère plus décevante. Dans « Boum, quand le cinéma fait boum », Frédéric Maire nous propose un panorama des récits racontant l’après-fin du monde au cinéma. Apparemment ordonnée de manière chronologique, la sélection apparaît décousue et lacunaire. On en ressort frustré avec au mieux une liste de films à visionner. D’autant que la frustration vire clairement à l’agacement avec l’article consacré à Stalker. L’analyse de l’œuvre de Tarkovski est expédiée. L’auteur lui préfère la description de la scénographie de l’exposition. Au final, malgré quelques qualités (l’iconographie et les articles de Francis Valéry), Le Post-apocalyptique se révèle un ouvrage tout à fait dispensable. On attend maintenant un véritable essai sur le sujet. Laurent LELEU |
| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |
| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |