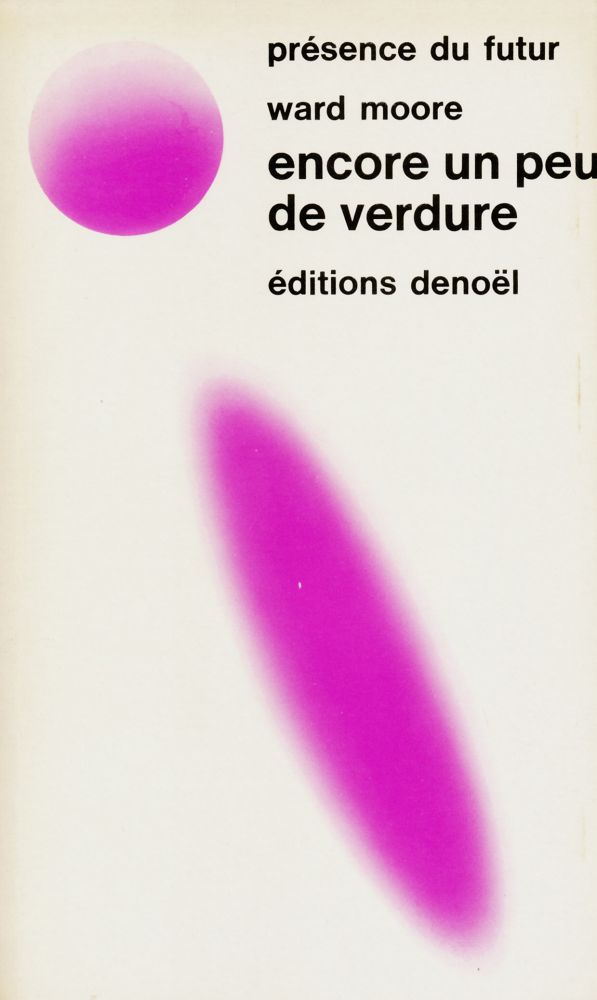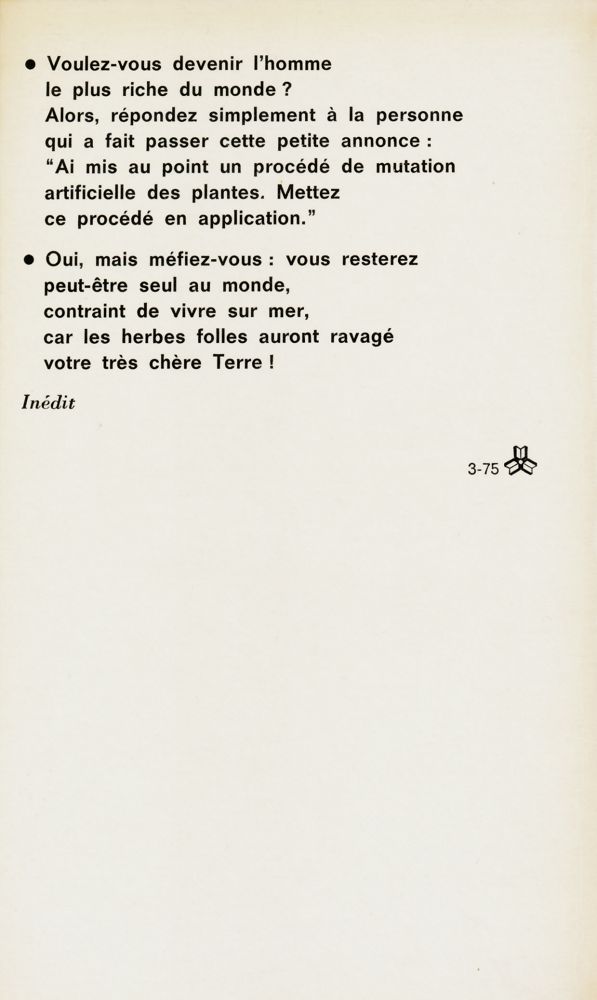|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Encore un peu de verdure
Ward MOORE Titre original : Greener Than You Think, 1947 Première parution : William Sloane Associates, 1947 ISFDB Traduction de Jane FILLION DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 194 n° 194  Dépôt légal : 1er trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 18 février 1975 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
• Voulez-vous devenir l'homme le plus riche du monde ? Alors répondez simplement à la personne qui a fait passer cette petite annonce : "Ai mis au point un procédé de mutation artificielle des plantes. Mettez ce procédé en application." • Oui, mais méfiez-vous : vous resterez peut-être seul au monde, contraint de vivre sur mer, car les herbes folles auront ravagé votre très chère Terre !
Critiques
[Critique de Les fleurs de février de Kenneth Harker et de Encore un peu de verdure de Ward Moore] En ces temps de cataclysmes tant littéraires que cinématographiques dont on nous abreuve et qui sont signes des temps (les crises suscitent toujours des « réponses » artistiques qui amplifient, déforment, métaphorisent les phénomènes réels, en même temps qu'elles font fonction de catharsis), il est frappant de constater combien souvent !a végétation est mise à contribution : Les triffides, Les fleurs de Février, Encore un peu de verdure (en attendant Terre brûlée de John Christopher, qui mijote dans l'énorme cuve gestative du C.L.A.) relatent tous des avatars de l'herbe en folie : elle devient intelligente et mobile chez Windham, elle est sensitive et hypnogène chez Harker, elle croît à une vitesse folle chez Moore, elle crève chez Christopher. A la vue de ces exemples, il serait donc tentant, pour un chroniqueur frappé, tel votre serviteur, par le démon triomphant de l'écologie, de faire le lien entre les ouvrages cités et les périls actuels qui menacent l'environnement... Hélas ! trois fois hélas ! trois des quatre ouvrages, justement, ont une moyenne d'âge qui les rejette hors de ce champ (c'est te cas de dire !) : Encore un peu de verdure date de 1947, Les triffîdes de 1950, Terre brûlée de 1954. Seul, Les fleurs de Février accuse un copyright de 1970. Faut-il alors faire machine arrière et ne voir, dans cette prolifération végétale, qu'une pure coïncidence ? Pas davantage... Car l'ennemi qui a médiatisé les peurs diffuses de l'humanité a de tout temps été la Nature, souvent dangereuse et prompte à se révolter (ouragans, volcans, raz de marée, tremblements de terre), et la science-fiction a, depuis ses origines, accaparé cette peur, renchérissant sur elle sans forcément y chercher des justifications écologiques. A ce titre, l'herbe n'a pas d'autre signification que les calamités naturelles évoquées plus haut, elle est simplement un signe : le catalyseur du récit. Et malgré ça, ces récits de fin du monde sont parfaitement accordés à leur époque : 47, 50, 54, c'est la guerre froide et la peur atomique. C'est la peur du cataclysme en grand — qui prend ici une forme allusive, métaphorique. Quant au récit de Harker, daté de 1970, il procède, comme on le verra plus loin, de préoccupations effectivement écologiques : le lien à l'époque subsiste mais s'est débarrassé de toute subtilité métaphorique. La vision est maintenant directe, documentarisée. Enfin, il est significatif de noter que trois sur quatre de nos auteurs (le mouton noir est Ward Moore) sont Anglais. Ce n'est un secret pour personne que la Grande-Bretagne est, depuis la fin de la guerre, une terre d'élection pour les cataclysmes littéraires. On peut se demander pourquoi. J'y verrais pour ma part une « réponse » à la fin de la traditionnelle invulnérabilité de l'île, dont les bombardements par V 1 et V 2 avaient durement secoué le moral de la population. Piochons entre les lignes, on trouvera toujours la graine... • Passons maintenant rapidement aux ouvrages eux-mêmes, non sans avoir éliminé Les triffides, déjà analysé ici, et Terre brûlée, dont la traduction n'est pas encore disponible au moment où j'écris ces lignes. Dans Les fleurs de Février, récent, documentaire, écologique, Harker essaye de rendre compte de plusieurs phénomènes puisés dans l'actualité ou dans sa vision prospective : la satellisation, à la limite de l'atmosphère terrestre, de nappes d'aiguilles de cuivre destinées à réfléchir les ondes radios (action réellement envisagée au début de la décennie !), et qui perturbent le climat jusqu'à provoquer le retour d'une mini-ère glaciaire ; les maladies et la stérilité décimant l'humanité, et la création d'une race plus robuste, les « Enfants de Février », dont l'apparition est la cause d'une nouvelle ségrégation sociale et de nouveaux conflits ; la famine qui menace et les recherches mutationnelles sur des plantes alimentaires ; enfin, la croissance de végétaux vaguement conscients, capables d'hypnotiser les humains, et dont les spores transmettent une maladie mortelle... C'est une bonne chose que de vouloir mêler plusieurs thèmes pour donner une représentation plausible d'une époque d'écocataclysmes en chaîne (l'action se déroule au milieu du XXIe siècle), car les relations socio-écologiques sont loin d'être univoques... Malheureusement, Harker n'est pas Brunner, et Les fleurs de Février sont à des années-lumière du Troupeau aveugle : l'auteur, dans les 240 petites pages que compte son bouquin, n'a pas disposé d'assez de place pour construire un monde d'une complexité assez poussé pour qu'il soit crédible. Les décors sont incomplètement dessinés, les personnages sont juste ébauchés, les actions sont confuses et tournent court. On navigue dans le récit de Harker comme à travers un brouillard épais, où rien n'est vraiment saisissable, où rien n'accroche véritablement l'attention, l'intérêt, la sympathie. De plus, l'auteur se livre à une sorte de détournement de thème qui vient tout ficher en l'air, dans la deuxième partie du livre : les plantes belliqueuses ne sont pas un résultat secondaire de la pollution, comme on aurait pu le croire, mais elles ont été ensemencées sur Terre par les habitants de Rigel Centauri, qui veulent ainsi exterminer nos semblables. Du péril écologique, et par un véritable tour de passe-passe, on glisse ainsi vers la classique invasion de la Terre : Harker a dû lire Génocide, de Disch, mais cette nouvelle comparaison est aussi écrasante pour lui que celle avec Brunner. Bref, si Les fleurs de Février ne sont pas absolument nul les (on les lit malgré tout d'une traite car on se demande constamment comment ça va finir et où l'auteur veut en venir), elles le sont quand même un peu. • Contrairement à la structure éclatée des Fleurs..., Encore un peu de verdure présente un développement rigoureusement linéaire : parce qu'une vieille folle, Miss Francis, a inventé une sorte de fertilisant miracle, le Métamorphosant, parce qu'un représentant de commerce sur la touche, Albert Weener, en a fait l'essai sur la pelouse miteuse d'un paisible citoyen d'un bas-quartier de Los Angeles, le monde subit une invasion contre laquelle science et technique ne peuvent rien, et périt étouffé. C'est aussi simple que cela : l'herbe des Bermudes (dite aussi herbe-du-diable), touchée par le produit de Miss Francis, devient si robuste et croît avec une telle rapidité que rien ne peut s'opposer à son avance. Los Angeles est bientôt recouverte, puis les Etats-Unis, puis le reste du monde. Aussi simple que cela, vous disais-je... Et bien plus drôle que vous ne pourriez le penser ! ! En fait, Encore un peu de verdure (Greener than you think en anglais — pour pasticher le Darker than you think de Jack Williamson) est un vrai chef-d'œuvre d'humour noir — pardon, d'humour vert ! — et, je vous le dis tout net, un vrai chef- d'œuvre tout court. L'auteur a délibérément choisi le style comédie pour nous conter sa peu banale fin du monde, écrite à la première personne par la plume de Weener lui — même qui, près de sa fin, a décidé de coucher son histoire sur le papier. Le récit de la montée de l'herbe, fait par un irresponsable égoïste et mégalomane, devient une loufoquerie colossale, une hénaurmité digne des plus beaux exemples de l'humour à l'américaine qui ne craint pas, contrairement à celui à l'anglaise qui se chausse en daim, de marcher avec de gros sabots. En l'occurrence, ces sabots sont ceux du spectacle et de la satire. Spectacle, Encore un peu de verdure a le souffle des grandes productions cinématographiques, avec mouvements de foule, vues aériennes, technicolor, grand écran et son stéréophonique, sans oublier quelques incidentes au récit, comme cette Troisième Guerre mondiale au cours de laquelle bon nombre de divisions russes débarquées sur le sol américain (0 scandale !) sont avalées en douceur en profondeur par l'herbe-du-diable. D'ailleurs, tout commence à Los Angeles, dont Hollywood n'est qu'un quartier : cet ancrage ne trompe pas. Satire, le roman l'est de l'arrivisme individuel à l'américaine, et du capitalisme collectif à l'américaine, l'un suscitant l'autre (raccourci simpliste mais efficace) et les facteurs étant intégrés dans la seule personnalité de l'abominable Weener, qui fait tranquillement fortune avec la production d'un aliment de synthèse dont le brevet a été escroqué à un naïf, tandis que le monde croule, ou plutôt se rétrécit irrévocablement autour de lui. On n'oubliera pas de sitôt sa phrase favorite : Dans la limite du raisonnable, bien entendu, qui fera désormais pendant, dans les annales de la SF, au C'est la vie de Kurt Vonnegut Jr. On croit toujours que les traductions ont épuisé le fond classique anglo-saxon. Celle du roman de Moore, qui s'est faite avec le confortable retard de 28 ans, nous prouve qu'il y a encore du fameux à glaner dans ce fond-là... Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) |
| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |
| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |