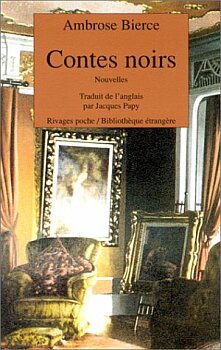|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Contes noirs
Ambrose BIERCE Traduction de Jacques PAPY RIVAGES (Paris, France), coll. Bibliothèque étrangère  n° 59 n° 59  Dépôt légal : novembre 1991 Recueil de nouvelles, 160 pages ISBN : 2-86930-513-3 ❌
Quatrième de couverture
Dans ces douze contes, Ambrose Bierce a oublié son cynisme et sa misanthropie pour laisser la place à un sens profond de la misère humaine, une étude subtile du mécanisme de la peur, une incursion troublante dans le royaume du surnaturel. « Ambrose Bierce compte au nombre de ceux pour lesquels écrire est un art difficile et qui mérite tous nos soins. Ce fossoyeur impénitent, ce familier de la mort, ce compagnon des ombres, est un des derniers classiques de la littérature mondiale. » Jacques Papy
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Jacques PAPY, Connaissance d'Ambrose Bierce, pages 7 à 10, préface 2 - Par une nuit d'été (One Summer Night, 1906), pages 11 à 13, nouvelle, trad. Jacques PAPY 3 - La Fenêtre condamnée (The Boarded Window, 1891), pages 15 à 22, nouvelle, trad. Jacques PAPY 4 - Histoire de fou (John Hardshaw: The Story of a Man Who May Be Seen Coming out of the Nose / The Man Out of the Nose, 1887), pages 23 à 34, nouvelle, trad. Jacques PAPY 5 - Les Funérailles de John Mortonson (John Mortonson's Funeral, 1906), pages 35 à 37, nouvelle, trad. Jacques PAPY 6 - Le Décor approprié (The Suitable Surroundings, 1889), pages 39 à 51, nouvelle, trad. Jacques PAPY 7 - Veillée funèbre (A Watcher by the Dead, 1889), pages 53 à 70, nouvelle, trad. Jacques PAPY 8 - L'Homme et le serpent (The Man and the Snake, 1890), pages 71 à 82, nouvelle, trad. Jacques PAPY 9 - Une sacrée garce (A Holy Terror, 1882), pages 83 à 106, nouvelle, trad. Jacques PAPY 10 - Le Troisième orteil du pied droit (The Middle Toe of the Right Foot, 1890), pages 107 à 121, nouvelle, trad. Jacques PAPY 11 - L'Inconnu (A Stranger / The Stranger, 1909), pages 123 à 131, nouvelle, trad. Jacques PAPY 12 - La Route au clair de Lune (The Moonlit Road, 1907), pages 133 à 149, nouvelle, trad. Jacques PAPY 13 - Un habitant de Carcosa (An Inhabitant of Carcosa, 1890), pages 151 à 157, nouvelle, trad. Jacques PAPY Critiques des autres éditions ou de la série
Jacques Papy, introducteur en France de Lovecraft et d'Ambrose Bierce, n'est pas seulement un traducteur de grand talent : dans le nouveau recueil qu'il publie chez Losfeld, il a lui-même assuré le choix des nouvelles ; en outre, il les a classées et, pour plus de sûreté, préfacées. Cette forme de concentration verticale est la logique même, et devant l'excellence du résultat, on se prend à regretter qu'elle ne soit pas plus répandue, et qu'aux traducteurs sans responsabilités répondent, presque partout, des directeurs de collections qui contrôlent de trop loin la réalisation de leurs programmes. Il est vrai que la formule de Jacques Papy exige du traducteur un talent et surtout une conscience que la plupart de ses confrères ne concevraient pas de fournir à si bon compte, à supposer qu'ils en soient capables. Les « Contes noirs » sont donc une réussite, et d'autant plus remarquables qu'ils apportent du nouveau, comme le souligne fort justement la préface. Le plus grave défaut de l'humour noir, c'est la monotonie : les précédents recueils de Bierce nous donnaient de lui une image que la définition de Jacques Papy (« cynisme et misanthropie ») recouvre à peu près entièrement. Pour moi, Bierce était toujours un peu resté l'auteur de la première phrase que j'aie lue de lui, phrase des plus saisissantes assurément : « Un beau matin de mai 1872, j'assassinai mon père, ce qui, à l'époque, me fit une profonde impression. » Le grand intérêt des « Contes noirs » est de varier les effets : le portrait de leur auteur s'en trouve considérablement nuancé. Le plus étonnant pour un lecteur, c'est de se trouver, au détour d'une page, plongé en plein western. Ambrose Bierce, rappelons-le, fut journaliste et bourlingua dans tout l'ouest à l'époque héroïque, ou du moins à l'extrême fin de celle-ci : des nouvelles comme « La fenêtre condamnée », « Une sacrée garce », « Le troisième orteil du pied droit », « L'inconnu » abondent en passages à la Mark Twain, à mi-chemin entre le tableau de mœurs et le croquis d'ambiance ; l'auteur y témoigne d'un souci du détail caractéristique de son époque, et d'une volonté d'humour moins générale, mais fort répandue néanmoins parmi les chroniqueurs américains aux environs de 1890. En vérité, Ambrose Bierce était beaucoup plus américain qu'on ne l'a dit, et maints commentateurs se sont servis de son cynisme bien connu pour lui construire un personnage de révolté qui n'était peut-être pas dans son propos. Sa sensibilité nocturne le situe dans la postérité directe d'Edgar Poe, et plus lointainement dans celle de Shakespeare, dont il multiplie les citations ; c'est tout juste si la Bible ne figure pas dans ses références. En fait, il doit beaucoup à la tradition puritaine, qui lui inspire, quoi qu'il en ait, une peur instinctive de l'adultère dans des nouvelles comme « Histoire de fou », « Une sacrée garce » ou « La route au clair de lune », et une répulsion irraisonnée devant les déterreurs de cadavres (« Par une nuit d'été », « Une sacrée garce »). Mais la Terre est une succursale de l'enfer où le mal règne en maître : on y trompe à qui mieux mieux, on y déterre à plaisir, et surtout, on y tue – volontairement ou non, peu importe (« Histoire de fou », « Veillée funèbre », « L'inconnu », « La route au clair de lune »). Le héros biercien est un homme qui, à ses propres yeux, s'est mis dans son tort, et qui reste, plus ou moins consciemment, sous le poids d'un sentiment de culpabilité accablante. L'auteur partage si bien ce sentiment que le pire crime est, selon lui, de ne pas l'éprouver. C'est le thème, au début du livre, du cycle des récits d'horreur : ni le nègre Jess, ni le chat de John Bortonson, ni l'ophiophagus ne se sentent coupables, et c'est avec une belle inconscience qu'ils se vautrent dans le sacrilège. On devine un ressort du même genre chez la femme de Murlock : l'aboulie du vieux westerner s'explique peut-être par la certitude, acquise dans de terribles circonstances, que les morts continuent à vivre ; mais peut-être aussi par la révélation qu'une pure jeune fille pouvait se muer, au gré des événements, en un monstre aussi féroce qu'une panthère : bref, que le vouloir-vivre sommeille encore derrière les aspirations éthérées de l'anglo-saxon moyen. Ici Bierce fait figure de précurseur pour bien des écrivains américains d'aujourd'hui, à commencer par Tennessee Williams et son « Soudain l'été dernier ». Mais la nature humaine, c'est bon pour les chats, les nègres et les morts. La plupart des personnages de Bierce sont éloignés de cette « indifférence pathologique » (p. 9) : leur conscience raisonneuse de civilisés recouvre bien imparfaitement le sentiment vertigineux d'être en faute et l'appréhension du châtiment. Ce châtiment, c'est la mort, à laquelle l'homme accède parfois par une fascination quasi-volontaire (« L'homme et le serpent »), le plus souvent à travers l'expérience de la peur. L'expérience humaine fondamentale, c'est de mourir de peur : telle est la conclusion du « Décor approprié », de « Veillée funèbre », d'« Une sacrée garce », du « Troisième orteil du pied droit ». Et si le sujet de cette expérience ne passe pas sur-le-champ de vie à trépas, il reste frappé à tout jamais d'une asthénie sans remède (« La fenêtre condamnée ») à moins qu'il ne devienne fou (« Histoire de fou ») ou ne finisse par se suicider (« La route au clair de lune »). On voit que la condition humaine selon Bierce n'est pas gaie : le coupable assure lui-même son propre châtiment, et survit quelque temps, « hanté par le sentiment que le châtiment de l'injustice a quelque chose de criminel, et le châtiment du crime quelque chose d'effroyable » (p. 146). Cette protestation nous mène bien loin du Bierce « cynique et misanthrope », et Jacques Papy assurément a raison d'y voir la traduction d'un sentiment de pitié de l'auteur pour ses semblables. Cependant il faut convenir que rien dans tout cela n'est spécifique de Bierce, à l'exception peut-être de la clarté rigoureuse de l'expression, reflet d'une conscience exceptionnellement lucide : car enfin le pessimisme est une valeur traditionnelle des lettres anglo-saxonnes, et domine en outre à peu près toute la littérature contemporaine. La mission même que Bierce assigne à la littérature dans cet univers tragique n'est pas absolument originale. « J'ai dans la poche un manuscrit qui vous tuerait, » dit Colson, l'écrivain (p. 48) : c'est, à peu de choses près, le propos de l'auteur. Toute la mission de l'art, c'est d'aider les hommes à mourir de peur, et de briser en eux les faux-semblants qui les éloignent de leur propre culpabilité : il y a là une conscience de virus, un prosélytisme de l'épidémie qui n'est pas propre au grand Ambrose, il s'en faut. Beaucoup plus originaux sont en revanche les moyens employés. Les hommes ont trop de bon sens, dès leur plus jeune âge, pour sombrer sans résister dans une peur panique : « L'enfant accueillit leur raillerie avec le plus grand sérieux, sans souffler mot. Il avait le sens de l'agencement normal des choses, et savait que celui qui déclare avoir vu un mort se lever de son siège, puis souffler une chandelle, n'est pas un témoin digne de foi » (p. 49). Tout le problème est donc de briser en l'homme le sens de l'agencement normal des choses, de lui suggérer, par un agencement insolite, que le monde n'a pas la signification qu'il croyait : « Quand la terreur et l'absurdité font alliance, l'effet est effroyable, » assure notre auteur (p. 102). Voilà le grand mot lâché : Ambrose Bierce est un des premiers militants de l'absurde, et table sur lui pour instaurer dans l'univers le règne du désordre. Mais les surréalistes n'ont pas encore passé par là, et Bierce, par une timidité qui fait toute la richesse de son œuvre, cherche l'absurde au sein même de l'univers logique : tantôt deux séries de faits parfaitement naturelles suggèrent, par leur rencontre, une explication surnaturelle évidemment fausse, mais qui n'en suscite pas moins la terreur ; tantôt les hommes eux-mêmes, par perversité ou bravade, créent artificiellement l'insolite, généralement au moyen d'un pari stupide (« Le décor approprié », « Veillée funèbre », « Le troisième orteil du pied droit »). Le résultat est invariablement le même : la logique prise en défaut ne sert plus à rien, et le héros de l'histoire se laisse envahir par la peur. Cette démarche est si essentielle pour Bierce que, même dans les derniers récits du volume, où il introduit un surnaturel effectif, ce n'est pas dans ce surnaturel qu'il trouve la justification de la peur. Les morts ne savent pas tout sur les humains (« La route au clair de lune ») ; quelquefois même, ils ne savent pas qu'ils sont morts (« Un habitant de Carcosa ») ; quand ils entrent en contact avec les vivants, c'est pour bavarder (« L'inconnu ») ou pour se faire reconnaître par des êtres chers (« La route au clair de lune »). Mais la peur des humains est toujours commandée, à travers les morts, par leur propre culpabilité ; c'est dans l'absence des cadavres, plus que dans la présence des fantômes, qu'ils mesurent leur propre solitude. Bierce est donc un apôtre de l'absurde beaucoup plus qu'un tenant du fantastique traditionnel. L'insolite joue un si grand rôle dans son œuvre que c'est lui qui en détermine toute la structure. Plusieurs des « Contes noirs » sont au niveau de ce qui a été fait de plus achevé en matière de nouvelles : perfection qui tient, naturellement, à la rigueur et à l'intelligence de l'auteur, mais aussi à l'utilisation exclusive, ou peu s'en faut, de cet unique ressort. Il s'agit pour Bierce de briser la construction traditionnelle du récit, ce qui lui permet de présenter isolément une scène qui, à sa place logique, eût été parfaitement explicable : ce n'est donc pas dans la chute que réside pour lui l'art de la nouvelle (encore que la chute de « La fenêtre condamnée » soit une des plus foudroyantes qu'il nous ait été donné de lire), mais dans l'ouverture, toujours consacrée à évoquer des événements étranges que l'auteur cherchera ensuite à expliquer, généralement par un ou plusieurs retours en arrière amorçant une ou deux fausses pistes pour préserver l'intérêt de la chute. Le schéma est réalisé sous cette forme assez simple dans « La fenêtre condamnée » ou dans « L'inconnu », mais le plus souvent Bierce le prend comme un point de départ, autour duquel il complique à l'extrême. C'est que la peur est pour Bierce une expérience mystique si fondamentale qu'il n'ose pas en parler : elle est tabou à ses yeux, en quelque sorte. On n'en trouve que peu de description dans les « Contes noirs », et il s'agit alors des premiers prodromes de la terreur, non de la peur essentielle qui entraîne la mort (« La fenêtre condamnée », « Veillée funèbre », « Une sacrée garce »). Dans les meilleurs récits (« Le décor approprié », « Le troisième orteil du pied droit »), l'ellipse est totale : on laisse le sujet dans une certaine situation, et on le trouve mort le lendemain. C'est dire que le schéma habituel, presque partout réalisé, comprend trois temps : 1° la scène étrange ; 2° le flash-back explicatif ; 3° la découverte du cadavre. À ce stade, un chef-d'œuvre comme « Le décor approprié » en ajoute encore un ou deux, où l'explication suggérée est remise en cause à son tour : ce qui représente à peu près le summum de la complexité en matière d'intrigue. Qu'il me soit permis de dire, à la fin d'une analyse que j'espère objective, qu'à titre personnel je pense que le schématisme de la construction est de loin l'élément le plus fécond de toute l'œuvre de Bierce : beaucoup plus que l'humour noir, qui introduit dans le récit une note de scepticisme opposée à l'effet de crédibilité recherché à travers la construction hachée ; beaucoup plus que le style dramatique, qui nous introduit dans la subjectivité des personnages alors que précisément le schématisme nous en éloigne ; beaucoup plus même que le message de Bierce, un peu trop pessimiste à mon sens pour être vraiment humain : avoir pitié des hommes, ce n'est pas comprendre les hommes. L'intérêt de ce schématisme, c'est qu'il permet de poser n'importe quel problème beaucoup plus efficacement que l'art littéraire traditionnel. C'est dans cette promotion d'une forme adaptée au fond que la science-fiction moderne, par exemple, a puisé toute sa valeur. Jacques GOIMARD |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |