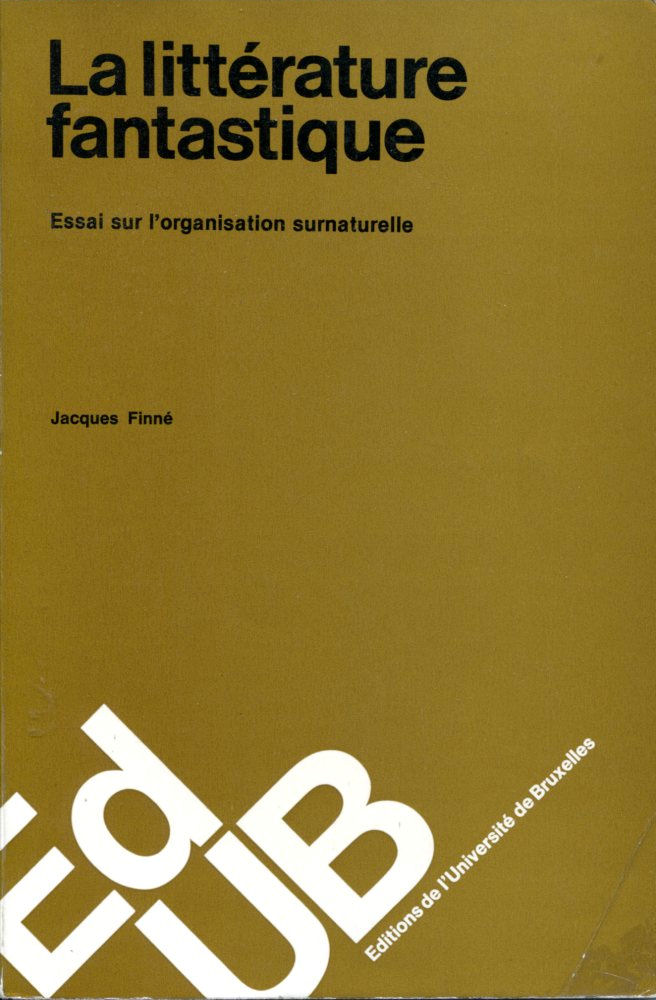|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
La Littérature fantastique : Essai sur l'organisation surnaturelle
Jacques FINNÉ UNIVERSITÉ DE BRUXELLES Dépôt légal : 1980 Première édition Essai, 216 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-8004-0727-1 ✅
Quatrième de couverture
L'auteur Jacques Finné. Né à Bruxelles, le 29 mars 1944. Etudes complètes dans cette ville : une candidature en philologie orientale islamique, une licence en philologie romane, un doctorat en philosophie et lettres. De sa thèse provient La littérature fantastique. Enseigne actuellement en Suisse. Nombreux travaux de traductions (entre autres une version intégrale du Dracula, de Bram Stoker) et de recherches. A publié une étude sur Jacques Cazotte, sur les traités de démonologie de la Renaissance, sur les grandes mystifications littéraires. Spécialisé depuis des années sur le thème de Don Juan et, surtout, en littérature fantastique. A réuni des anthologies géographiques (L’Amérique fantastique, de Poe à Lovecraft, L’Italie fantastique, de Boccaccio à Landolfi), thématiques (Histoires d’océans maléfiques, Les adorateurs de Cthulhu) et monographiques (Les meilleurs contes de fantômes de E.-F. Benson, Les grands récits surnaturels de C. Jacobi). Prépare un ouvrage sur les controverses démonologiques de la Renaissance et l’édition de l’œuvre entier, en français, de Joseph Sheridan Le Fanu. Le sujet L’ouvrage part d’une évidence : un récit fantastique produit, sur tout lecteur, un effet différent de celui engendré par un récit réaliste. Jusqu’à présent, les théoriciens avaient expliqué pareille différence par l’emploi d’une thématique particulière (fantôme, vampire, causalité généralisée, etc.) Voilà qui ne suffit pas : un conte fantastique possède un schéma, une organisation bien à lui. C’est cette organisation particulière qui permet de tracer une fois pour toutes des frontières entre des genres littéraires voisins — récit fantastique, récit policier, récit de science-fiction, récit de surnaturel expliqué rationnellement. C’est cette organisation particulière qui permet d’expliquer pourquoi le récit fantastique a évolué diachroniquement — un récit fantastique contemporain emploie davantage le mode du II que le mode du Je et ne présente plus ce déploiement réaliste propre aux récits fantastiques antérieurs. C’est cette organisation particulière, enfin, qui souligne combien le fantastique iui-même est un genre évanescent, dépendant, dans son existence même, des conceptions intellectuelles du lecteur. |
| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |