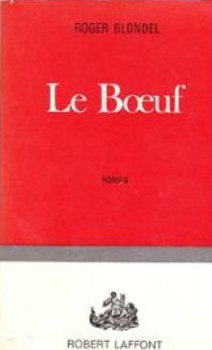|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Boeuf
Roger BLONDEL Robert LAFFONT (Paris, France) Dépôt légal : 1966 Première édition Roman ISBN : néant ❌
Critiques
L'Imaginaire se porte de mieux en mieux. À côté des genres reconnus et relativement définis, foisonnent maintenant des œuvres aux règles et aux contours moins nets que ceux du fantastique classique et de la science-fiction. La découverte est certes ancienne que les mots peuvent servir à autre chose qu'à transcrire la réalité. Mais les écrivains français ont longtemps fait mine de l'ignorer. Aujourd'hui, grâce aux effets conjugués et pourtant disparates de la science-fiction, du nouveau roman, du goût de l'insolite, elle fait une entrée massive. Il se peut bien que finisse par se constituer une école, ou tout au moins une tendance, de l'imaginaire, et qu'elle apparaisse d'ici un demi-siècle comme la plus caractéristique do noire époque. Avec Le Bœuf, Roger Blondel complète une sorte de cycle qu'il avait entamé avec L'archange et poursuivi avec son excellent Bradfer et l'éternel. Ce cycle recouvre toutes les formes de l'imaginaire : imaginaire objectif comme dans L'archange, proche de la science-fiction, où l'auteur dépeint l'avenir immédiat et donne son univers pour possible et pour réaliste. Imaginaire subjectif du point de vue de l'auteur dans Bradfer, où l'écrivain s'octroie toutes les libertés. Imaginaire subjectif du point de vue du héros, enfin, dans Le bœuf, tout entier ou presque consacré aux rêveries d'un terne professeur de province qui, sous sa carapace d'ennui, cache comme en dit, une vie intérieure. Il n'est pas indifférent de savoir qu'en réalité Le bœuf est antérieur à Bradfer. L'évolution réelle est plus intéressante, et plus significative que l'ordre des parutions. De L'archange à Bradfer en passant par Le Bœuf, un écrivain libère son imagination. Il lui faut de moins en moins de prétextes. Il abandonne successivement celui de la fiction romanesque et de l'anticipation, puis celui du monologue intérieur, dont il use dans Le Bœuf un peu comme les écrivains fantastiques du siècle dernier usaient du rêve comme d'une convention commode. Sa pensée, son propre rêve, son propre monologue sa trouvent sans plus d'aucun écran que l'effort d'écrire, au contact des mots. Étape intermédiaire, Le Bœuf n'en est pas moins une œuvre attachante. Le procédé, certes, n'est pas neuf. Un homme pense et nous voyons se dévider le fil ininterrompu de son monologue intérieur. Joyce en a usé et peut-être abusé. Mais l'invention d'une méthode ne réduit pas la nécessité d'explorer les espaces qu'elle découvre. Le Bœuf est une de ces plongées. Son scaphandrier est un professeur de sciences d'un lycée provincial, un « pauvre type dénué d'imagination », comme le définiront ses collègues après son décès. À dire vrai, il n'est pas dénué d'imagination, il en possède, ou Blondel lui en prête au moins autant qu'à nous tous, mais son imagination ne s'applique pas au monde réel. Elle le fait s'en évader. On l'appelle le ruminant parce qu'il remâche ses rêves et que rien n'en transparaît sur son visage. Un homme imaginatif dans notre monde invente un nouveau presse-purée ou taquine un peu la syntaxe. Son imagination devient alors visible. Mais Demzot le Bœuf n'en a cure. Ce n'est pas un imaginatif raté, c'est un imaginatif absent. Le coup de sonde de Blondel nous le restitue et par là évoque irrésistiblement les milliards de chefs-d‘œuvres fantômes et d'aventures mortes qui furent conçus dans des cerveaux humains et qui y demeurèrent. Quoique cela se voie moins, la nature est sans doute d'une prodigalité encore plus folle dans le domaine des rêves que dans celui de la vie. Le mécanisme du monologue de Denizot le Bœuf est celui d'une pensée fantastique en train de se faire. Il y a ici bien des pages qui traitent directement d'une vieille question : comment naît un thème fantastique dans l'esprit d'un homme ? L'un de ces thèmes, quoiqu'il n'intéresse ici qu'un chapitre, justifierait à lui seul la lecture du livre par un amateur de science-fiction. Denizot rêve à ce qu'il ferait s'il avait mille ans à vivre. Il est assis sous un arbre au-dessus d'une vallée. Cette vallée, pendant ces mille ans, il ne peut la quitter. Mais peu à peu, il en fait le centre du monde. « Je suis un des quatre ou cinq hommes les plus puissants de la planète. On a conquis les astres, au moins exploré le système solaire. Mes intérêts sur Mars, mes mines d'uranium dans Vénus, mes laboratoires d'expérimentation dans la Lune. » Denizot le conquérant immobile reste à la fin Denizot. Mais le temps d'un après-midi, de grands empires ont jailli comme des flammes et brûlé et craqué. Le Bœuf, à première vue, peut paraître incarner le désespoir le plus profond. Son héros est un raté qui vit un univers lamentable. Mais il rêve dans un univers riche. Il n'y a pas de rêveur qui soit totalement démuni.
Avec Le délire de Gilles Frimousse, Alain Spiraux ouvre une autre porte sur l'imaginaire. Gilles Frimousse a ceci de commun avec Le Bœuf qu'il est un personnage de peu de poids dans le monde quotidien. Mais l'inconnu tait irruption dans sa mansarde. Les héros de son enfance, féeriques, historiques, littéraires, anecdotiques ou surgis des bandes dessinées, la lancent dans une quête éperdue. Tout devient possible. Tout est possible. L'univers de Gilles Frimousse est un univers parallèle comme l'était celui de Bradfer ou celui de L'univers en folie de Fredric Brown. Le rythme de l'action est échevelé. Les siècles se carambolent. Jeanne d'Arc, David, la Bible et Saint Louis y mènent d'étranges combats au côté de leur ami Frimousse pour la conquête du mystérieux Avodea. Luc Bradfer et Robespierre se font la guerre. Des escadrilles sillonnent les airs et se livrent de furieux duels : ce sont des avions de papier pilotés par les enfants des écoles qui effacent les nuages à grands coups de gomme. Tout devient vraisemblable à l'intérieur d'une logique sournoise qui laisse n'importe quoi surgir des frontières du rêve mais qui le dote aussitôt d'une épaisseur, d'une réalité, d'une actualité qui trouvent leurs sources dans une action trépidante, un tourbillon jamais apaisé. Avec Gilles Frimousse, Spiraux a renouvelé le conte de fées pour adultes. Il a écrit à coup sûr la première bande dessinée sans dessins. Il rend en tout cas à la bande dessinée un vibrant hommage, allant jusqu'à décrire la vie de la surprenante « Maison de Retraite Hurrah », où l'on accueille tous les personnages du cinéma qui ne sont plus à la mode, tous les héros de bandes dessinées quand ils ont cessé de paraître, ceux des dessins animés, ceux des journaux d'enfants disparus. « Nous avons Guy l'Éclair, Dick Tracy, plusieurs membres de la dynastie des Tarzan, Zig et Puce, Félix le Chat, les Fenouillard, Cosinus et surtout un grand nombre de cow-boys. » La littérature a probablement pour fonction principale aujourd'hui de décrire ce que le cinéma, pour des raisons techniques ou pour d'autres raisons, ne peut montrer. Cela définit assez exactement sa liberté et indique assez clairement les régions où elle peut s'aventurer légitimement. Tout livre susceptible d'être transcrit en termes cinématographiques est un livre inutile, un scénario honteux. Selon ce critère, Le délire de Gilles Frimousse est un livre utile. C'est aussi un livre merveilleux. On peut lui reprocher un certain relâchement de l'écriture, bien des facilités, mais il reste une œuvre fantastique qui s'évade des sentiers habituels et qu'il faut lire pour être surpris, pour rire et pour rêver. Gérard KLEIN |
| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |