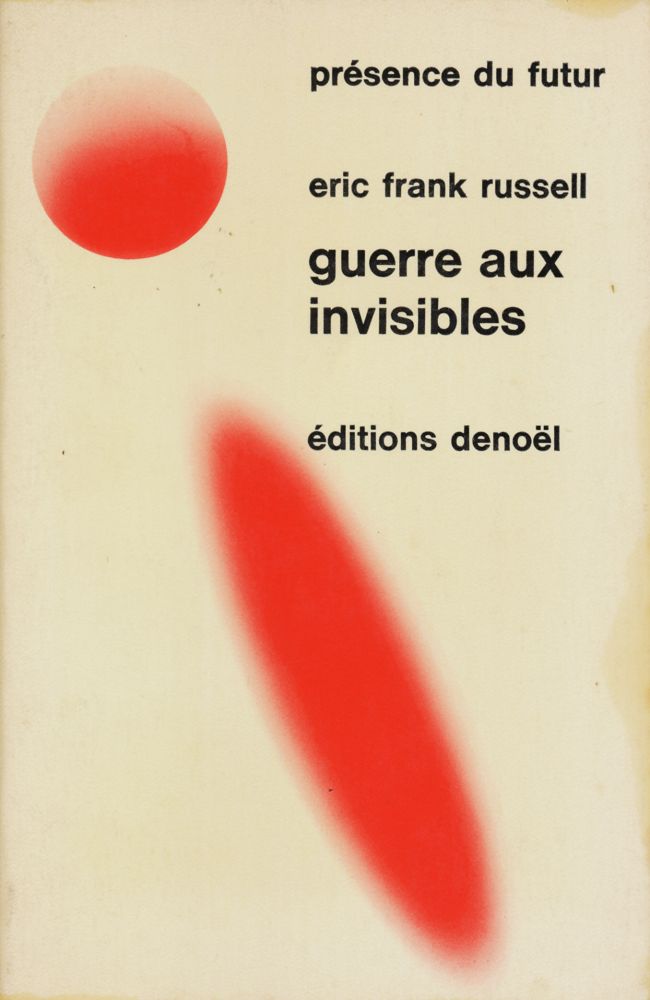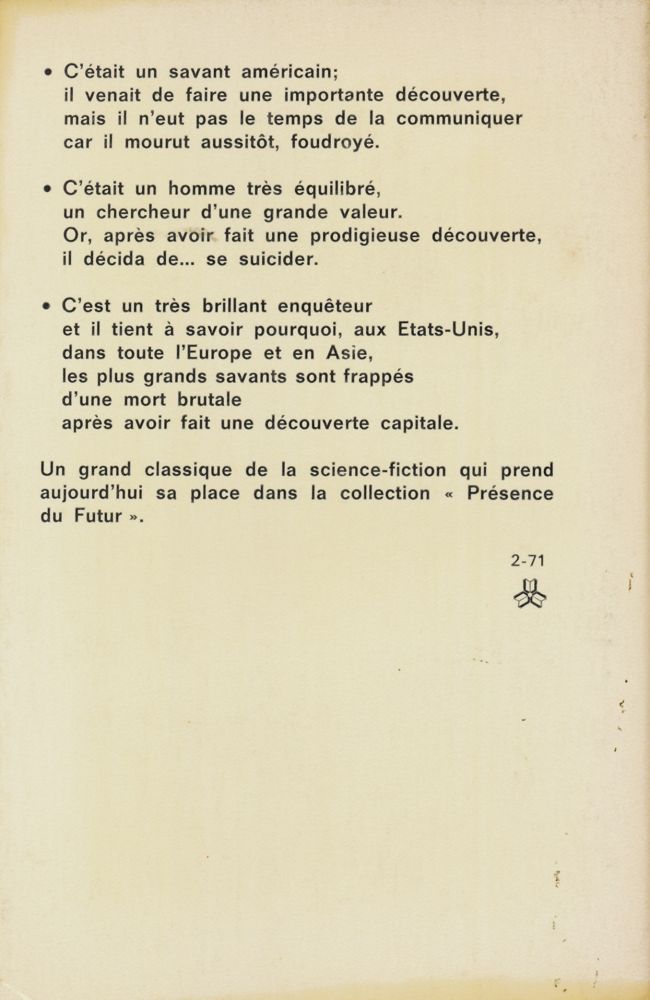|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Guerre aux invisibles
Eric Frank RUSSELL Titre original : Sinister Barrier, 1939 Première parution : Unknown, mars 1939. En volume : World's Work, 1943 ISFDB Traduction de Jean ROSENTHAL & Renée ROSENTHAL DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur n° 132  Dépôt légal : 1er trimestre 1971, Achevé d'imprimer : 15 janvier 1971 Réédition Roman, 224 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,7 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Autres éditions
in Prisonniers des étoiles, BRAGELONNE, 2010 DENOËL, 1971, 1985, 1999 HACHETTE / GALLIMARD, 1952
Quatrième de couverture
• C'était un savant américain ; il venait de faire une importante découverte, mais il n'eut pas le temps de la communiquer car il mourut aussitôt, foudroyé.
• C'était un homme très équilibré, un chercheur d'une grande valeur. Or, après avoir fait une prodigieuse découverte, il décida de... se suicider.
• C'est un très brillant enquêteur et il tient à savoir pourquoi, aux Etats-Unis, dans toute l'Europe et en Asie, les plus grands savants sont frappés d'une mort brutale après avoir fait une découverte capitale.
Un grand classique de la science-fiction qui prend aujourd'hui sa place dans la collection « Présence du Futur ».
Critiques
La récente réédition, dans la collection « Présence du Futur », du roman d’Eric Frank Russell, Sinister barrier, constitue à mon humble avis le premier événement littéraire de l'année 1971. Evénement parce que nous voilà en présence d'un véritable « classique », dont la seule édition française remonte à 1952. Evénement aussi parce que c'est, justement, ce livre-là qui m'a autrefois définitivement converti à la science-fiction.
C'est donc justice d’en dire quelques mots, d'autant qu'à I'époque de sa parution au défunt « Rayon Fantastique », notre revue préférée n'avait pas encore vu le jour ; d'abord parce que le livre était devenu introuvable, et surtout parce que les fidèles de Fiction doivent avoir lu Guerre aux invisibles, roman sublime qui n'a malheureusement pas connu la consécration du C.L.A.
On parle beaucoup des Non-A, de Fondation, de Demain les chiens ou du Silence de la Terre. II paraît que ces romans-là abordent de nouveaux rivages, plongent dans la mystique du cosmos, s'ouvrent sur de nouvelles philosophies. Ils en ont en tout cas la prétention. Guerre aux invisibles ne veut être qu'un bon roman d'aventures, une histoire pas ennuyeuse du tout. Il a I'énorme avantage d'y réussir. Mais il est, sans en avoir l’air, infiniment plus que cela.
Mais prenons les choses dans I'ordre. A vrai dire, lorsque je I'ai rouvert, je ne pressentais rien. J'avais au contraire une grande appréhension : le roman n'avait-t-il point vieilli ? N'allait-il pas se trouver amoindri par l’évolution foudroyante du genre ? Et je redoutais un peu aussi cet embellissement dont I'avaient paré mes souvenirs.
J'ai refermé Guerre aux invisibles tard dans la nuit. Sans I'avoir lâché un instant. Je sais depuis que je le relirai d'ici quelques années.
C'est un livre envoûtant. Terrifiant. Haletant. Vertigineux. Pourquoi ?
Parce que Russell est peut-être Ie plus grand conteur de la fameuse génération de I’âge d'or américain. J 'ai dit conteur et non pas écrivain. Je vais m’en expliquer. Le conteur tient tout à la fois du poète et du feuilletoniste. II sait vous trouver la belle image, le mot qui frappe et qui relance l’intérêt ; il use de clichés pour camper un héros mais nous le précise dans le cours de l’action ; il argumente à peine mais étonne beaucoup. Tel est l’Eric Frank Russell de ce livre. Tel semble-t-il être, devrais-je dire, car sous l’impression de facilité se cache un travail considérable qui, justement, évite au roman le vieillissement auquel on était en droit de s’attendre.
Ce livre est donc un récital de procédés, d’effets, de coups de théâtre. Cela tient beaucoup à son découpage. Mais regardons-y d’un peu plus près.
Il y a là trois parties distinctes et intimement liées qui agissent à plusieurs niveaux dans l’esprit du lecteur. Sur le plan thématique tout d’abord, on peut distinguer une introduction typique de roman policier : le héros, Bill Graham, enquête sur plusieurs morts suspectes. La seconde partie ressortit au fantastique le plus traditionnel : irruption de l’impensable dans le quotidien, avec dosage d’inquiétude. Toute la fin retrouve la science-fiction classique avec ses extra-terrestres, sa guerre totale et son climat d’apocalypse. On peut dès lors se représenter le cheminement de l’histoire. Réalisme, étrange, science-fiction. C’est un procédé coutumier de Clifford Simak, entre autres. Russell ne semble guère innover. Il paraîtrait plutôt « anthologiser », tant il y a de ressemblances avec ses devanciers. Citons La guerre des mondes et Le péril bleu pour ne pas cacher notre érudition.
Seulement, il ne peut être question de résumer ainsi le livre. Du reste, le lecteur, s’il découvre les thèmes, reçoit d’abord des impressions. Et c’est sur le plan émotionnel que le découpage est significatif.
La première partie du récit est essentiellement une « mise en condition ». L’auteur a choisi la démarche habituelle du roman policier pour amener le lecteur à se poser le problème. Il faut communiquer le désir de « savoir ». Je dois bien reconnaître qu’à cette seconde lecture, j’ai « marché » comme la première fois. J’ai voulu en connaître plus. Et, comme Graham, j’ai failli me brûler à le suivre. Pourquoi cette épidémie de suicides qui frappe le monde savant ? Pourquoi du peyotl, du bleu de méthylène et de la teinture d'iode ? C'est tellement farfelu que la recherche en est plus excitante. Et tout à coup...
II est trop tard pour reculer. Lancé à toute vitesse dans la voie de la découverte, Graham, et le lecteur avec lui, ne peut s'arrêter en si bon chemin. Survient le malaise auquel succède I'inquiétude tenace. Le climat du livre s'alourdit. L'attrait de I'inconnu qui s'auréole d'un soupçon de danger provoque lentement le vertige. Page après page, I'atmosphère s'épaissit pour devenir étouffante. A I'inquiétude succède I'anxiété, et vient alors la peur. Le chemin parcouru n’est pourtant rien devant celui qui s'ouvre.
Graham apprend toujours. Il va savoir. Il sait. Et cette connaissance le plonge dans Ie plus effroyable cauchemar qui se puisse concevoir. C'est de savoir qu'il doit mourir. C'est la connaissance qui a provoqué la mort des savants qui usent de bleu de méthylène. Et Ie lecteur, pour peu qu'il se donne la peine de forcer le jeu, lèvera bien vite la tête pour tenter d'apercevoir... Je préfère ne pas Ie dire. Sait-on jamais ?
Sait-on jamais en effet ! La phrase est lancée. Arrive le grand thème de la motivation de nos actes, de notre rôle en ce bas monde, de notre devenir. La question, tout simplement. Je crois que peu d'écrivains l’ont aussi implacablement traité. Jamais peut-être I'homme n’a été ramené aussi bas, pis qu'une marionnette ; : simple bétail, « esclaves courbés sous le joug, et d’une stupidité telle que nous commençons simplement à prendre conscience de nos chaînes. »
A partir de cette prise de conscience-là, le livre ne peut plus être jugé de la même manière. S'agit-il toujours d'un simple roman d'aventures ? Non ! C’est bien d'un ouvrage engagé qu'il s'agit. Russell est hanté par Ie problème de l'existence ou de la non-existence de Dieu, d’une vie extra-terrestre, de notre libre-arbitre. Il pose la question du pourquoi des guerres et des querelles, du pourquoi des croyances qui conduira, dans Ie roman, la race jaune à la Grande Lutte.
On pourrait croire qu'il a résolu ces questions puisque le récit se termine sur une note optimiste. Je n’en crois rien car il ne nous dit pas comment les choses iront après. II évite simplement d’aller plus loin dans sa recherche intérieure, non sans doute par découragement mais parce qua la solution est parfaitement indicible.
En tout cas, la « révélation » a un autre pouvoir que celui d'ouvrir les portes de la philosophie ou de la théologie. Paradoxalement, elle désamorce la peur et fait surgir la terreur. L'épouvante, faudrait-il dire, qui ne disparaît pas complètement lorsque Ie mot FIN apparaît. Justement à cause du fait qu'il s'agit d'un roman de science-fiction, que ce roman se situe dans le futur alors que nous, lecteurs, moi surtout, je suis dans Ie présent et que peut-être au-dessus de moi, tandis que j’écris ces lignes, un... Je ne Ie dirai pas. Je n'y penserai pas.
J'ai parlé au début de cet article de défauts communs aux feuilletonistes. II faut ajouter aussi une intrigue amoureuse bancale, des policiers trop policés, des politiciens naïfs. Mais tout cela importe peu, pas davantage en tout cas qu'une démonstration métaphysique dans Saga de Xam ou dans Barbarella. Ce roman est comme un beau poème auquel on ne pourrait reprocher de n'être pas technique.
Je crois aussi qu'il faut voir en Guerre aux invisibles une sorte de roman charnière de cette science-fiction qui, en 1939, quittait comme à regret les combats galactiques pour affronter la conscience de l'univers. Farmer n'était pas venu. II manquait encore au genre les Leiber, Sturgeon et autres van Vogt. Russell a sans doute, avec ce roman, préparé un peu mieux leur venue.
Mais Guerre aux invisibles, s'il est un « classique » de la science-fiction, me parait être surtout un chef-d'œuvre de I'épouvante. J'ai essayé de Ie faire comprendre. A ceux qui ne l’ont point lu de I'expérimenter.
J'ai trop peur d'en dire davantage.
Pierre MERLIN Critiques des autres éditions ou de la série
Au cours de l'enquête de routine qu'il mène sur le suicide du professeur Mayo, l'inspecteur Bill Graham découvre que plusieurs autres savants renommés, aussi bien étrangers qu'américains, se sont donné la mort ou sont décédés d'une crise cardiaque en l'espace de quelques jours. Peu à peu, alors que cette étrange épidémie continue de décimer la communauté scientifique, un certain nombre de constantes se dessinent : les personnes concernées s'étaient badigeonné un bras à la teinture d'iode, et poursuivaient, de près ou de loin, des recherches en rapport avec l'optique.
Et quel est ce sentiment d'être observé qui s'empare de Graham sitôt qu'il croit approcher la solution ?
Ce roman, le premier d'Eric Frank Russell, est paru en 1939 dans le numéro 1 du célèbre magazine Unknown (le pendant fantastique d'Astounding, dirigé lui aussi par John W. Campbell) avant d'être édité en volume après la guerre, dans une version remise à jour. Il s'agit d'une œuvre de SF, inscrite dans un avenir plausible (en tout cas pour l'époque). La solution de l'énigme est vite connue (les Vitons, des êtres d'énergie, élèvent l'humanité comme un troupeau et se repaissent de ses émotions), mais l'intérêt, pour moi, en est ailleurs — dans l'inquiétude, la paranoïa, qui sous-tendent l'intrigue et les réactions des personnages. Philip K. Dick était un fan d'Unknown : ce roman a sans doute figuré parmi ses lectures de jeunesse et l'a peut-être même influencé.
Passons sur les faiblesses occasionnelles du texte français qui aurait mérité un bon petit coup de peigne, et sur l'aspect caricatural des relations entre les sexes, bien qu'Eva Curtis, dont Bill Graham est amoureux, exerce un métier et soit présentée sous une lueur plus positive que les écervelées promptes à se pâmer dont la science-fiction de l'époque était encore friande. Passons aussi sur le dernier tiers du roman, moins palpitant, lorsque, la vérité enfin connue, la résistance s'organise sous les auspices de ces bons vieux USA. Je retiens par contre le mélange des genres, une des constantes d'Unknown, entre thriller, horreur et SF. Eric Ambler n'est pas loin, non plus que Lovecraft et Heinlein.
Un livre à (re)découvrir avec l'indulgence due à son âge. Pierre-Paul DURASTANTI (lui écrire) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Denoël : Catalogue analytique Denoël (liste) Francis Valéry : Passeport pour les étoiles (liste parue en 2000) |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |