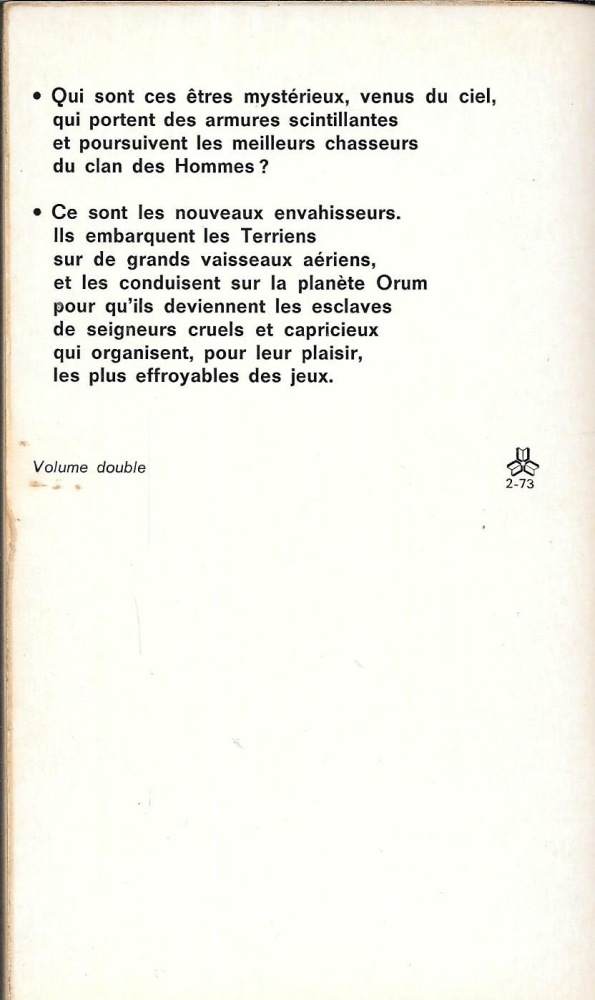|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Temps des grandes chasses
Jean-Pierre ANDREVON DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 162 n° 162  Dépôt légal : 1er trimestre 1973, Achevé d'imprimer : 20 janvier 1973 Première édition Roman, 360 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Volume double.
Autres éditions
in Très loin de la Terre, BRAGELONNE, 2009 DENOËL, 1980, 1987 in Très loin de la Terre, FRANCE LOISIRS, 2012
Quatrième de couverture
Qui sont ces être mystérieux,venus du ciel, qui portent des armures scintillantes et poursuivent les meilleurs chasseurs du clandes hommes ?
Ce sont les nouveaux envahisseurs. Ils embarquent les Terriens sur de grands vaisseaux aériens,et les conduisent sur la planète Orum pour qu'ils deviennent les esclaves de seigneurs cruels et capricieux qui organisent pour leur plaisir, les plus effroyables des jeux.
Critiques
Après deux volumes de nouvelles — Cela se produira bientôt et Aujourd'hui, demain et après — Jean-Pierre Andrevon rétablit l'équilibre en publiant son deuxième roman chez Denoël. Disons tout de suite que c'est supérieur encore aux Hommes-machines contre Gandahar, et non pas seulement par la longueur (il s'agit d'un volume triple de 360 pages) ! Ce n'est pas seulement un gros livre, c'est un grand livre ; mais peut-être pas tellement grand par sa part de science-fiction. Il n'y a pas, de ce point de vue, de ces idées inouïes qui ont fait d'emblée remarquer un van Vogt ; aussi bien n'est-ce pas tellement en ce domaine que se distingue la science-fiction française. Monde retourné à l'âge de pierre après catastrophe atomique, rencontre entre sauvages et super-civilisés, voyages interstellaires plus rapides que la lumière (le procédé s'appelle ici « supercité »), on a déjà vu ça bien souvent ; et Roll n'est pas sans rappeler Dâl, le héros des Armes d'Ortog de Kurt Steiner, non seulement par son passage de la vie primitive à la vie civilisée mais aussi par les épreuves auxquelles il est soumis dans l'arène. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'usage fait ici de certaines notions est assez maladroit : « Lorsqu'on voyage en supercité, le temps se contracte pour les voyageurs, et s'étend sur les planètes, à moins qu'on ne prenne certaines précautions qui valaient pour nos retours périodiques sur Orum. Mais quant à la Terre, elle a bien dû vieillir de quatre ou cinq ans depuis notre dernier passage », dit l'Orumien à Roll p. 349 ; mais quelles précautions peut-on prendre contre le paradoxe de Langevin ? Et pourquoi ne les a-t-on pas prises cette fois, sinon parce que l'intrigue exigeait que Roll et Ozim retrouvent au clan autre chose que les vieillards et les enfants qu'ils y avaient laissés ? Mais peut-on reprocher à Andrevon d'avoir profité au maximum des facilités du genre (qui l'apparentent au merveilleux) pour écrire une histoire plus exemplaire, composer une intrigue plus attachante, bâtir une œuvre plus harmonieuse ? Cette beauté, c'est dans l'écriture qu'elle est le plus évidente. D'un bout à l'autre, c'est un jaillissement d'images qui ne sont pas des clichés (« la surprise venait d'appuyer avec force son linge mouillé à la base de leur nuque », p. 64 ; « le destin capricieux retint-il son corps exténué entre deux doigts de cristal ? », p. 105 ; « les muscles de leur dos et de leurs jambes hurlaient silencieusement dans leur gaine de chair », p. 179, etc. ). Par ailleurs, Andrevon écrivain n'oublie pas Andrevon peintre (« Très loin, des cimes bleutées se dégageaient peu à peu de la transparence veloutée du ciel... Les collines devant eux avaient perdu leur tonalité jaune orangé pour acquérir le vert acide du matin, et la bordure de la forêt en face d'eux était illuminée d'une frange jaune cru au niveau des branches supérieures » : pp. 41-42), ni Andrevon musicien (« Des syllabes étirées, mouillées, qui résonnaient comme entre les parois d'une gorge profonde. Si le Destin avait eu une voix, il est probable en effet qu'il aurait eu ces sonorités : rauques et cinglantes à la fois, et exagérément volumineuses, une voix qui semblait faite de milliers de cailloux roulant à l'intérieur d'une conque gigantesque » : p. 44). Les procédés du « nouveau roman » eux-mêmes sont parfois mis en œuvre (chapitre 38 notamment). Mais il ne s'agit jamais de faire de l'art pour l'art, du style pour le style. Dans ce chapitre 38, si la vision du monde est ainsi brisée en myriades d'impressions fugaces et incohérentes, c'est tout provisoirement, parce que le héros a plongé pour un temps dans la mort et se débat pour émerger à nouveau à la claire conscience : les chapitres suivants sont justement parmi les plus abstraits et didactiques du livre, parce qu'ils montrent Roll en train de se former une vision d'ensemble du monde. Le seul chapitre où le bégaiement voulu du style correspond effectivement à une impuissance de la raison, c'est le court chapitre 48, décrivant les « Cylindres Noirs » sur lesquels dans le chapitre suivant Roll et Ozim émettent deux hypothèses contradictoires : mais n'est-il pas rationnel pour le rationaliste de faire sa part — au moins provisoirement — au mystère ? Et cette part de mystère ne contribue-t-elle pas à donner aux scènes que décrit le romancier la profondeur de la vie ? La vie ! C'est justement l'amour ardent de la vie que sert à traduire le style vivant d'Andrevon, l'amour de la vie sous toutes ses formes : la vie amoureuse, bien sûr (« il écoutait le vide de son crâne se meubler de la présence sonore de Réda, de Réda riant au soleil et de Réda mordant le fruit rouge d'un arbre sans nom, de Réda soufflant à ses côtés dans la course des bonnes chasses, de Réda chantant en sortant nue de la rivière, de Réda gémissant sous lui, ou sur lui, mais avec lui, dans les éclaboussures déchirantes de l'amour » : p. 163), mais aussi de la nature (« la chaleur qui frappait son visage était la bonne chaleur qu'il avait toujours connue, une chaleur cuisante d'été commençant, l'air qu'il respirait était pur et vivifiant, chargé d'odeurs végétales et de la senteur acre de la terre qui cuisait au soleil. Ses pieds foulaient un bon humus gras et friable, de la bonne herbe qui poussait dru » : p. 336). En face, Andrevon montre l'horreur de la mort, en un style non moins précis et prenant, et poétique quand même, dans la mesure où il y a une poésie de la laideur : la mort de Sedam (p. 253), celle d'Alta (p. 354), sont d'un réalisme presque insoutenable, celle de Réda subit une transposition poétique qui en atténue un peu la brutalité, mais est suivie d'une évocation de sa vie (p. 266) qui la rend plus poignante. On est encore là au niveau des sentiments largement partagés, et leur expression forte et poétique ne serait pas sans mérite, mais sans grande originalité. L'originalité du livre, elle est dans le fait de lier vie et nature d'une part, mort et civilisation de l'autre. C'est sur cette opposition que se fonde toute la structure du roman : il y a deux grandes parties, Le monde vert (vert, couleur de l'herbe, de l'espoir, de la vie) et Le monde gris (gris, couleur du béton, de la tristesse, de la mort), chacune suivie par une partie plus courte, Le long voyage et Retour au monde vert. On remarquera en passant que cette structure est la même que celle du premier roman d'Andrevon : le héros vit dans un monde proche de la nature, rencontre des ennemis venus d'un monde en proie à la technique, va de l'un à l'autre, puis revient au premier ; et l'on peut même dire que ces Chasseurs Brillants qui enlèvent Roll et des amis sont eux aussi des hommes-machines, car, bien que seul leur uniforme soit métallisé, leur vie, leur âme, sont en fait mécanisées. Ce sont des soldats, c'est-à-dire des hommes robotisés, qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui n'y croient pas (p. 109) ; il y a tout au long de ces pages une satire impitoyable du militarisme (y compris les aboiements des sous-officiers et le « jus » de chaque matin !). Mais ces zombies ne sont qu'une image à peine exagérée de l'ensemble de leurs concitoyens, et leur rencontre n'est pour Roll qu'un avant-goût de ce qui l'attend sur Orum, planète laide, grise, froide, triste, à cause de sa civilisation urbaine et industrielle, qui y rend l'air nauséabond et opaque, la vie routinière et ennuyeuse, les rapports sociaux injustes et forcés, les gens désœuvrés et pervertis. La décadence s'y manifeste en tous les domaines : langage compliqué et obscur (p. 111), science purement réitérative (p. 314), vices, cruauté. C'est Ern Ozim, qui y occupe pourtant une place de choix, qui diagnostique page 315 le mal dont souffre cette société : faute de progresser, elle régresse ; faute d'avoir un but, elle meurt. Elle meurt, mais aussi elle tue : les Chasseurs Brillants tuent des animaux sans raison, au grand scandale de Roll (p. 114), et sur Orum les bêtes ont disparu (pp. 224 et 304 ) ; les Orumiens font des razzias sur le « monde vert », tuent ceux qui leur résistent, et emmènent les autres mourir à petit feu dans les mines et les usines — pour qu'ils n'aient eux-mêmes aucun travail — ou spectaculairement dans l'arène — pour meubler leurs loisirs et combler leur goût morbide pour le sang (p. 246). Ces jeux, empruntés aux Romains (Andrevon, dans leur description qui occupe une bonne partie du livre, transpose ce que montrait l'un de ses cinéastes favoris, Kubrick, dans Spartacus, et l'on sent, paradoxalement, que ce pacifiste est fasciné par les armes), sont en somme le culte rendu à la déesse d'Orum : la Mort. Il est significatif que les gladiateurs joignent, dans leur salut, à la vieille formule romaine « Ceux qui vont mourir te saluent » l'horrible cri de guerre des fascistes espagnols : « Vive la mort ! ». On touche là à l'aspect satirique de l'œuvre. Mais attention : il serait trop facile de dire « Orum, c'est Rome », ou « Orum, c'est l'Espagne franquiste ». Orum — Jean-Pierre Andrevon le dit page 111 — c'est la déformation d' « Europe » ; c'est une planète colonisée par l'Europe menacée de mort par « la surpopulation, la pollution, la famine et les guerres localisées ou intérieures » (p. 308), et qui n'a pas hérité seulement de son nom, mais prolonge en les exagérant tous les défauts de notre belle civilisation occidentale : « Nous ne favorisons pas la recherche, les études. Nous favorisons la paresse, la vacuité intellectuelle et physique, qui engendrent le vice, la mollesse, la bêtise. Le peuple d'Orum vit par procuration devant sa télévision ou sur les gradins des arènes... Cela a une raison, bien sûr ! Un peuple gavé de jeux ne cherche pas à comprendre, et ne comprenant rien, il ne cherche pas à se révolter ! » On retrouve là l'écrivain engagé du Temps du grand sommeil (Fiction 213 — notons le parallélisme des titres), qui n'a nul scrupule à formuler ses opinions dans le cours du récit (voir notamment p. 301). Seulement, ce n'est plus tellement sur le trotskysme que semble déboucher cette critique de notre civilisation. D'abord, pas de lutte des classes : les basses classes, parfaitement décervelées (l'oisiveté apparaît comme plus aliénante encore que le travail en usine) ne sortent de leur apathie que pour se livrer au brigandage, à la mendicité et à la prostitution ; et les esclaves ne se révèlent pas non plus « briseurs de chaînes » (à la différence du Spartacus déjà cité), faute de triompher de l'individualisme qui leur souffle que « ce sont toujours les autres qui meurent » (p. 205), et qu'en faisant de leur mieux ce que leur demandent les maîtres ils pourront se faire une place acceptable. Le châtiment des crimes d'Orum vient de l'extérieur, et ce n'est pas une correction (c'est-à-dire une douloureuse épreuve qui oblige à s'améliorer) mais la peine capitale. Ces « Cylindres Noirs » qui anéantissent Orum, sont-ce « les Gardiens de la Galaxie »... supprimant « une tumeur maligne » (p. 340) ou bien (plus probablement à cause du titre) des Chasseurs (« le chasseur est toujours la proie d'un autre chasseur », p. 341) prenant pour proie les Orumiens, tout comme ces derniers étaient les Chasseurs Brillants de Roll et ses compagnons, eux-mêmes chasseurs de brènes, de cornouillers et de rugueux ? Dans le premier cas, Andrevon reprend le mythe des Grands Galactiques, qui n'est autre que la transposition moderne de nombre de religions où les dieux, supérieurs aux hommes, sont les serviteurs du Destin (souvent évoqué dans cet ouvrage) ; dans le second cas, il y a une structure en escalier, qui n'a aucune raison de ne pas continuer plus haut que les Cylindres Noirs (ces derniers à leur tour peuvent devenir la proie d'êtres encore plus forts, qui à leur tour...) : c'est « les deux infinis », mais sans Dieu pour redonner à l'Homme pris entre les deux un sens et un espoir ; c'est la loi de la jungle à l'échelle cosmique. Paradoxalement, c'est pourtant cette loi qu'à l'échelle humaine le livre semble proposer comme morale, de préférence aux lois de la civilisation ; on songe irrésistiblement au mythe rousseauiste du « sauvage bon et heureux ». Certes, les habitants du « monde vert » ne sont pas parfaits, tant s'en faut : Orni se laisse griser par ses succès et son renom comme machine à tuer (pp. 218, 236), et Roll lui-même n'est pas sans reproche (« il était moins humain que ce non-humain », p. 258) ; inversement, le Maître d'Armes Sturbkern n'est pas une simple brute sans âme (p. 222), et Ern Ozim surtout, grand ennemi de Roll, se révèle peu à peu lucide, courageux, humain, complexe. Il n'y a donc pas de manichéisme, mais l'impression s'impose pourtant que les primitifs sont supérieurs aux civilisés, non seulement du point de vue pratique (« Mettez un sauvage dans la civilisation, il s'en tirera ; placez un civilisé dans un cadre primitif, il crèvera »), mais en valeur absolue (car leur vie, en contact direct avec la nature, est libre, belle, joyeuse, et a un sens). Andrevon rejoint Vendredi ou les limbes du Pacifique (Gallimard, 1967) de Michel Tournier, où l'indigène s'avère peu à peu le maître (aux deux sens du mot) de Robinson. Reste à savoir si Andrevon, collaborateur de La Gueule Ouverte, renonce au marxisme si hautement professé naguère. Dans ce livre, si l'exploitation de l'homme par l'homme et l'aliénation qui en résulte sont toujours dénoncées avec autant de vigueur, l'exploitation de la nature, qui devait selon Marx y être substituée et donner un sens à la vie de l'homme et à l'histoire, semble remplacée ici par la soumission à la nature : la joie serait de connaître ses lois et d'en apprécier la beauté. La théorie marxiste du progrès continu semble abandonnée au profit de la théorie cyclique spenglérienne (naissance, vie, déclin et mort des civilisations). Cependant, si cette dernière rend compte des faits du récit, elle ne coïncide pas avec la morale qui s'en dégage. L'épigraphe ironique (« L'histoire ne se répète pas, elle bégaie ». Ni Spengler ni Marx) indique-t-elle qu'Andrevon renonce à donner un sens à l'histoire ? Lui seul peut répondre à cette question. Espérons qu'il le fera, plutôt que dans l'abstrait, sous forme d'un troisième roman, supérieur encore aux deux premiers. Denis PHILIPPE |
| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |