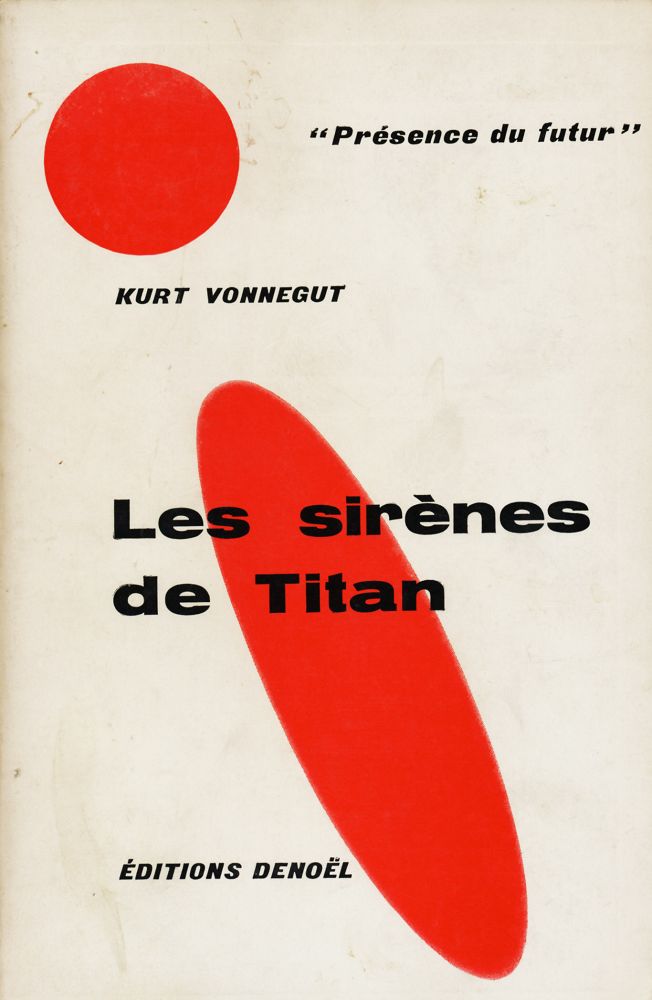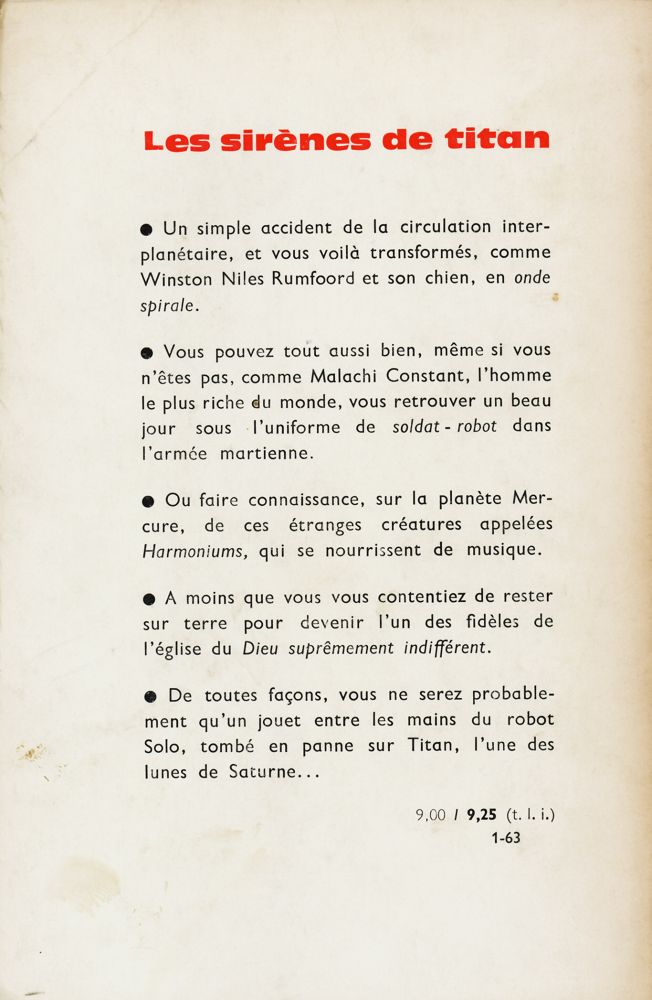|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Les Sirènes de Titan
Kurt VONNEGUT Jr Titre original : The sirens of Titan, 1959 Première parution : New York, USA : Dell, octobre 1959 ISFDB Traduction de Monique THIES DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 60-61 n° 60-61 Dépôt légal : 1er trimestre 1963, Achevé d'imprimer : 29 décembre 1962 Première édition Roman, 352 pages, catégorie / prix : 9,25 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
• Un simple accident de la circulation interplanétaire, et vous voilà transformés, comme Winston Niles Rumfoord et son chien, en onde spirale.
• Vous pouvez tout aussi bien, même si vous n'êtes pas, comme Malachi Constant, l'homme le plus riche du monde, vous retrouver un beau jour sous l'uniforme de soldat-robot dans l'armée martienne.
• Ou faire connaissance, sur la planète Mercure, de ces étranges créatures appelées Harmoniums, qui se nourrissent de musique.
• A moins que vous vous contentiez de rester sur terre pour devenir l'un des fidèles de l'église du Dieu suprêmement indifférent.
• De toutes façons, vous ne serez probablement qu'un jouet entre les mains du robot Solo, tombé en panne sur Titan, l'une des lunes de Saturne...
Critiques
L'union de la satire et de la science-fiction a déjà fait l'objet d'exégèses nombreuses. Selon les théories myopes de Kingsley Amis, elle constituerait même la principale justification de la littérature d'anticipation. À plus d'une reprise, cette union – ou tout au moins cette juxtaposition de termes – fut utilisée pour assener au public des fadaises telles que « La république lunatique » de Compton Mackenzie, que les plus fortunés parmi les lecteurs des présentes lignes ont sans doute réussi à oublier : il s'agissait là de thèmes plus ou moins sociaux, très sommairement déguisés en science-fiction, et généralement servis par des auteurs qui tentaient de justifier leurs pas maladroits sur un terrain inconnu. À quelques reprises, cependant, il y eut, dans le domaine de la science-fiction sociale, des réussites, comme « The space merchants » de Frederick Pohl et Cyril Kornbluth, et surtout « Player piano » de Kurth Vonnegut jr. Ce dernier auteur faisait, avec cet ouvrage, son premier essai dans le roman de science-fiction ; cette attaque mordante contre la mécanisation croissante du monde moderne constituait un réquisitoire dont l'éloquence soutenait la comparaison avec « Le meilleur des mondes » de Huxley. Ces « Sirènes de Titan » furent publiées en 1959, sept ans après « Player piano », et elles représentent le second roman de science-fiction écrit par leur auteur. L'ouvrage est aussi différent du précédent qu'il serait possible de l'imaginer, délirant, grandiloquent et hilarant alors que l'autre était méthodique, véridique et sarcastique. Il possède cependant en commun avec « Player piano » – bien qu'exprimé de façon tout autre – un fond de pessimisme qui assombrit l'ensemble, et qui donne une résonance grave aux inventions les plus folles dont la fantaisie de l'auteur a bourré ces pages. Satire donc, et satire en premier lieu de quelques-uns des thèmes « standard » de la science-fiction ; mais, derrière ceux-ci, c'est leur origine bien réelle que Kurt Vonnegut ridiculise. Lorsqu'il raconte l'invasion de la Terre par les troupes entraînées sur Mars, l'auteur stigmatise le militarisme et l'obéissance aveugle ; lorsqu'il présente un personnage qui connaît l'avenir, c'est pour montrer la futilité d'un tel pouvoir qui, en fin de compte, fait de celui qui le possède un jouet de puissances supérieures ; lorsqu'il présente l'absurde culte de Dieu le Suprême Indifférent, c'est pour attaquer les innombrables sectes qui fleurissent aux États-Unis et qui doivent leur existence à la préoccupation de tel ou tel élément mineurs du Christianisme. Quel que soit le thème « classique » auquel il s'attaque, Kurt Vonnegut le réduit par l'absurde en en magnifiant les côtés ridicules – tel est par exemple le cas des Mercuriens, qui ne vivent que de vibrations, qu'on nomme communément harmoniums, et dont plusieurs moururent de volupté en écoutant « Le sacre du printemps »… Il y a aussi, simple, franche et brutale, l'attaque contre la bureaucratie, dans ces conseils adressés à un homme d'affaires qui a intérêt à dépister les limiers du fisc : «…imaginez un peu comme vous seriez difficile à surveiller si vous possédiez un immeuble plein jusqu'aux combles de bureaucrates industrieux ; ces gens qui égarent des pièces, utilisent les mauvaises formules, en créent de nouvelles, demandent tout en cinq exemplaires et comprennent peut-être un tiers de ce qui leur est dit… qui décident d'une conférence chaque fois qu'ils s'ennuient, écrivent des rapports quand ils se sentent mal aimés, qui ne jettent jamais rien à moins que cela ne risque de les faire mettre à la porte…» L'évocation possède la cruauté de la vraisemblance, et tous ceux qui ont eu affaire à quelque administration en reconnaîtront sans peine l'authenticité. Il y a encore, pour la simple beauté de la chose – et évidemment aussi parce que cela contribue au progrès du récit – des gags à l'énormité aussi gratuite que réjouissante, comme celle de ce personnage qui fait fortune en utilisant la Bible pour guide dans ses spéculations boursières, ou comme l'interprétation sémantique d'un certain nombre de grands édifices terrestres : les alignements de Stonehenge, la grande muraille de Chine, la maison dorée de Néron, le Kremlin et le palais de la S.D.N. à Genève sont ainsi destinés à transmettre des messages à un extraterrestre tombé en panne près de Saturne. Dans ces trouvailles, l'imagination de Kurt Vonnegut atteint une truculence sublime : de tous les artifices pouvant servir à faire progresser son histoire, il choisit sans défaillance ceux dont l'hénaurmité est la plus superbe, ce qui confère à son récit une indéniable grandeur dans l'absurde. Car l'absurdité est au cœur de ces « Sirènes », dans leur action aussi bien que dans leur atmosphère. De quoi s'agit-il, dans l'histoire ? Le meneur de jeu, sournois et malfaisant, est un individu nommé Winston Niles Rumfoord, dont l'astronef s'avança un jour par erreur au cœur d'un infundibulum chrono-synclastique. Cet admirable néologisme désigne une zone privilégiée de l'espace-temps, dont Rumfoord subit les effets. Comme de juste, ceux-ci sont de deux espèces, temporels et spatiaux. En vertu des premiers, Rumfoord peut voir l'avenir et le passé aussi clairement que le présent, ce qui lui permet de manipuler les humains comme de simples pions. En vertu des seconds, il se trouve « répandu » dans l'univers, demeurant en permanence sur Titan, mais apparaissant en outre périodiquement sur Terre et sur Mars, lorsque son infundibulum est coupé par la trajectoire de ces astres. Là encore, on voit une explication pseudo-scientifique poussée jusqu'à ses conséquences les plus absurdes. Le protagoniste du récit est, au commencement de celui-ci, l'homme le plus riche du monde. Il est bientôt ruiné, et il se trouve alors entraîné dans une odyssée qui forme la substance du roman. Il ira sur Mars, sur Mercure et sur Titan. Ses aventures seront risibles et pathétiques, et il sera un « héros » bien pitoyable : une marionnette dont l'inflexible Rumfoord tirera jusqu'au bout les ficelles, et qui tentera parfois en vain de se dégager de cet esclavage. Il ne bénéficiera jamais de la moindre pitié de la part de Kurt Vonnegut, la plume de ce dernier conservant invariablement quelque acidité lorsqu'elle le place en scène. Là aussi, un des thèmes classiques de la science-fiction est tourné en dérision : ce « héros », qui se nomme Malachi Constant, utilisera pour tenter de se révolter des procédés grâce auxquels ses confrères, dans d'autres romans, ont pu se libérer de la fatalité ; il demeurera, quant à lui, irrévocablement entraîné sur la pente de ce futur que Rumfoord lui a préparé. Pourquoi, au fait ? La révélation finale est assurément la plus colossale du récit, car elle explique tout simplement la raison d'être de toute l'histoire de l'humanité. La donner ici équivaudrait à détruire le superbe édifice bâti par l'auteur, mais il est permis de dire que son caractère est à l'image de l'ensemble : absurde, et hilarant par sa futilité. Et dans cette révélation éclate le pessimisme de Kurt Vonnegut. La progression grâce à laquelle l'horizon s'élargit tout au long de l'histoire n'est pas le moindre mérite de celle-ci, et c'est un tour de force que d'avoir concilié cet élargissement avec une accentuation de l'absurdité sur laquelle tout se fonde. Tout, littéralement, puisqu'il s'agit de l'ensemble de notre Histoire. Le style de l'original était à l'image du récit : Kurt Vonnegut passait d'une verve cinglante évoquant Alfred Bester à une fausse douceur attendrie, qui pastichait une des « manières » de Theodore Sturgeon. La traduction, signée Monique Thies, a cependant égalisé tout cela : il en résulte un style laborieux, dont les étincelles originales ont été sévèrement éliminées. Un exemple suffira à donner une idée de ses faiblesses. Le chapitre IV met en scène les troupes (composées de Terriens enlevés de leur planète d'origine à l'aide de soucoupes volantes) qui, sur Mars, s'entraînent à la guerre. Leur chant de marche a, pour refrain, les mots rented a tent. Même sans savoir l'anglais, on remarque dans ces vocables la combinaison de dentales et de nasales qui servent à imiter le roulement du tambour, et dont le ran-pa-ta-plan des enfants est une illustration. Malheureusement, Monique Thies sait l'anglais : au lieu de procéder par analogie sonore, et de rendre ce refrain par Reine te dédaigne, Reine t'a tanné, ou n'importe quelle autre phrase arbitraire de sens mais évoquant tant soit peu le roulement du tambour, elle a tout bonnement traduit littéralement. Et les pauvres soldats, dans sa version, marchent sur les paroles suivantes, assez peu entraînantes en vérité : Louer une tente, une tente, une tente Louer une tente, une tente, une tente Louer une tente ! Louer une tente ! Louer une, louer une tente. L'action et les trouvailles de l'auteur sont évidemment conservées dans la version française, mais la désinvolture du ton, qui dissimulait l'ironie pessimiste de l'imagination, sont sacrifiées au passage. C'est dommage, car ces « Sirènes de Titan » étaient, à bien des égards, une façon de chef-d'œuvre dans le texte original. Demètre IOAKIMIDIS Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Denoël : Catalogue analytique Denoël (liste) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |