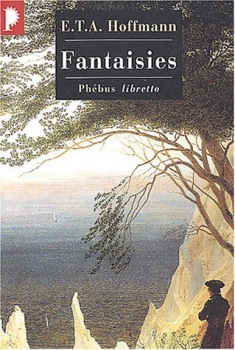|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Fantaisies
Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN Titre original : Fantasiestücke in Callot's Manier, 1814 Première parution : Bamberg, Allemagne : de 1814 à 1815 ISFDB PHÉBUS , coll. Libretto  n° 155 n° 155  Dépôt légal : janvier 2004 Recueil de nouvelles, 466 pages, catégorie / prix : 11,5 € ISBN : 2-85940-958-0 ❌ Genre : Fantastique
Autres éditions
Sous le titre Contes : Fantaisies à la manière de Callot GALLIMARD, 1979 LIVRE DE POCHE, 1969 Sous le titre Fantaisies dans la manière de Callot PHÉBUS, 1979 POCKET, 1990
Quatrième de couverture
C'est le premier en date (1815) et le plus sidérant peut-être des recueils de Contes d'Hoffmann. Celui hélas qui a été le plus constamment trahi par ses « traducteurs », qui en ont systématiquement écarté les admirables Kreisleriana — où puisèrent pourtant Baudelaire et Schumann. La présente édition offre pour la première fois aux lecteurs d'aujourd'hui la version intégrale de ce chef-d'œuvre qui déborde de très loin, de très haut, le cadre ordinaire de ce qu'on appelle le fantastique : tel exactement que le rêva Hoffmann ; et tel que le présenta au public de l'époque son génial préfacier : Jean-Paul Richter. Soit, en quelque 400 pages, une suite ininterrompue de merveilles : « Le chevalier Gluck », « Don Juan », « Le magnétiseur », « Le vase d'or » — le plus beau portique qui soit pour accéder à l'œuvre d'Hoffmann. « Hoffmann, de tous les écrivains du passé, celui peut-être qui nous est le plus contemporain. » GEORGES-ARTHUR GOLDSCHMIDT Avec les Fantaisies (et Le Chat Murr) s'inaugure la reprise en collection « Libretto » de l'Intégrale (en 14 vol.) des « Contes et récits » d'Hoffmann — réalisée sous la direction d'Albert Béguin et Madeleine Laval. Une entreprise largement saluée par la presse.
Critiques
[Chronique portant à la fois sur Fantaisies et sur Le Chat Murr]
Hoffmann est un auteur que l'on ne présente plus. Ses œuvres ont inspiré tant les poètes que les romanciers et les musiciens. Cependant, comme trop d'auteurs que l'on croit connaître, et dont la renommée n'est plus à faire, son œuvre n'a vu que tardivement une parution française relativement complète, accessible à tous, dans une traduction soignée. Les éditions Phébus ont aujourd'hui entrepris de mettre un terme à cet état de fait, puisqu'elles nous proposent une réédition complète de ses « Contes et Récits » en quatorze volumes, dans la collection « Libretto », en choisissant les traductions les plus fidèles, à la fois à la lettre et à l'esprit de l'auteur. Disons-le dès maintenant : l'édition est attractive, avec un format « poche » amélioré, une belle impression et une très agréable absence de coquilles (denrée rare...). Par ailleurs, on y trouve de passionnantes introductions, préfaces et notes, nécessaires à une intelligence claire des textes. Bref, un outil tant de découverte que de travail. Les deux premiers volumes qui initient cette collection sont aux deux extrêmes de l'œuvre hoffmannienne : les Fantaisies, publiés en 1812-1813, et son roman semi-testamentaire, Le Chat Murr. Deux œuvres d'un genre profondément différent, qui font à elles seules la preuve de l'éventail des styles d'Hoffmann, définitivement irréductible à un « type » d'écriture. Les Fantaisies, autrement intitulées Fantaisies à la manière de Callot, sont un recueil de nouvelles fantastiques, parmi lesquelles se trouvent sans conteste les textes les plus célèbres du conteur allemand. La nouvelle d'ouverture, « Le Chevalier Gluck », fait partie des textes qui ont fait d'Hoffmann un des grands maîtres du fantastique. Dans la même veine, on retrouve le « Don Juan », et surtout les fameuses « Aventures de la Saint-Sylvestre », où ressurgit le personnage de Peter Schlemil, héros du roman éponyme de l'Allemand Adelbert Von Chamisso, toujours à la recherche de son ombre. A la faveur de cette nuit particulière, il partage une table de taverne avec Spicker qui, lui, a donné son reflet à la diabolique Giuletta, et que le flamboyant Docteur Dapertutto poursuit encore. A côté de ces textes proprement fantastiques, on redécouvre des contes nettement plus « merveilleux », comme « Le Vase d'Or », dans lequel Hoffmann laisse libre cours à son imagination. Les visions oniriques qu'il met en scène sont tour à tour fascinantes, inquiétantes, drôles, sombres, colorées, envoûtantes... mais toujours emplies d'une « vie » surprenante. La puissance évocatrice de l'auteur est tout simplement confondante. De nombreux passages feraient certainement envie aux tenants de l'écriture du rêve, tant ils semblent proches du fonctionnement effectif de notre inconscient, sans pourtant que la construction du récit soit jamais prise en défaut. L'édition accorde également la place qui leur revient de droit aux « Kreisleriana », trop longtemps laissées de côté. Johannes Keisler, maître de chapelle et « double » avoué d'Hoffmann, est un homme en révolte contre ceux qui galvaudent la culture, se permettent des jugements d'ignorants, ou se targuent de dons artistiques ; personnages qu'on trouve alors tout particulièrement dans les salons mondains. Homme fantasque, parfois à la limite de la folie, ironique, mordant, Kreisler écorche sans remords toute une partie de la société qui se veut cultivée, et incarne à ses yeux le philistinisme. Loin du fantastique, ses écrits — sous forme de fragments compilés, écrits au hasard des partitions — sont aussi l'occasion de longs commentaires sur la musique, l'art et les mœurs de son temps. Les tableaux et les personnages qu'il y brosse font les frais de son humour ravageur, pour notre plus grand plaisir, même si, derrière cet humour, on sent une indignation à peine contenue, et parfois, au détour d'une phrase, la douleur d'un amour irréalisable. Ce regard dévastateur sur la société n'est pas l'apanage exclusif de Kreisler. Hoffmann le place également dans la gueule du chien Berganza, qu'il emprunte pour l'occasion à Cervantès. Ce canidé, doué de la parole, entretient en effet une conversation prolongée avec le narrateur, au cours de laquelle il lui raconte ses expériences dans le monde des hommes « cultivés », et donne son point de vue plus particulièrement sur le théâtre de l'époque. Dans une veine très voltairienne, Hoffmann donne également la parole à un singe, admis, écouté et respecté dans les meilleurs salons, qui raconte comment il est passé du statut de primate à celui de « singe savant » en peu de temps et d'efforts. La lettre, adressée à son amie Pipi, tient en quelques pages, dont l'humour ravageur n'a pas pris une ride... Un grand moment d'anthologie de l'ironie. Donner la parole aux animaux, Hoffmann le refera plus longuement dans son dernier ouvrage, le second qui nous intéresse : Le Chat Murr. [...] 1 Deux ouvrages donc, qui viennent ouvrir une longue série. Chacun à une extrémité du parcours créatif de leur auteur. L'un, fantastique, drôle, ironique, mordant, certainement le modèle même de ce que l'on conçoit comme l'Œuvre hoffmanienne... et le second, plus intime, plus éloigné de l'inspiration surnaturelle, et étrangement moderne. Deux volumes, donc, qui s'imposent tout simplement dans votre bibliothèque, en attendant de leur adjoindre les douze suivants. Notes : 1. La partie de la chronique portant sur Le Chat Murr n'est pas reproduite ici. On la trouvera sur la fiche dudit ouvrage. [Note de nooSFere] Sylvie BURIGANA |
| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112112 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |