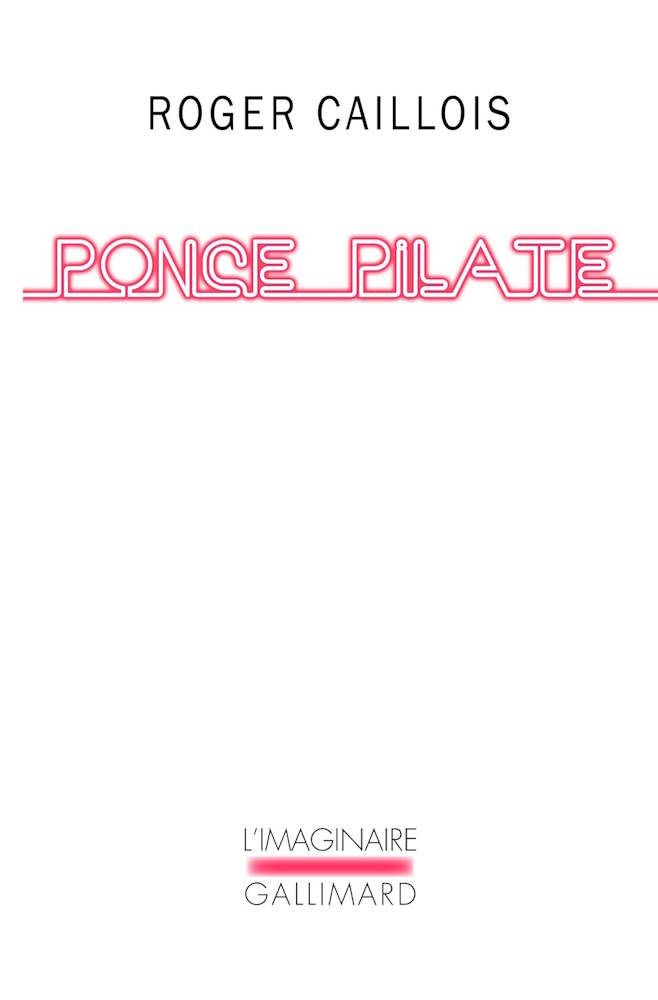|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Ponce Pilate
Roger CAILLOIS Première parution : Paris, France : Gallimard, 1961 GALLIMARD (Paris, France), coll. L'Imaginaire  n° 677 n° 677  Date de parution : 13 novembre 2015 Achevé d'imprimer : 2 novembre 2015 Réédition Roman, 154 pages, catégorie / prix : 6,90 € ISBN : 978-2-07-017767-7 Format : 12,5 x 19,0 cm❌ Genre : Imaginaire
Quatrième de couverture
Imaginons que Ponce Pilate ait décidé de faire libérer Jésus. Ainsi le sauveur est sauvé par le courage inattendu d'un fonctionnaire romain, connu pourtant pour sa prudence, sinon pour sa faiblesse. De sorte que Jésus vit jusqu'à un âge avancé, qu'il n'y a pas de christianisme et que presque aucun des événements des deux derniers millénaires ne se produit.
Pilate n'a d'estime que pour la sagesse. Il se méfie des religions. Mais est-il sage de compter sur la sagesse pour transformer le monde ?
Critiques des autres éditions ou de la série
C'est presque sur un argument de Jorge Luis Borges que l'introducteur en France de Borges, Roger Caillois, a choisi d'écrire un récit philosophique. Si mes souvenirs sont bons, en effet, un des récits du « Jardin aux sentiers qui bifurquent » réhabilitait Judas en le peignant conscient et de la portée et de la nécessité de son crime : le crucifié réel, concluait Borges, c'était Judas. Parce que son supplice n'avait pas de fin et qu'il était condamné à porter le poids de l'opprobre aussi longtemps que l'humanité durerait. Caillois, lui, choisit non de réhabiliter Pilate au niveau des intentions en conservant intact l'enchaînement des événements (donner un sens différent à un labyrinthe identiquement répété parce que la répétition même induit une transformation de la signification), mais de décrire un possible différent de l'histoire dont le nœud est une décision morale. Ainsi Caillois prend ses distances d'avec Borges. Ce dernier est exclusivement métaphysicien tandis que le premier se veut moraliste. Mais ce sont de courtes distances, car la métaphysique de l'Argentin débouche sur une casuistique, tandis que la morale du Français se perd dans les sables de l'impossible problème de la liberté. Pilate, donc, doit décider. Et toute l'œuvre de Caillois se déroule en contre-point d'une décision attendue, d'un texte connu. Parce que Pilate décidera autre chose qu'il n'est dit dans l'évangile, il faut le considérer comme le premier des hérétiques, le protothérésiarque. Dans la mesure où Caillois s'assimile à son personnage, il assume lui-même l'hérésie ; or, l'hérésie ne consiste pas à croire seulement que la vérité est autre que celle qui est enseignée. Elle consiste à rejeter la vérité dans les limbes, à la refuser, comme fait Caillois, qui d'une phrase ultime renonce à quelque deux mille ans d'Histoire : « L'histoire, sauf sur ce point, se déroula autrement. » Le récit commence là et finit là. La phrase est trop belle, trop nette, pour que le récit tout entier n'ait été composé pour qu'elle vînt le clore. En une ligne, l'univers bascule, et de réel, le lecteur devient imaginaire, nié par un auteur qui a pris la précaution de franchir la ligne de démarcation dès le début du livre. Le lecteur devient un personnage du rêve prophétique de Mardouk, et rien d'autre. Notre histoire tout entière, passé ce point-clé qu'a été la décision de Pilate, n'est rien de plus qu'un rêve, habile et effrayant certes, mais simple construction de l'esprit. Et comme il n'y a aucune raison pour que le problème de Pilate ait été le seul carrefour du temps, il convient d'imaginer des séries infinies et bourgeonnantes d'univers qui se rêvent et s'excluent réciproquement. Le labyrinthe de Caillois se prolonge totalement dans le virtuel. Il est la contrepartie exacte des labyrinthes concrets et géométriques de Borges. Il n'y a pas que des résonances de Borges dans les subtilités de Roger Caillois. Page 62 : Mardouk « disait par plaisanterie… qu'il ne connaissait que deux sciences exactes, les mathématiques et la théologie. » Dans son excellent livre, « Le pont du roi Saint Louis, » Thornton Wilder décidait frère Juniper à penser qu'il « était grand temps que la théologie devint une science exacte. » C'est que Borges, Caillois, Wilder et quelques autres appartiennent à une classe d'esprits singuliers. Leur scepticisme est-il une élégance ? Leur sobriété cache-t-elle une démesure ? Je crois bien que le classicisme extrême de leur forme cache un romantisme exacerbé des idées, une sensibilité tout entière détournée vers les structures abstraites, et dont l'expression me satisfait non sans m'inquiéter. Car ceux qui jouent à être des dieux sont souvent près de cesser de jouer. Gérard KLEIN |
| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |