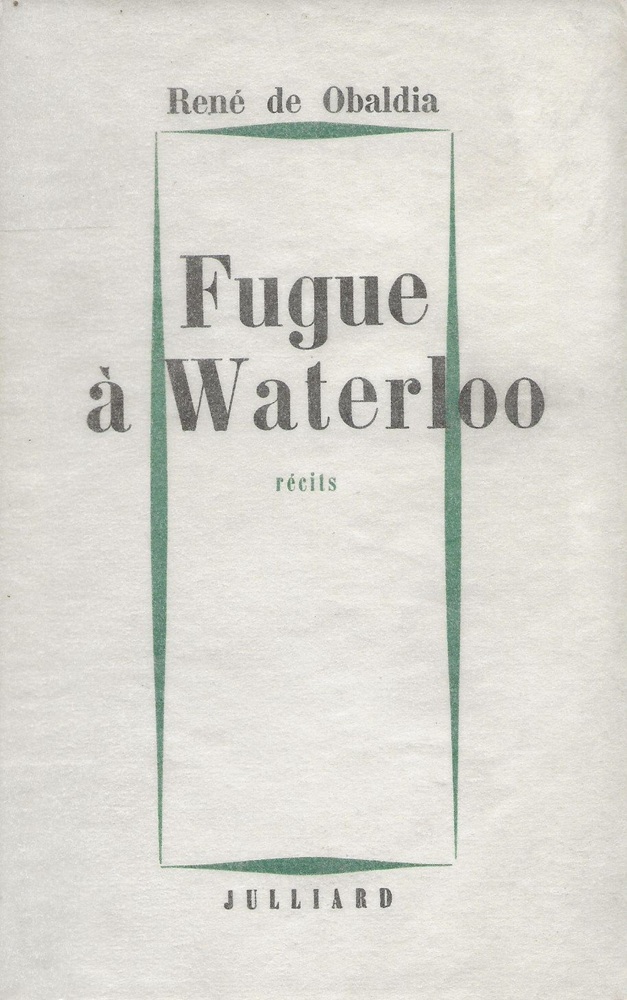|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Fugue à Waterloo - Récits
René de OBALDIA JULLIARD (Paris, France) Dépôt légal : 1956 Première édition Recueil de romans, 260 pages, catégorie / prix : 600 FR ISBN : néant Format : nd❌ Genre : Hors Genre Pas de texte sur la quatrième de couverture.
Critiques
J'avais l'an dernier (n° 23) dit les qualités éclatantes du « Tamerlan des cœurs », de René de Obaldia, cette merveilleuse chevauchée circulaire autour de l'Histoire au rythme d'un cœur battant. L'auteur d'un tel ouvrage s'affirmait être un des écrivains les plus personnels et les plus fascinants du moment. J'attendais donc avec une grande curiosité son livre suivant, et « Fugue à Waterloo » (Julliard) ne m'a pas déçu. Une telle affirmation est le plus bel éloge qu'on puisse imaginer. Ne pas décevoir après « Tamerlan », c'était en effet de la corde raide. Il y avait là un écueil terrible qu'Obaldia a franchi avec une élégance d'acrobate, tout en résistant victorieusement à la tentation dangereuse du recommencement. Car il a bien vu une chose : on ne refait pas un « Tamerlan ». On ne fait pas deux fois de suite le grand écart de part et d'autre de l'espace, pas deux fois de suite le saut périlleux dans le temps. La force d'un tel livre est de rester un tout unique et improlongeable. Obaldia a donc délibérément tourné le dos à « Tamerlan ». À la symphonie pour grandes orgues, il a substitué des sonates pour orchestre de chambre, à la quatrième dimension cosmique les dimensions de l'homme, à la fresque cinématographique pour écran géant des tableaux qui ne débordent pas de leur cadre. Et c'est bien dans la mesure où il a limité ses moyens et ses effets qu'on peut trouver admirable qu'il ne déçoive pas. « Fugue à Waterloo » se compose de deux récits (ou courts romans). L'un (qui donne son titre au livre) se joue dans un registre rose et pourpre : le rose des cœurs épris et le rouge des joies amoureuses ; l'autre (« Le Graf Zeppelin ou La passion d'Émile ») dans un registre gris et violet : le gris d'une vie d'ennui et le violet des profondeurs sous-marines de l'âme, ouverte sur ses abîmes psychanalytiques. Tous deux roulent sur des données psychologiques, avec une étude artistique des caractères ; leur cadre est ancré dans le quotidien, leur sujet n'a rien de révolutionnaire à première vue, leur facture est « classique ». L'envergure qui caractérisait « Tamerlan » s'est repliée sur elle-même. Le singulier est que ces deux histoires, traitées par n'importe quel auteur, auraient été fort réalistes. Or il se passe ceci avec Obaldia, qu'elles débouchent pour s'y épanouir sur un arrière-plan parfaitement mythique. J'ai dit plus haut que c'étaient des tableaux qui ne débordaient pas de leur cadre. C'est exact, mais ils débordent en profondeur ; leur trame laisse entrevoir par transparence des motifs qui se cachent derrière. Alouette et Zilou, les deux petits amants touchants et bêtes qui ont choisi Waterloo comme cadre d'une fugue amoureuse, ne se doutaient pas qu'ils allaient se trouver plongés dans l'Histoire jusqu'au cou. On a tellement l'habitude de considérer Waterloo comme un champ de bataille qu'on oublie que c'est un petit village belge près de Bruxelles. Mais Obaldia a « inventé » Waterloo, il en a fait un lieu à la fois cocasse et inquiétant, un no man's land baroque où le temps semble retarder de cent cinquante ans et l'Histoire se perpétuer éternellement fraîche, pour vous guetter à chaque tournant. Alouette et Zilou vivent des heures d'ivresse aux sons des tambours et des défilés napoléoniens. Il y a là un contrepoint ironique à « Tamerlan » (toujours cette hantise de l'Histoire) et un lyrisme passionnel à la fois tendre et un brin parodique. Et cependant, au-delà de leurs petits ridicules, dans ce lieu lui-même magique, Alouette et Zilou atteignent à la magie de l'amour. La nuit où leur passion a connu son sommet, ils vivent un singulier rêve éveillé et voient par leur fenêtre Waterloo transformé en port de pêche et la « morne plaine » en océan – mystère privilégié qu'ils n'élucideront jamais. Chaque récit est construit autour d'un symbole-clé. Le symbole amoureux de la mer, dans « Fugue à Waterloo », écartèle en direction du bizarre et transfigure l'aventure d'Alouette et Zilou. De même dans « Le Graf Zeppelin », où le héros est obsédé par les images de la catastrophe du fameux dirigeable, qu'il a vues à une séance d'actualités rétrospectives et qui reviennent le hanter périodiquement, comme un leitmotiv annonçant sa propre destruction. L'histoire est en effet celle d'un homme qui sombre dans la folie, mais une folie extraordinaire. Le thème traité par Obaldia, et inspiré par une phrase de Miguel de Unamuno, est celui de « la paternité qui rend fou ». Dès le moment où Émile, petit rond-de-cuir à la triste figure, devient un père en puissance, tout se passe comme si le fœtus maléfique abrité par sa femme (réduite pour lui à l'état de « ventre » monstrueux), s'accroissait au détriment de ses forces vitales à lui. Plus le « ventre » grossit, plus le malheureux se sent « pompé », vidé de son énergie psychique, poussé à la mort par le mystère trop grand pour lui de cette vie dont il est l'Auteur. D'où le symbole : le dirigeable prêt à éclater = le « ventre » prêt à s'ouvrir pour livrer passage au monstre. Et la naissance s'identifie à la catastrophe ; Émile est cerné de toutes parts par la prolifération de sa démence, chassé de sa propre peau par l'être dévorateur qu'il a engendré. « Le Graf Zeppelin » est le meilleur des deux récits. C'est une histoire grave qui serait atroce si l'auteur ne l'avait tempérée par le pittoresque du ton. Et elle atteint à une grandeur étrange dans la description parfois hallucinante des paroxysmes de cette obsession. Ce diptyque curieux, si loin des recettes courantes, confirme encore la place originale qu'occupe René de Obaldia parmi les jeunes romanciers. Mais son optique très personnelle n'est à ce point séduisante que dans la mesure où elle est servie par des dons brillants. Il est peu d'écrivains chez qui tout sente autant la richesse native : luxe de la mise en œuvre, rutilance des effets, éclats de pierre précieuse de la langue… Et n'est-ce pas pour nous combler que s'ajoute à tout cela une imagination si joliment tournée vers l'insolite ? Alain DORÉMIEUX |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |