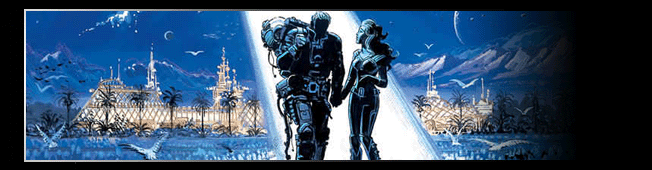

Extrait du dossier Mézières de la revue DBD, septembre 2001, révisée en novembre 2002
Né
en 1938, à l'aube d'une période agitée. Comment
s'est déroulée votre enfance ?
Mes
premiers souvenirs datent de la fin de la guerre, quand nous habitions
à Saint-Mandé, en banlieue parisienne. Plus tôt,
mes parents avaient quitté Paris pour la région de Bordeaux
au moment de l'exode, mais je n'en ai aucun souvenir. Un des premiers
événements qui m'aient marqué, bien sûr,
ce sont les alertes aériennes à la fin de la guerre, et
la rencontre avec le camarade Christin qui habitait l'immeuble à
côté. Avec mes parents, mon frère aîné,
ma sœur, Pierre et sa famille, nous descendions dans l'abri à
la cave et nous avons sympathisé. J'ai également un autre
souvenir précis, beaucoup plus dramatique. Dans une école
à côté, il y avait un groupe de petites filles.
En fait, il s'agissait d'enfants juives réfugiées. Une
nuit, des camions allemands sont venus et les petites filles sont parties...
Quelles
professions exerçaient vos parents ?
Mon
père était expert pour les assurances automobiles
dans les années trente. Puis, aide-comptable dans un ministère
qui s'appelait, après la guerre... le ministère de la
Guerre ! Ma mère était femme au foyer. Mais il y a toujours
eu un certain goût pour le dessin dans la famille et l'influence
de mon grand frère a été prépondérante.
Avez-vous
découvert la Bande Dessinée très jeune ?

Oui
Lorsqu'il avait quatorze ans (et que j'en avais donc sept), mon frère
avait publié un de ses dessins dans OK Magazine. Une revue où
il y avait notamment Arys Buck (de Uderzo), Kaza le martien
(par Kline), Crochemaille (par Erik) et des westerns que je trouvais
déjà très chouettes... Arys Buck me plaisait
beaucoup. A tel point que lorsque j'ai dessiné un Tintin
en Californie, mon personnage avait bien la tête du héros
de Hergé... mais la corpulence d'Arys Buck ! Récemment,
en recherchant dans une pile de vieux OK le dessin de mon frère,
je suis tombé, dans le courrier des lecteurs, sur le premier
dessin publié par Fred, qui avait alors dix-sept ans.
Avez-vous
lu d'autres journaux ?
Oui.
Après OK, nous sommes passés à Tintin et, ensuite,
à Spirou. Au niveau des albums, c'est ma marraine qui m'a fait
un cadeau formidable, en m'offrant mon premier Tintin, Le Lotus Bleu...
Bizarrement, je ne 'cumulais' pas. J'ai eu ma période OK,
puis ma période Tintin et, enfin, ma période Spirou.
A
cette époque, quel métier vouliez-vous faire ?
C'est
simple : je voulais être cow-boy et dessinateur de bandes dessinées.
J'ai pas trop mal réussi (rires) !... Mon frère avait
réalisé quelques histoires en bandes dessinées,
pour le plaisir, en amateur. Et moi, j'en faisais la suite, en reprenant
ses personnages. J'ai dessiné ainsi des tas de pages. Le style
de mes dessins n'était pas terrible du tout, mais le virus était
déjà là.
Dans
cette optique, quelles études avez-vous suivies ?
A
quinze ans, je suis entré aux Arts Appliqués.
Mais avant, j'avais envoyé un album de seize pages à Hergé,
que je prenais à l'époque pour monsieur Casterman !

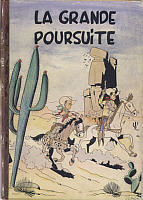


 Quand il m'a envoyé une lettre me disant « C'est bien mon petit,
continue », j'étais déçu parce qu'il ne m'avait
pas édité (rires) !... En fait, mes premières
publications étaient pour Le journal des jeunes (publié
par Le Figaro
pendant le Salon de l'Enfance 1952), puis Cœurs
Vaillants et Fripounet, pendant que je poursuivais l'école.
A Cœurs Vaillants, c'est Jean-Marie Pélaprat (que
j'ai retrouvé à Pilote beaucoup plus tard)
qui m'avait pris quelques petits strips, sans doute inspirés
par ceux que j'avais lus plus tôt dans OK. J'avais entraîné
avec moi Pat Mallet et Jean Giraud, rencontrés aux Arts Appliqués.
Toujours à cette époque, j'ai aussi travaillé pour
un journal publicitaire de Philips... Ce qui était essentiel
en fait, c'est que nous étions payés pour faire des progrès
! Ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, les jeunes auteurs doivent
être nettement plus aboutis pour espérer signer un contrat
d'album, et faire leurs preuves.
Quand il m'a envoyé une lettre me disant « C'est bien mon petit,
continue », j'étais déçu parce qu'il ne m'avait
pas édité (rires) !... En fait, mes premières
publications étaient pour Le journal des jeunes (publié
par Le Figaro
pendant le Salon de l'Enfance 1952), puis Cœurs
Vaillants et Fripounet, pendant que je poursuivais l'école.
A Cœurs Vaillants, c'est Jean-Marie Pélaprat (que
j'ai retrouvé à Pilote beaucoup plus tard)
qui m'avait pris quelques petits strips, sans doute inspirés
par ceux que j'avais lus plus tôt dans OK. J'avais entraîné
avec moi Pat Mallet et Jean Giraud, rencontrés aux Arts Appliqués.
Toujours à cette époque, j'ai aussi travaillé pour
un journal publicitaire de Philips... Ce qui était essentiel
en fait, c'est que nous étions payés pour faire des progrès
! Ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, les jeunes auteurs doivent
être nettement plus aboutis pour espérer signer un contrat
d'album, et faire leurs preuves.
Que
pensiez-vous alors du dessin de Jean Giraud ?
Il
m'avait subjugué dès le début, et mon problème,
c'est qu'étant toujours avec lui, je n'avais pas une très
grande ambition pour mon propre dessin. Tout simplement, parce que j'en
voyais sacrément les limites (rires). Il m'a scié
les pattes pendant quelques années !
Il
a fait cet effet-là à pas mal de gens !
Oui
! Jamais volontairement, d'ailleurs... Mais je publiais, sans vraiment
m'attacher à mon dessin. Et là, je dois rendre grâce...
au Service Militaire d'avoir interrompu ma carrière de dessinateur !

 En effet, juste avant de partir, j'ai publié deux pages dans
le Spirou de Noël 1958 dans un style décoratif épouvantable,
et je pense que si j'avais continué dans cette voie, je n'aurais
pas été loin. En plus, c'était pompé honteusement
sur un illustrateur de la revue de graphisme suisse Graphis,
le top du stylisme ! Avant mon service, je suis aussi allé à
Bruxelles avec Pat Mallet. Pour mon premier voyage au-delà des
frontières, j'ai été gâté : j'ai rencontré
Franquin et découvert l'Atomium flambant neuf ! A la même
époque, avec Giraud en plus, nous sommes allés voir Jijé
qui habitait, lui, en région parisienne, à Champrosay,
près de Draveil. Souvenir inoubliable... bien que je sache que
mon travail, à l'époque, n'en avait laissé aucun
à Jijé.
En effet, juste avant de partir, j'ai publié deux pages dans
le Spirou de Noël 1958 dans un style décoratif épouvantable,
et je pense que si j'avais continué dans cette voie, je n'aurais
pas été loin. En plus, c'était pompé honteusement
sur un illustrateur de la revue de graphisme suisse Graphis,
le top du stylisme ! Avant mon service, je suis aussi allé à
Bruxelles avec Pat Mallet. Pour mon premier voyage au-delà des
frontières, j'ai été gâté : j'ai rencontré
Franquin et découvert l'Atomium flambant neuf ! A la même
époque, avec Giraud en plus, nous sommes allés voir Jijé
qui habitait, lui, en région parisienne, à Champrosay,
près de Draveil. Souvenir inoubliable... bien que je sache que
mon travail, à l'époque, n'en avait laissé aucun
à Jijé.
Vous
avez fait votre service militaire en Algérie...
Oui.
J'ai passé seize mois en France et un an à Tlemcen, de
60 à 61. Je suis rentré en France quinze jours avant le
putsch d'Alger et la rébellion des généraux...
J'ai eu de la chance. Tlemcen était, paraît-il, l'endroit
où les événements avaient commencé en 54,
mais le coin était calme à l'époque où je
m'y trouvais. Je n'ai tiré sur personne et personne ne m'a tiré
dessus. Pas de faits d'armes, ni héroïques, ni épouvantables...
Nous savions qu'il y avait des trucs dégueulasses qui se passaient,
c'est évident, mais seulement par des bruits qui couraient puisque
nous n'étions pas une unité combattante...
Quelle
mission aviez-vous ?
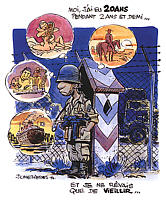
L'armée
étant toujours très compétente dans ses affectations,
je me suis retrouvé dans le matériel, chargé de
reconnaître dans des catalogues les pièces pour tel ou
tel engin... Heureusement, je n'ai jamais fait cela. Je me suis même
débrouillé pour faire quelques dessins... Mais, dans l'ensemble,
c'était la nullité absolue. Nous montions la garde, faisions
des patrouilles... Sous le casque lourd, ça gambergeait ferme...
Comment
s'est passé votre retour à la vie civile ?
Je
n'avais toujours pas l'idée de refaire de la bande dessinée.
Et là, j'ai eu un coup de chance terrible. Quinze jours après
mon retour, mon père me signale une petite annonce dans Le
Figaro : « Importante maison d'édition recherche
maquettiste ». Aujourd'hui, il y aurait trois mille personnes
au bas de leur immeuble ! Je suis allé voir... et je me suis
retrouvé embauché au Studio Hachette (comme maquettiste
!), pour travailler sur des livres, Histoires des civilisations,
illustrés à
la gouache par des dessinateurs italiens. L'adaptation en
français nécessitait des maquettes puis des illustrations
supplémentaires, réalisées par de nouveaux dessinateurs.
Une nouvelle fois, j'ai entraîné l'ami Giraud avec moi,
et c'est là que Jean a mis au point son travail de la gouache.
Nous avions avec nous les originaux des italiens, qui étaient
d'une maîtrise technique absolue, mais d'un dessin pas très
excitant. Jean a tout compris à la technique et, lui, c'était
beau. En plus, c'était très bien payé... mais ça
s'est cassé la figure au bout d'un an et demi, après cinq
volumes.
Pour
quelles raisons ?
Oh,
parce que ce n'était ni fait ni à faire. Les textes des
historiens étaient quasiment télégraphiques. Quand
on a seulement quinze lignes pour résumer l'histoire de la Mésopotamie,
ce n'est pas gagné (rires) ! En plus de dessiner des scènes
de genre (la course de char, l'attaque de la ville de Mycène,
etc.), nous devions recopier des photos de vases ou de sculptures. Cela
nous a amené à faire des recherches sur les effets de
matière (par exemple des frottis de gouache sèche pour
rendre la pierre)... Après cet épisode Hachette,
je n'avais toujours pas retrouvé l'envie de faire de la bande
dessinée. A ce moment-là, Giraud encrait les planches
de Jerry Spring et il m'a présenté le fils de Jijé,
Benoît Gillain, qui ouvrait un petit studio de publicité
(il est d'ailleurs toujours publicitaire aujourd'hui). J'ai été
son premier partenaire.
Quel
était votre rôle ?
J'étais
assistant photographe, maquettiste, graphiste, etc. C'était en
1963. J'étais alors devenu très copain avec Jijé
qui travaillait parfois pour le studio. Il y a même un paquet
de lessive fameux dans lequel on retrouve nos deux signatures. Une pièce
de collection (rires) !... Ensuite, Giraud est reparti au Mexique,
où il était déjà allé une première
fois à seize ans pour retrouver sa mère. Nous avions prévu
de nous rencontrer à Mexico ou à New York, mais, en fait,
je suis parti pour les États-Unis huit jours après le
retour de Jean !
Juste
avant votre départ, il y avait eu le lancement de Total Journal...
Oui.
Avec Benoît Gillain, nous avions préparé un numéro
zéro (dans lequel je n'avais aucune parution). Et, à mon
retour, fin 66, j'ai repris Total Journal et je m'en suis occupé
pendant trois ans avec Pierre Christin. Il y a eu pas mal de numéros
dans lesquels nos petits camarades de Pilote (Brétecher,
Gotlib, Mandryka, Giraud, Jijé et d'autres) sont venus faire
des petits travaux, sympas,... et plutôt bien payés.
Quelles
étaient vos intentions en partant aux États-Unis ?
Aller
voir comment c'était vraiment à l'ouest du Pecos !
Comment
avez-vous organisé ce départ ?
En
fait, Jijé avait un ami belge à Houston, au Texas, qui
avait une usine
de charpentes métalliques. Je suis donc parti
avec un visa de stagiaire industriel de un an, en qualité de
dessinateur en charpentes métalliques. Bonjour les dégâts
! Heureusement que je n'en ai jamais dessiné une, sinon l'Amérique
n'aurait pas la tête qu'elle a aujourd'hui (rires)... Je
n'ai même jamais travaillé pour ce brave homme. Moi, ce
que je voulais, c'était aller garder les vaches à cheval.
J'étais parti pour partir, « Go west, young man ! »
Là-bas,
vous allez retrouver Pierre Christin !

Oui.
A cette époque, nous avions tous une énorme envie d'Amérique.
Pierre, qui était déjà marié et père
d'un enfant, avait trouvé, pour un an, un poste de professeur
de littérature française contemporaine à l'université
de Salt Lake City. Évidemment, je savais qu'il y serait et, un
jour d'hiver où il y avait un mètre cinquante de neige,
j'ai débarqué chez lui avec ma selle, mes bottes et mon
chapeau, en lui demandant si je pouvais dormir sur son canapé
! D'ailleurs, nous venons de publier Adieu,
rêve américain dans les Correspondances de Christin, une
réflexion sur l'Ouest, l'Amérique des années 60... et de
maintenant, surtout depuis le 11 septembre !
Bonjour la nostalgie !
Pendant
ces périodes hivernales, que faisiez-vous ?
Je
suis allé voir des petites agences de publicité et j'ai
fait quelques dessins, même des illustrations pour un Cœurs
Vaillants mormon : Children's friend...
Des bricoles qui étaient payées des misères, mais c'était toujours quelques dollars... de plus. J'ai vendu également quelques photos parce que j'avais déjà travaillé dans un ranch du Montana l'été précédent... C'est à ce moment-là que Pierre m'a suggéré de refaire de la bande dessinée. Nous avons écrit ensemble le scénario de notre première histoire, Le rhum du punch. J'ai dessiné mes six pages, que j'ai envoyées à Giraud. Il faisait déjà Blueberry pour Pilote, et il a montré notre travail à Goscinny. Ce dernier ayant un journal de 64 pages à remplir toutes les semaines l'a publiée sans état d'âme. Puis, nous en avons fait une deuxième, Comment réussir en affaires en se donnant un mal fou, trois mois plus tard.
Je suis le premier dessinateur français de bandes dessinées qui gardait les vaches à cheval pendant qu'on imprimait ses histoires (rires) ! Mais c'est grâce à ces deux publications dans Pilote que j'ai pu payer mon billet de retour...
Dans
quel style étaient ces premières histoires ?
C'était
vraiment dans l'esprit de Mad, qui est ma seule grande influence
américaine au niveau de la bande dessinée. J'adorais Jack
Davis, Kurtzman, Elder, Wood et les autres...
Au
final, combien de temps êtes-vous resté aux États
Unis ?
Un
an et demi. J'ai prolongé mon visa de stagiaire d'un visa de
touriste de six mois. Et je suis rentré à Paris le dernier
jour de mon dernier visa, presque avec les flics de l'immigration aux
fesses ! !
Vous
n'avez jamais eu la tentation de rester là-bas ?
Garçon
vacher, c'est vraiment journalier agricole. Même si ce que j'ai
fait, je l'ai fait avec énormément de plaisir, je n'ai
pas les mains, je n'ai pas la carrure... C'est un métier très
dur. Il faut être né là-bas. Mais c'est une expérience
extraordinaire, qui m'a profondément marqué. D'ailleurs,
ma femme est américaine et nous sommes retournés très
régulièrement dans l'Ouest. En 1969, pendant l'interruption
dans Pilote entre La Cité des Eaux Mouvantes
et Terres en Flammes, je suis même retourné en Utah
pendant un mois pour voir mes chevaux !... Quant à travailler
pour la BD aux USA, alors là, si vous pensez que je peux dessiner
Valérian avec plein et muscles et en contre-plongée, c'est
non (rires) ! L'Europe est la terre promise de la BD, du moins
depuis les trente dernières années.
Avez-vous
au moins continué à faire du cheval à votre retour
en France ?
Ah
oui, toujours. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a un cheval qui
passe, je saute dessus (rires) ! En plus, dans l'Aveyron, j'ai
eu la chance d'avoir des voisins qui avaient des chevaux et qui me demandaient
de les sortir...
Je
crois que vous êtes retourné sur les mêmes lieux
il y a deux ans. Comment cela s'est-il passé ?
Un
vrai saut spatio-temporel. Je suis retourné au ranch même
où j'avais travaillé la première fois, trente-cinq
ans auparavant ! J'ai retrouvé les mêmes rochers, les mêmes
chevaux, les mêmes personnes... avec leurs fils qui étaient
plutôt surpris de voir un français connaissant aussi bien
le coin ! Mais on parle plus en détail de tout cela dans les
Correspondances de Christin... et Mézières !
Après
votre premier séjour américain, comment s'est déroulé
votre retour en France ?

Je
suis allé à Pilote voir Goscinny qui m'a encouragé
à continuer et m'a proposé de dessiner Auguste Faust,
une histoire en 28 pages déjà écrite par Fred.
Cela me paraissait énorme ! En plus, le scénario était
entièrement découpé et crobardé, ce qui
me bloquait complètement. Finalement, j'ai fait un truc ni mieux
ni pire que d'autres, mais cela ne me convenait pas. Même si je
me suis aperçu récemment que ce Auguste Faust était
un peu l'ancêtre de Monsieur Albert... Après cette expérience
avec Fred, j'ai rattrapé Christin entre deux trains (il passait
alors une bonne partie de son temps à Bordeaux pour y fonder
l'I.U.T. de journalisme) et je lui ai dit : « Pierrot, il faut
que nous démarrions une histoire ensemble ». Il a analysé
le problème en disant que si nous connaissions tous les deux
l'Ouest, le domaine était déjà bien occupé
par quelques pointures, avec Blueberry, Lucky Luke, Jerry Spring...
Les ambiances début de siècle un peu fantastiques (genre
Sherlock Holmes) nous tentaient aussi, mais, finalement, Pierre a suggéré
une histoire de science-fiction. C'est un genre littéraire que
nous aimions tous les deux et qui, à l'époque, n'avait
pas encore été beaucoup abordé par la bande dessinée
francophone. Nous nous sommes donc lancés dans un récit
en trente pages, sans même penser à un album. Et puis voilà
: trente-cinq ans plus tard, nous faisons toujours Valérian...
Quels
souvenirs gardez-vous de René Goscinny ?
Oh,
un grand souvenir. René était à la fois très
facile à joindre et difficile à approcher. Il conservait
toujours une certaine distance... Nous avons beaucoup parlé ensemble
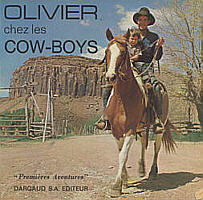 des États-Unis puisqu'il avait séjourné à
New York. Charlier, lui, était allé quelques années
auparavant en Arizona et c'est sans doute pour cela qu'il m'a proposé
de publier Olivier chez les cow-boys, un petit album réalisé
à partir de photos que j'avais faites quand Christin était
venu me voir au ranch avec sa femme et son fils. Charlier voulait même
lancer une collection de petits livres du même genre. Je crois
qu'il y a eu un autre titre imprimé. Mais aucun des deux n'a
jamais été distribué. C'était un genre hors
des compétences de la maison Dargaud... Pour en revenir à
Goscinny, je ne crois pas que la SF était son domaine favori,
mais il avait un désir d'innover, de proposer dans son journal
des travaux originaux (avec des limites, bien sûr). Il a vu, peut-être
avant nous, ce que Valérian pourrait apporter. Travailler pour
Pilote en 1967 était une chance immense...
des États-Unis puisqu'il avait séjourné à
New York. Charlier, lui, était allé quelques années
auparavant en Arizona et c'est sans doute pour cela qu'il m'a proposé
de publier Olivier chez les cow-boys, un petit album réalisé
à partir de photos que j'avais faites quand Christin était
venu me voir au ranch avec sa femme et son fils. Charlier voulait même
lancer une collection de petits livres du même genre. Je crois
qu'il y a eu un autre titre imprimé. Mais aucun des deux n'a
jamais été distribué. C'était un genre hors
des compétences de la maison Dargaud... Pour en revenir à
Goscinny, je ne crois pas que la SF était son domaine favori,
mais il avait un désir d'innover, de proposer dans son journal
des travaux originaux (avec des limites, bien sûr). Il a vu, peut-être
avant nous, ce que Valérian pourrait apporter. Travailler pour
Pilote en 1967 était une chance immense...
Pilote, c'était aussi les contraintes de l'hebdomadaire...
Ah, oui ! Nous devions rendre notre travail le jeudi après-midi avant cinq heures et il m'est arrivé d'être devant mes deux planches à midi avec encore trois cases à faire. C'était un travail de feuilletoniste. Il fallait avancer, avancer, avancer, sans état d'âme. C'est sûr que les rois de l'aérographe ou, aujourd'hui, de la palette graphique, auraient eu du mal à tenir les délais ! En plus, à l'époque, les dessinateurs étaient submergés de travail. En 69 — 70, moi qui ne produis pas beaucoup, je faisais un Valérian, des pages d'actualité pour Pilote, et des histoires pour les superpocket qui étaient, heureusement, des mini-pages... D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce format. En trois ou quatre images, la planche était calée. On pouvait se dire qu'on allait faire une page dans l'après-midi, tout en lui donnant une vraie force. Aujourd'hui, une planche de Valérian me prend une semaine...
Vous
avez rapidement été amené à donner des cours
de bande dessinée à l'université de Vincennes.
Comment cela s'est-il fait ?
C'est
Moliterni qui avait eu un contact là-bas et il avait demandé
à Giraud, Druillet et Gotlib (et peut-être quelques autres)
de faire des interventions pour des étudiants d'une section d'arts
graphiques. Moi, j'ai dû venir aussi une fois comme ça.
Puis, l'année suivante, Moliterni a voulu continuer les interventions
de manière plus régulière et m'a demandé
si je voulais participer. Il avait sans doute jugé que je parlais
bien des problèmes de la bande dessinée. Et pour cause,
puisque je les ai pas mal essuyés moi-même ! D'autant que
je n'avais effectivement que quelques années d'expérience,
contrairement à Giraud.
Concrètement,
comment ces interventions se déroulaient-elles ?
Il
n'était pas question de faire un cours théorique. Ce qui
m'intéressait, c'était de rencontrer des gens, de voir
leur travail et peut-être de trouver où (et, si possible,
pourquoi) cela n'allait pas. Je ne suis pas compétent pour dire
comment faire un 'beau' dessin, mais bien gérer une 'narration
graphique', je connais... J'allais à Vincennes tous les quinze
jours pendant trois ou quatre heures, qui se continuaient, généralement
tard, au bistrot devant le Fort.
Certains
de vos élèves de l'époque ont fait un peu de chemin
depuis...
Oui.
Je ne me souviens pas de tous, mais je sais qu'il y a eu Juillard, Loisel,
Le Tendre... entre autres !
Aujourd'hui
encore, vous arrive-t-il de répondre aux questions de jeunes
dessinateurs ?
Oui,
j'ai toujours quelques 'clients' qui viennent de temps en temps.
Et qui reviennent, bien qu'ils en prennent plein la tête (rires)...
Sérieusement, c'est difficile. Je n'ai ni le talent ni la patience
pour en faire une carrière, mais quand le travail de quelqu'un
ne fonctionne pas, j'aime bien comprendre pourquoi. Et, effectivement,
j'y arrive assez bien. J'aimerais être aussi lucide devant mes
propres dessins (rires) !
Un
peu dans le même ordre d'idées, vous avez créé,
quelques années plus tard, l'atelier pour Canal Choc...
Oui.
Les petits camarades Aymond et Labiano ne s'en sont pas mal sortis et
ils continuent allègrement. Chapelle, lui, s'est plutôt
dirigé vers la communication... L'idée était de
proposer à un éditeur un travail fait par des débutants
(aucun n'avait vraiment publié à l'époque), sous
les garanties de deux professionnels (Christin au scénario et
moi à la supervision graphique) pour les faire progresser rapidement.
Moi, je ne m'intéresse pas au dessin seul (je rencontre d'ailleurs
des tas de gens qui dessinent beaucoup mieux que moi), mais je sais
exactement si un dessin raconte ce qu'il doit raconter. Je trouve d'ailleurs
que beaucoup de grands professionnels ne sont pas assez lucides sur
ce problème. Il faut montrer ce qui est nécessaire au
récit et pas seulement se faire plaisir graphiquement. Il n'y
a pas de règles. On ne peut pas définir ce qui fait une
bonne mise en scène ou ce qui permet de bien mener un récit.
Il faut voir au cas par cas. A petites doses, c'est passionnant.
Comment
réagissent les jeunes auteurs ?
Cela
dépend. Mais quand le gars commence à froncer les sourcils
à mes remarques, je lui demande pourquoi il est venu me demander
mon opinion. S'il veut juste entendre quelqu'un lui dire que ce qu'il
fait est excellent, je lui conseille d'aller voir sa grand-mère
: elle fera cela mieux que moi !

























