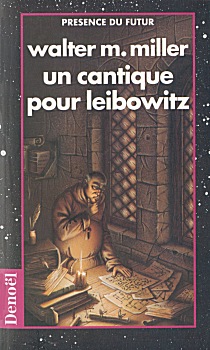|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
 Fiche livre
Fiche livre |
Connexion adhérent |
|
Un cantique pour Leibowitz
Walter Michael MILLER Titre original : A Canticle for Leibowitz, 1959 Première parution : Philadelphie, USA : J. B. Lippincott, octobre 1959 ISFDB Cycle : Leibowitz vol. 1  Traduction de Claude SAUNIER Illustration de Sandrine GESTIN DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 46 n° 46 Dépôt légal : avril 1994 Réédition Roman, 352 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : 2-207-50046-2 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
Devenu moine après la catastrophe nucléaire qui a marqué la fin du XX° siècle, le technicien Leibowitz a fondé un ordre pour sauvegarder les derniers livres et les dernières miettes du savoir balayé par la barbarie. Bien plus tard, grâce au travail des adeptes de saint Leibowitz, c'est une nouvelle Renaissance. Les savants puisent chez les moines le savoir préservé mais souvent mal compris de ses gardiens, et surtout des nouveaux dirigeants, plus avides de puissance que de sagesse. En sorte que l'Histoire menace rapidement de se répéter... Dans une ambiance qui préfigure celle du Nom de la rose, d'Umberto Eco, un chef-d'oeuvre de la S.-F. couronné par le prix Hugo 1961. Critiques des autres éditions ou de la série
En 1959, donc avant Vatican II et surtout avant la détente qui suivit la crise des missiles de Cuba, Walter Miller imaginait un monde post-atomique où les seules bribes de savoir étaient sauvegardées par des moines aussi compétents en enluminures qu'ignorants en technologie. L'idée était forte et faisait presque oublier les deux autres novellas du volume, situées dans le même univers mais un peu plus tard, alors qu'apparaît une science laïque et qu'on redécouvre l'électricité, puis que le pire recommence avec l'affrontement de deux blocs au moment où commence la conquête des étoiles. L'unité de ces morceaux de futur est assurée par le lieu principal, un monastère, par des souvenirs déformés, par une statue de bois ou par un personnage de fantasy, Juif errant immortel qui semble être Lazare le ressuscité. Et par des charognards, matérialisation du pessimisme foncier d'un livre allant d'une apocalypse à une autre. C'est très catholique, avec l'attachement au savoir et le désespoir quant à son usage par l'Homme, mais aussi par exemple l'horreur devant l'euthanasie quand bien même nul n'a d'autre solution à offrir. Mais ce n'est pas démonstratif. C'est avant tout une histoire, ou des histoires, avec des destins humains, individuels et collectifs, attachants et dérisoires. Et au total, ce livre, ancré dans le moment de son écriture, daté, y compris par des détails comme le papier carbone presque oublié aujourd'hui, est toujours lisible, toujours passionnant, toujours impressionnant. C'est sans doute la définition d'un vrai classique. Éric VIAL (lui écrire)
Voici le quatrième titre consécutif de « Présence du Futur » qui mérite, sans réserve, d'être qualifié de bon. Il y avait assez longtemps qu'un tel phénomène ne s'était plus produit dans cette collection pour qu'il soit bon de le signaler. Le présent roman est constitué par la juxtaposition – et le développement – de trois nouvelles publiées entre avril 1955 et février 1957 dans The Magazine of Fantasy and Science-Fiction. Au fond de l'histoire racontée par Walter Miller, il y a l'idée du perpétuel recommencement. Cependant, la religion catholique de l'auteur est sans doute à l'origine de l'optique particulière selon laquelle il traite son sujet. Walter Miller retrace d'abord les années d'obscurité consécutive à une guerre atomique : la civilisation est pratiquement détruite, et l'église catholique, par l'intermédiaire de ses monastères, cherche à préserver quelque étincelle de science à travers ce nouveau Moyen Âge. Le premier des épisodes qui constituent le livre se situe six cents ans, environ, après l'annihilation atomique de notre culture. Il raconte l'histoire de Frère Francis Gérard de l'Utah, un jeune novice de l'Ordre Albertien de Leibowitz : sur l'indication d'un mystérieux vieillard, il découvre une relique du fondateur de l'ordre. Il s'agit du schéma d'un circuit électronique (Leibowitz était un ingénieur du XXe siècle qui, ayant survécu à la guerre atomique, créa une communauté de religieux dont la tâche consistait à sauvegarder l'histoire du genre humain au milieu de la barbarie renaissante), schéma auquel Frère Francis ne comprend évidemment rien, mais qui jouera un rôle dans la canonisation d'Isaac Edward Leibowitz. Tout cet épisode est raconté avec un mélange attachant de tendresse et d'humour, et il est seulement dommage que, en développant sa nouvelle, Walter Miller ait choisi de faire de Francis un martyr : celui-ci est en effet tué par une flèche au cours d'une embuscade tendue par un groupe de voleurs ; dans sa forme primitive – telle qu'elle fut publiée en magazine – la nouvelle se terminait au moment où Francis décidait de partir à la recherche des voleurs qui l'avaient précédemment dévalisé, afin de leur expliquer la Vérité dont il venait d'avoir la révélation. Cette nouvelle fin pessimiste est peut-être due au désir de l'auteur de donner un ton plus sombre à l'ensemble de sa narration. Le second épisode se situe six siècles après le premier – en l'an de grâce 3174. Il est lié au précédent par le cadre – la vieille abbaye où Francis faisait une copie enluminée du schéma électronique – par le mystérieux pèlerin du premier récit, ainsi que par une statue de Saint Leibowitz qu'un compagnon de Francis avait confectionnée, et devant laquelle l'abbé Dom Paulo aime maintenant méditer. Dans cette nouvelle, Walter Miller a cherché à dépeindre une nouvelle Renaissance ; les princes régnant sur les diverses parties de ce qui fut jadis les États-Unis se disputent la suprématie du territoire, et l'abbaye présente des avantages stratégiques qui rendent difficiles les relations entre le pouvoir religieux et les divers monarques. Une nouvelle force est cependant entrée en jeu : la science, dont le réveil est représenté par Frère Komhoer, lequel cherche à fabriquer une lampe à arc dans les sous-sols de l'abbaye, ainsi que par Thor Thaddeo Pfardentrott, savant séculier dont les vues s'opposent parfois à l'enseignement de la religion. Walter Miller a eu le grand mérite de montrer que chacun des deux « camps » détient un peu de la vérité, que Dom Paulo, tout comme Thor Thaddeo, a ses faiblesses, et que, malgré les divergences d'opinions qui les séparent, chacun des deux hommes éprouve quelque respect pour l'autre. Il y a bien, ici ou là, quelques longueurs dans les dialogues, mais l'auteur ne se perd pas en subtilités théologiques : il ne s'adresse pas seulement à ses coreligionnaires, mais à tous ceux qui possèdent quelque largeur de vues. L'étrange vieillard qui apparaît dans cette seconde partie, après avoir rencontré Francis durant le premier épisode, demeure mystérieux et anonyme – bien que Dom Paulo l'appelle Benjamin – est-il une sorte de Juif Errant, ou « simplement » un homme du XXe siècle dont la longévité est le résultat d'une mutation inexpliquée ? Il n'importe guère : il demeure au-dessus du conflit, et relève les faiblesses de l'abbé aussi bien que celles du savant. Dans une certaine mesure, l'auteur en fait son porte-parole, et se sert de lui pour montrer que le véritable conflit n'est pas celui qui sépare l'abbaye et le souverain du pays, mais bien celui qui risque d'opposer Thor Thaddeo et Dom Paulo ; une note optimiste se devine cependant à travers le récit – elle est due au fait que l'abbé et le savant sont tous deux des Hommes de Bonne Volonté, en dépit de leurs faiblesses. Quant au dernier épisode, il se situe en l'année 3781, alors que la civilisation a rejoint son niveau du XXe siècle ; l'humanité commence à explorer l'espace, et elle est à nouveau sur le point de se suicider collectivement : ce dernier chapitre de l'histoire de l'Ordre se déroule devant un fond de guerre atomique, alors que le dernier abbé, comme ses prédécesseurs, se heurte à nouveau à la science. Que doit-il penser de la mort infligée miséricordieusement, par des médecins, aux victimes des destructions atomiques ? Peut-on abréger des souffrances épouvantables en mettant délibérément un terme à une vie humaine ? L'abbé périra à son tour dans un bombardement atomique – comme périront, à nouveau, la science et presque toute l'humanité. La seule note d'espoir – très ténue – réside en ces colonies que les hommes ont réussi à établir à grand'peine sur des terres lointaines : c'est vers l'une d'elles que s'envole un astronef, emportant quelques membres de l'Ordre… Le ton de la narration devient de plus en plus grave : il n'y a guère de place, dans les deux derniers épisodes, pour l'humour affectueux qui éclaircissait le premier. Et le récit ultime possède un caractère poignant, ses résonances sont plus sombres encore. Sans grandiloquence, sans abus d'effets faciles, Walter Miller réussit à suggérer l'inquiétude qui étreint ces derniers moines en face de la guerre, dont ils pressentent le caractère inexorable et final. La qualité suprême du récit – c'est aussi celle des principaux personnages – est sa profonde humanité : il n'y a guère de héros véritable en ces pages, on n'y trouve point de sermon non plus, nulle ironie faussement détachée, et pas davantage de grandiloquence. Les personnages ne peuvent pas être sommairement divisés en « bons » et « méchants » Walter Miller montre avec franchise que les savants détiennent une part de la Vérité, tout comme les religieux ; que les uns et les autres sont capables de se tromper, et que les meilleurs d'entre eux possèdent respectivement la Foi et une bonne foi honnête. Ce livre n'est pas un réquisitoire fatigué – et fatiguant – dénonçant, une nouvelle fois, les méfaits du savoir. Ce dernier n'est aucunement condamnable aux yeux de l'auteur. Ce qui est peut-être condamnable, et en tout cas digne de compassion, c'est le fond de la nature humaine, cette capacité du meilleur et du pire, cette étroitesse de vues et cet entêtement qui n'épargnent personne. Les conséquences de cette faiblesse peuvent être d'une gravité extrême, puisque Walter Miller prédit, en moins de 2000 ans, deux annihilations de la civilisation. Mais il ne faut pas en conclure qu'il est fondamentalement pessimiste : son livre est, de toute évidence, un avertissement. Il ne présente pas une solution infaillible, mais propose une combinaison de foi et de savoir, tempérée par de la compassion. Quelle que soit la religion du lecteur – ou son athéisme – il lui est difficile de demeurer insensible à une telle sincérité, comme il lui est difficile de ne pas éprouver de la sympathie à l'égard de Frère Francis ou de Thor Thaddeo. Ces personnages possèdent une vraisemblance qui les rend attachants ; le décor sur lequel ils évoluent paraît, lui aussi, réel : il ne nous est pas présenté au moyen de minutieuses énumérations ou d'artificiels raccourcis, mais le lecteur en prend conscience en fonction de l'activité des personnages. « Un cantique pour Leibowitz » est donc un excellent récit de science-fiction ; il combine avec un bonheur exceptionnel l'anticipation avec le problème religieux ; il présente, sans prétention mais avec sincérité, un message traduisant les préoccupations de l'auteur. Quel que soit l'angle selon lequel on l'aborde, c'est une sorte de chef-d'œuvre. Demètre IOAKIMIDIS |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |