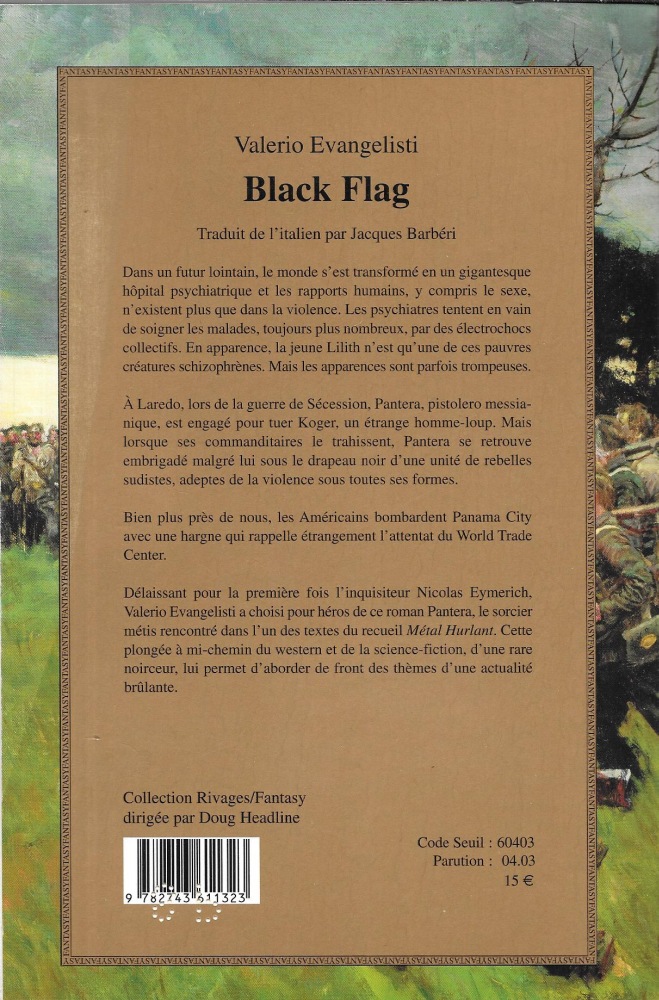|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Black Flag
Valerio EVANGELISTI Titre original : Black Flag, 2002 ISFDB Traduction de Jacques BARBÉRI Illustration de Howard PYLE RIVAGES (Paris, France), coll. Fantasy   Dépôt légal : mars 2003, Achevé d'imprimer : mars 2003 Première édition Roman, 180 pages, catégorie / prix : 15 € ISBN : 2-7436-1132-4 Format : 15,5 x 23,5 cm✅ Genre : Science-Fiction "Parution : 04.03" en 4ème de couverture. En librairie le 15-04-2003. Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
Dans un futur lointain, le monde s'est transformé en un gigantesque hôpital psychiatrique et les rapports humains, y compris le sexe, n'existent plus que dans la violence. Les psychiatres tentent en vain de soigner les malades, toujours plus nombreux, par des électrochocs collectifs. En apparence, la jeune Lilith n'est qu'une de ces pauvres créatures schizophrènes. Mais les apparences sont parfois trompeuses.
À Laredo, lors de la guerre de Sécession, Pantera, pistolero messianique, est engagé pour tuer Koger, un étrange homme-loup. Mais lorsque ses commanditaires le trahissent, Pantera se retrouve embrigadé malgré lui sous le drapeau noir d'une unité de rebelles sudistes, adeptes de la violence sous toutes ses formes.
Bien plus près de nous, les Américains bombardent Panama City avec une hargne qui rappelle étrangement l'attentat du World Trade Center.
Délaissant pour la première fois l'inquisiteur Nicolas Eymerich, Valerio Evangelisti a choisi pour héros de ce roman Pantera, le sorcier métis rencontré dans l'un des textes du recueil Métal Hurlant. Cette plongée à mi-chemin du western et de la science-fiction, d'une rare noirceur, lui permet d'aborder de front des thèmes d'une actualité brûlante.
Critiques
Autre antihéros mis en scène de manière récurrente par Valerio Evangelisti, quoique moins emblématique qu’Eymerich, Pantera est un Mexicain vivant aux états-Unis dans la seconde moitié du xixe siècle, à la fois pistolero et palero, autrement dit adepte du Palo Mayombe, une religion afro-américaine assez similaire au Vaudou qui lui donne une certaine compréhension des phénomènes surnaturels auxquels il sera confronté à plusieurs reprises. Personnage solitaire et mutique, capable d’accès de violence meurtriers, Pantera est le protagoniste d’une nouvelle et de deux romans. Il fait sa première apparition dans Métal Hurlant, recueil de quatre nouvelles proposant une thématique et une ligne chronologique communes, et qui doivent également beaucoup à l’amour de l’auteur pour le heavy metal des années 80, à commencer par leurs titres. La première d’entre elles, « Venom », pose les bornes temporelles du recueil : le xive siècle de Nicolas Eymerich, qui y tient bien entendu le rôle principal, et un futur non daté où s’affrontent à mort deux branches de l’humanité, dont l’une s’est radicalement transformée par l’utilisation d’un métal bio-actif. Comme dans ses romans, l’inquisiteur met en branle une série d’événements dont les conséquences ne se feront pleinement ressentir que plusieurs siècles plus tard. Les trois autres textes au sommaire se rattachent de manière plus ou moins explicite au même cycle. Dans un futur proche, « Sepultura » décrit le fonctionnement d’un pénitencier d’un genre nouveau, à São Paulo, tandis que « Metallica » voit s’affronter les forces armées d’extrémistes chrétiens et musulmans dans un quartier de la Nouvelle-Orléans. Comme souvent chez Evangelisti, ces deux nouvelles mêlent science-fiction et fantastique, pour aboutir à un résultat aussi original qu’intrigant. « Pantera », le récit qui introduit le personnage éponyme, propose lui aussi un mélange de rationnel et de surnaturel, mesmérisme et magnétisme d’un côté, rites magiques de l’autre, face à un danger qui quant à lui relève du pur fantastique : de gigantesques statues de cavaliers (les « Cow-boys from Hell », référence directe au plus célèbre album du groupe de metal Pantera) qui s’apprêtent à prendre vie pour réduire à néant un village texan. Mais avant de mener à bien la mission pour laquelle on l’a engagé, Pantera va avant tout chercher à découvrir ce qui a pu attirer une telle menace sur la population. Valerio Evangelisti s’amuse ici beaucoup avec les conventions du western, puisant davantage son inspiration dans les séries B transalpines que dans son modèle américain. On retrouve ensuite Pantera dans Black Flag, roman sur lequel plane en permanence l’ombre du 11 septembre. À la lecture du prologue, on pense assister à la chute des tours du World Trade Center, avant de comprendre que l’auteur décrit en fait le bombardement de Panama City par l’armée américaine, fin 1989. Une scène qui donne le ton et annonce le propos du roman. Comme chez Nicolas Eymerich, l’action de Black Flag se déroule principalement à deux époques : en 1865, durant les derniers mois de la Guerre de Sécession, alors que Pantera rejoint un régiment de Confédérés semant la terreur dans plusieurs états du sud, et en l’an 3000, sur une Terre surpeuplée, dont les habitants ne se différencient plus que par la psychopathologie dont ils sont atteints : Schizophrènes, Hystériques, Phobiques, etc., on est littéralement en présence d’un monde de fous, où l’on s’entre-tue à tours de bras. De manière assez confuse et pas vraiment convaincante, Valerio Evangelisti tente de tirer une évolution logique entre ces deux époques : d’un côté des militaires qui renoncent aux lois de la guerre pour laisser libre cours à leurs plus bas instincts, de l’autre ces trois cents milliards d’individus ne vivant que dans la recherche d’un plaisir immédiat né de la souffrance d’autrui. Le romancier semble nous dire que les États-Unis ont donné naissance à une folie meurtrière qui a fini (ou finira) par se propager à l’ensemble de la planète, mais la démonstration est trop décousue et trop peu argumentée pour emporter l’adhésion. Si l’on prend chaque partie individuellement, celle mettant en scène Pantera fonctionne plutôt bien, solidement ancrée dans son cadre historique. En revanche, celle située dans le futur est à ce point outrancière qu’elle frôle le ridicule à plusieurs reprises. Pantera tient son ultime rôle dans Anthracite, roman pourtant paru un an avant Black Flag en Italie, mais dont l’action se situe dix ans plus tard. Cette fois, Valerio Evangelisti met en sourdine les éléments fantastiques du personnage pour faire de lui le témoin de son époque. En 1875, Pantera se retrouve en Pennsylvanie, dans une ville dont les habitants vivent de l’extraction du charbon, dans des conditions abjectes, et où les luttes sociales s’apprêtent à prendre une tournure radicale. Ballotté entre les différentes factions qui s’opposent, Molly Maguires d’un côté, une organisation secrète qui défend les droits des travailleurs d’origine irlandaise, agence Pinkerton de l’autre, chargée de protéger l’ordre et surtout les avoirs de la bourgeoisie locale, Pantera va faire ce qu’il peut pour sauver sa peau sans y perdre son âme. De par sa personnalité insaisissable et la place qu’il occupe dans le récit, chaque camp espérant le voir rejoindre sa cause, Pantera évoque ici, plus que jamais, le personnage de l’Homme sans Nom qu’interprétait Clint Eastwood dans les westerns de Sergio Leone, le cynisme et l’opportunisme en moins. Il est avant tout l’élément extérieur, étranger, semblable en cela à l’auteur, qui occupe une place de choix pour rendre compte de ce moment d’histoire. Anthracite, s’il met un terme à la carrière de Pantera, inaugure surtout un nouveau cycle dans l’œuvre de l’auteur, et met en scène le début des luttes sociales du prolétariat américain, un travail qu’Evangelisti poursuivra de fort belle manière dans Nous ne sommes rien soyons tout ! et Briseurs de grève. Philippe BOULIER Black Flag, ce n'est pas tant le drapeau noir de l'anarchie que le nom d'un insecticide américain trucideur de cafards — du groupe punk hardcore qu'il inspira, où Henry Rollins fit ses premières armes, et dont les textes sont abondamment cités en tête de chapitres. Le livre est structuré un peu comme la plupart des romans de la série « Nicolas Eymerich » : nous suivons deux récits en alternance, un situé dans le passé et l'autre dans le futur. La moitié « futur » du livre est déjà connue du lecteur français de S-F, puisque parue sous forme d'une longue nouvelle dans l'anthologie Destination 3001 (Flammarion) : en l'an 3000, la Terre est devenue un gigantesque asile, surveillé depuis la Lune par une petite équipe de psychiatres qui envoient régulièrement des électrochocs pour empêcher les déments de trop s'entretuer. Quoique... La moitié « passé » explore un arrière-plan plus original : les derniers mois de la Guerre de Sécession, dans l'Ouest des USA (à l'époque : du Texas au Missouri). Pantera est un « palero », sorcier mexicain ; embauché pour liquider un loup-garou, il se retrouve en compagnie de celui-ci au sein d'une petite bande d'irréguliers sudistes qui se font remarquer par des exactions abominables. Finalement, seul le loup-garou est un personnage sympathique. Pantera refuse le contact humain et se comportera malgré tout comme le plus humain de la bande, ramenant aussi à l'humanité tous ceux qui avaient été exclus par le groupe sans pitié ni solidarité des soldats perdus : un Indien, une femme, et le loup-garou. On pense par certains côtés à l'attitude paradoxale d'Eymerich. Dans ce Texas ravagé par la guerre, ce sont des hommes en apparence normaux qui sont les pires loups — en ceci le message d'Evangelisti n'est pas original. Le futur « psychiatrique » est lui aussi intéressant, mais dégénère en une longue suite de violences qui n'ont pas le relief des relations entre les différentes sortes de maladie mentale des Clans de la Lune Alphane de Philip K. Dick. On est en présence d'un ouvrage mineur d'Evangelisti, qui souffre de plus d'une faiblesse structurelle : le seul lien entre les deux parties du livre est la suggestion qu'une combinaison d'expériences militaires secrètes et de psychiatrie anti-psychanalytique est en train de faire basculer le monde entier dans une violence irrémédiable. Le récit ne manque pas de scènes-choc, mais n'est pas à la hauteur en ce qui concerne la stimulation intellectuelle. Pascal J. THOMAS (lui écrire) Evangelisti sans Eymerich : la chose est assez rare pour être signalée d'entrée de jeu. Pourtant les aficionados du maître italien ne se trouveront pas en terrain inconnu. En effet, Black Flag met en scène des personnages qui, pour être moins célèbres que l'inquisiteur aragonais, sont néanmoins familiers : Pantera, pistolero et palero du texte éponyme (paru dans Métal Hurlant chez le même éditeur) et Lilith, « infirmière » pour le moins étonnante de Paradi, la délirante contribution de Valério Evangelisti à l'anthologie Destination 3001, concoctée par Robert Silverberg et le regretté Jacques Chambon. Les huit courts chapitres de cette nouvelle de « pure » SF sont ici repris en intégralité (seul le titre général a été modifié en Paradice, retrouvant ainsi celui de la version italienne) et enchâssés, selon une méthode éprouvée avec Eymerich, dans l'histoire du chaman métis. De plus, Black Flag est, peut-être plus encore que tout autre roman de l'auteur, un collage dans lequel deux trames temporelles (et même trois, si l'on tient compte de Porphyria), apparemment sans lien l'une avec l'autre, se succèdent en alternance pour finalement se répondre dans un curieux écho. Ainsi, les aventures de Pantera se déroulent-elles sur fond de Guerre de Sécession finissante, lorsque certains soldats sudistes plus ou moins démobilisés forment des unités incontrôlables et incontrôlées de « rebelles » (en fait, des bandes de desperados ultraviolents, emmenés par des barbares comme William Quantrill, Bloody Bill Anderson ou encore les frères Frank et Jesse James) qui, derrière un drapeau noir dont la signification politique leur échappe en grande partie, sèment la désolation et la mort dans une région prête à sombrer... dans l'anarchie. Pour l'ambiance, Evangelisti se souvient ici de son compatriote Sergio Leone, comme dans Pantera ; la trame de western, dans laquelle entre à nouveau un élément fantastique, est cependant moins classique que celle de la nouvelle d'origine. Parallèlement, sur une Terre de l'an 3000 peuplée de trois cents milliards de déments, seule la violence régit les rapports humains, et Lilith (lointaine descendante d'Alex, le protagoniste d'Orange Mécanique) en tire toutes les conséquences. Cette vision à faire frémir rendrait presque anodins ou inoffensifs les Clans de la Lune Alphane de Philip K. Dick, où, en effet, un semblant d'ordre (certes informé par les psychoses qui servent de discriminants sociaux) règne malgré tout. Le prologue et l'épilogue (Porphyria), situés avec malice lors du bombardement américain de Panama en 1989, fournissent le liant : une schizophrénie sanguinaire qui se résout en une forme étrange de lycanthropie, éclairée tour à tour par les propos des personnages secondaires. D'abord sous l'angle des légendes indiennes (Loup-Blanc, dit Vieille-Pipe), puis des théories pseudo-scientifiques du XIXe siècle (Bellegarrigue, charlatan français en goguette dans l'Ouest, presque digne des albums de Lucky Luke), puis de la psychiatrie contemporaine (Wippler et Woods à Panama) et future (Kurada), et enfin, bien entendu, de la dénonciation politique (l'auteur, toujours en filigrane). À ce sujet, les citations mises en exergue des chapitres (dont la plupart ne sont pas traduites, comme dans la version originale) indiquent une autre ambition, moins immédiate, de ce livre : à côté de l'inévitable Wilhelm Reich et des extraits du groupe punk « Black Flag » (dont les morceaux fournissent les titres des chapitres autour de Pantera, comme dans Metallica, in Galaxies n°l1), on y trouve en effet trois « références » à la convergence peu équivoque : Dunleavy, obscur journaleux du tabloïd NewYork Post (le 12.09.2001), Zodiac, sérial killer qui écrivait au San Francisco Chronicle (en 1969), et (en tête du prologue !) George W. Bush (le 20.09.2001) qui, faisant référence aux terroristes du 11 septembre, semble parler de lui-même... Black Flag est, contrairement à Cherudek (voir la critique de ce livre dans Galaxies n°19), servi par une bonne traduction, et qui aime la manière du père d'Eymerich entrera facilement dans ce texte atypique, même si le plaisir de lecture sera, pour certains, assombri par la débauche de violence teintée de sadisme qui suinte du livre. Toutes les obsessions de l'auteur semblent s'être données rendez-vous ici (de l'intrusion du métal dans le biologique à la fameuse fellation qui tue : voir Le Souffle des FARC in Eros Millenium). En faisant de la violence non seulement le thème mais aussi le personnage central du roman, jamais Evangelisti n'a paru aussi pessimiste. « Homo homini lupus » (à prendre ici au sens littéral) aurait pu servir de sous-titre à ce livre. Et le pire, c'est qu'il a peut-être raison, Valerio... Bruno DELLA CHIESA Le prologue s'ouvre sur un extrait du discours de G.W. Busch le 20 septembre 2001, suivi du récit d'une effroyable catastrophe où des victimes ensanglantées courent au milieu de ruines. « Comment en est-on arrivés là ? » se demande une survivante, dès la première page du roman. Sommes-nous à Manhattan, le 11 septembre 2001 ? Non, mais au Panama dans un futur proche et cette fois l'agresseur est américain, la cible est un hôpital où sont détenus des soldats américains atteints de porphyrie... En 1864, durant la Guerre de Sécession, le sorcier Pantera est chargé de tuer Koger, un homme-loup, mais son commanditaire se retourne contre lui et il doit se réfugier au sein d'une bande de « bushwhackers », des irréguliers sudistes. Ceux-ci se conduisent comme des hors-la-loi, sous l'influence de Frank et Jesse James, mais aussi d'un « anarcho-individualiste » français... A la veille de l'an 3000, le monde n'est plus qu'une jungle urbaine nommée Paradice, un vaste asile psychiatrique à l'échelle d'une planète, plongé dans un perpétuel brouillard où errent et se déchirent trois cents milliards de psychotiques : les Schizos, au comportement de prédateurs, les Phobiques, les Hystériques, les Possédés... Leurs vies sont rythmées par d'étranges éclairs et par une violence inouïe qui se déclenche au moindre prétexte, tandis que leurs docteurs s'abritent sur la Lune... Si Eymerich est absent de ce roman, nous sommes toujours dans son univers : les événements décrits s'intègrent à cette vaste Histoire du passé et du futur qu'Evangelisti construit sous nos yeux ébahis. Pantera — déjà rencontré dans une nouvelle de l'anthologie Métal Hurlant — y occupe le premier rôle, à la place de l'infâme inquisiteur. C'est un « héros » à peine plus sympathique en surface, mais qui dissimule tout de même une compassion dont Eymerich est totalement dépourvu. La construction du roman est similaire à celle des précédents ouvrages. Trois fils temporel s'entremêlent et se répondent, pour explorer sous divers angles une improbable théorie scientifique. Cette fois, il s'agit de « charger en énergie le métal qui est en nous », pour « nous faire redevenir féroces et prédateurs » (p.95). Comme à son habitude, Evangelisti mêle étroitement l'Histoire, la SF et le fantastique — à travers le thème du garou — de manière pleinement convaincante, même lorsqu'il met en application les hypothèses les plus délirantes. A l'évidence, le thème majeur du roman est la violence, le plaisir qu'elle procure, la liberté qu'elle représente, la fascination qu'elle exerce, les alibis qu'elle peut nécessiter. Plusieurs des personnages en font une véritable apologie : « Sans violence, il ne pouvait y avoir de contact humain. Quelle sorte de société pouvait ignorer que la mort et la douleur étaient des vecteurs de communication ? » (p.126) Ils rêvent d'un homme libre et impitoyable, associant intelligence et dégoût de la morale... Pourquoi cette violence ? Est-elle due à un « accroissement insensé de la densité démographique » (p.106), « avec des individus capables de tout pour défendre leur espace vital » (p.131) ? Ou à un « facteur biologique non encore identifié » (p.106) ? A ce fameux métal qui fait de nous des monstres en puissance ? La morale de l'histoire ? Peut-être : « Quand tout un système de vie occulte la compréhension de son prochain, l'agressivité devient une norme. » (p.169) Une phrase que pourraient méditer ensemble les terroristes islamistes et monsieur Busch. Encore une fois, on doit rendre hommage au talent de Valerio Evangelisti, à la profonde originalité de son œuvre, à la puissance et à l'intelligence de son propos... Magistral ! Pascal PATOZ (lui écrire) |
| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112059 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |