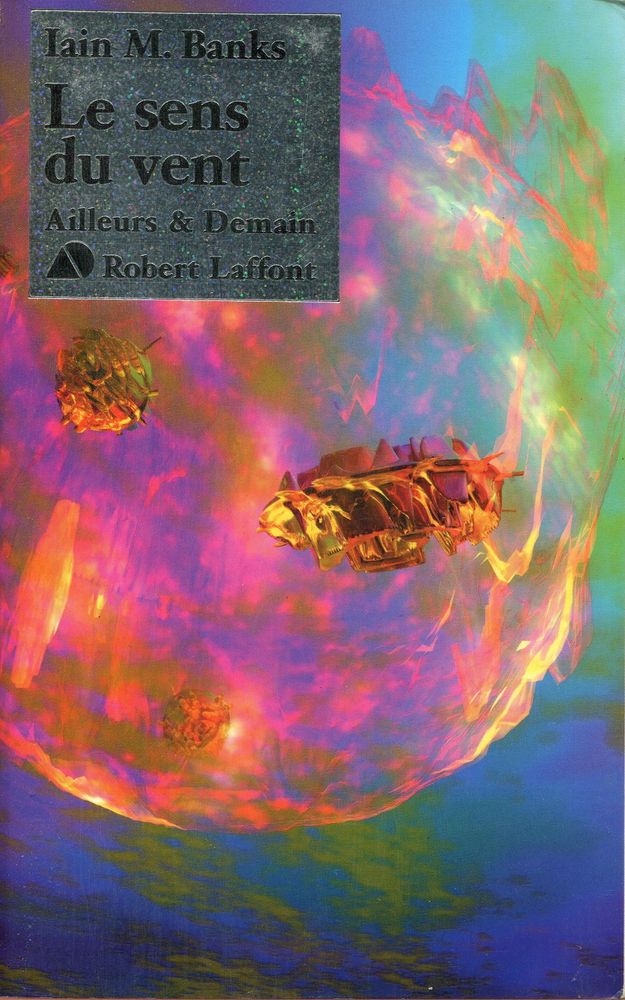|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Sens du vent
Iain M. BANKS Titre original : Look to Windward, 2000 Première parution : Orbit, 2000 ISFDB Cycle : Culture (Cycle de la)  vol. 7 vol. 7  Traduction de Bernard SIGAUD Illustration de Jackie PATERNOSTER Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Date de parution : septembre 2002 Dépôt légal : septembre 2002, Achevé d'imprimer : septembre 2002 Première édition Roman, 408 pages, catégorie / prix : 22,70 € ISBN : 2-221-09552-9 Format : 13,5 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
Sur l'orbitale Masaq' s'est réfugié Ziller, un compositeur chelgrien dont le peuple a été récemment vaincu par la Culture, cette société galactique tolérante, anarchiste, cynique et par-dessus tout hédoniste.
Ziller, le plus fameux musicien de son temps, a fui les mondes chelgriens pour des raisons politiques : il ne supportait plus le système de castes de sa patrie, raison même du conflit entre Chelgria et la Culture. Il compose, à la demande de Masaq', un opéra symphonique en souvenir d'une guerre ancienne entre la Culture et les Idirans durant laquelle ces derniers ont fait exploser des étoiles huit cents ans auparavant.
La symphonie de Ziller doit être jouée au moment précis où la lumière fulgurante de ces nova atteindra Masaq'.
Un émissaire chelgrien, Quilan, est envoyé sur l'orbitale pour tenter de convaincre Ziller de revenir dans sa patrie. C'est la partie officielle de sa mission.
L'autre est plus ténébreuse.
Comme toujours avec Iain M. Banks, le plus brillant des auteurs anglais de sa génération, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent et il convient de prendre le sens du vent.
Un nouveau volet du cycle de la Culture, qui a renouvelé la science-fiction.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Dominique MARTEL & Alain SPRAUEL, Bibliographie de Iain (M.) Banks, pages 397 à 398, bibliographie
Critiques
C'est de l'excès permanent que procède le charme de la « Culture ». Autant la civilisation galactique que la série de livres qui en détaille les avatars et les avanies, car Banks adapte la forme au fond, jouant à l'occasion les Ponson du Terrail modernes. « Jouant » est le mot-clé : Banks tient la langue anglaise à sa merci, la malmène et la promène, aussi à l'aise dans l'action démesurée que dans les conversations de cocktail oiseuses et hachées qui sont l'activité principale de tant de citoyens de la « Culture ». Pour lui remettre les pieds sur terre, pour que les romans aient quelque chose à raconter, il faut bien que la « Culture » se confronte à des civilisations moins avancées, moins bienveillantes. Elle ne court jamais le risque de perdre mais peut infliger à ses adversaires des défaites honteuses, dont les conséquences mettent à mal ses principes même : démocratie et respect des créatures douées de raison. Prenez les Chelgriens : leur société commençait à se débarrasser de son archaïque et révoltant système de castes. L'interventionnisme sans finesse de la « Culture » a précipité une guerre civile. Quatre milliards de morts, une société profondément meurtrie, un quarteron de fanatiques ne rêvant que de revanche. Et le compositeur Ziller, peut-être le plus grand artiste de la civilisation chelgrienne, qui avait choisi de s'exiler sur une Orbitale de la « Culture », n'a aucune envie de revoir sa planète natale, ni non plus Quilan, l'émissaire qu'elle lui envoie... Ziller et Quilan fournissent un rude et permanent contrepoint à l'hédonisme évaporé de la « Culture » ; le premier parce qu'il remet sans cesse en cause ses activités de loisir extravagantes (excellent prétexte saisi par Banks pour nous les décrire en détail et augmenter d'autant la longueur du livre) ; le deuxième parce qu'il impute à la « Culture » la responsabilité de la mort de son épouse, seul amour de sa vie. Sans qui il perd toute raison de vivre, ce qui fait de lui le parfait candidat pour une mission-suicide clandestine. Parce qu'ils souffrent, parce qu'ils se consacrent à des idées plus grandes qu'eux-mêmes, Ziller et Quilan sont les deux personnages les plus attachants du roman (et peu importe qu'ils ressemblent à des tigres dotés de quelques membres supplémentaires). Et pourtant, face aux machines surpuissantes de la « Culture », le résultat de leurs efforts est insignifiant... La leçon n'est pas nouvelle : c'était déjà celle de Une Forme de guerre, dont le titre original (Consider Phlebas) voisine avec celui du présent ouvrage (Look to Winward) dans le poème de T. S. Eliot dont ils sont tous les deux tirés. On retrouve d'ailleurs ici, en arrière-plan historique, la guerre Idirane. De même qu'on retrouve une poignée d'éléments glanés dans d'autres romans de la série, comme la construction en flash-backs analogue à celle de L'Usage des armes. Et bien sûr, une débauche de paysages et d'artefacts. Mais pas de voitures automobiles, en dehors des camions militaires Chelgriens : en bonne utopie anarcho-communiste, la « Culture » propose une abondance de transports collectifs. A cela près, pourtant, elle n'a jamais autant ressemblé aux Etats-Unis : un immense jardin pour des citoyens gâtés, contents d'eux-mêmes et de leurs grands principes, défendus sur leurs frontières par un dispositif militaire (les Circonstances Spéciales) qui se montre teigneux. Jusqu'à la description de la guerre Idirane, et sa conclusion par la Bataille des Novae Jumelles, qui évoque immanquablement la guerre du Pacifique entre Américains et Japonais. Sans même parler de la perspicacité dont fait preuve le livre en matière de relations internationales : un an après sa sortie en 2000, des fanatiques religieux ulcérés par les contradictions internes de leur propre société commettaient aux USA de spectaculaires attentats-suicides. Dead Air, dernier livre en date de Iain Banks, l'alter-ego de littérature générale de Iain M. Banks, tourne autour du 11 septembre 2001. En attendant « l'air mort », vous pouvez toujours vous plonger dans Le Sens du vent, c'est plus léger, Banks y exerce sa verve et son humour cruel, même s'il ne renouvelle pas la « Culture ». Pascal J. THOMAS (lui écrire) On se souvient que pour le premier volume du cycle de la Culture, paru en 1987 et traduit en 1993 seulement sous le titre Une forme de guerre, l'éditeur avait renoncé au titre original Consider Phlebas, extrait d'une citation du poète anglais T.S. Eliot. Pour le cinquième volume du cycle, paru depuis deux ans outre-Manche, la traduction a suivi cette fois la lettre du titre original, Look to Windward, extrait de la même strophe du poème d'Eliot, et qui donne au roman une grande profondeur méditative. Voilà qui peut raviver le regret de tout ce qui se perd, même dans les meilleures traductions possibles (et celle de Sigaud n'est pas mauvaise), des montages littéraires sophistiqués dont certains auteurs font une marque de fabrique. Iain M. Banks est de ceux-là (on souhaite à ceux qui n'ont pas encore lu L'Usage des armes le même plaisir qu'on a pris à son prodigieux échafaudage narratif !), et l'écho qu'il fait résonner entre les deux opus extrêmes de sa construction la plus fameuse, la Culture, se devait d'être rappelé. Après le ballet spatial des I.A. (ou « Mentaux » chez Banks) de Excession, Le Sens du vent renoue avec une figure de guerrier malheureux, comme Horza d'Une forme de guerre ou Zakalwe de L'Usage des armes. Et là encore, le récit épouse les trous de mémoire du soldat Quilan. Au fur et à mesure que progresse l'histoire (délicieusement compliquée, accumulant intrigues et contre-intrigues, comme il sied à tout bon space opera), le personnage (ré)apprend ce qu'il a à faire en même temps que le lecteur découvre ce qui se trame à travers lui : belle manière de compliquer à plaisir l'accélération du suspense final. Peut-être est-ce pour cette raison qu'on éprouve une certaine déception lors du dénouement : lire Iain M. Banks, c'est aussi attendre la résolution spectaculaire d'une histoire labyrinthique ; la fin du Sens du vent ne l'est pas tant que ça, puisqu'un dialogue entre les deux personnages-clés, posément explicatif, vient y répondre à toutes les questions qu'on se pose (ou quasi : il reste juste assez d'incertitude pour écrire une autre aventure de la Culture...) Certes, pour ce qui est du spectacle, on en aura eu : le cœur apparent de l'intrigue est la préparation d'une célébration musicale dantesque, en mémoire d'une guerre qui s'est déroulée 800 ans plus tôt (précisément celle qui est racontée dans Une forme de guerre). Car 800 ans, c'est tout juste le temps qu'il a fallu pour que la lueur des deux explosions finales de cette ancienne guerre arrive à l'orbitale Masaq'. Ziller, un musicien chelgrien surdoué, est chargé de créer la symphonie qui sera jouée le soir même de l'arrivée de cette lumière ; mais il est lui-même réfugié sur Masaq' après une guerre civile chelgrienne plus récente, où la Culture a joué un rôle très ambigu. D'où certaines intrigues, voire certaines vengeances... qui pourraient bien se concrétiser le soir du concert. Une sorte de cache-cache diplomatique entre Quilan, émissaire de Chel, et Ziller, conduit le récit dans les méandres grandioses de l'orbitale : de la symphonie ou des paysages du Désert des Pylônes, de la ville Ossuliera ou des chutes du Grand Fleuve de Masaq', on ne sait finalement ce qui propose le spectacle le plus éblouissant. Cinq digressions apparentes dans un étrange espace extérieur à l'orbitale, l'aérosphère Oskendari VII, confirment le talent fascinant d'un romancier au sommet de son art descriptif. On n'en est que plus dubitatif devant les passages assez lourdement didactiques du chapitre 6, par exemple, qui expliquent les tenants et aboutissants de la guerre chelgrienne, le rôle des I.A. et celui des « Sublimés » ; ou bien devant les méditations sur la mort du Mental Central de Masaq'. Certes, il y a de longs passages réflexifs dans à peu près tous les romans du cycle de la Culture, souvent sous forme de dialogue, où l'on parle de l'utopie, de la guerre, du bien et du mal, etc. : cela fait partie du charme des livres de Banks. Mais ce charme opère un peu moins brillamment dans ce roman-ci. Parce qu'il y en a trop ? Ou peut-être parce que leur ton est rendu d'autant plus pesant qu'il voisine avec des dialogues plus vifs, plus drôles, notamment ceux qui se déroulent (d'une très ingénieuse manière) entre Quilan et son mentor Huyler. Bref, voilà un bon roman, entraînant, mais qui laisse le lecteur un peu sur sa faim ; toutefois, c'est à cause d'une exigence que Iain M. Banks a lui-même fait naître auparavant. Et c'est encore, à mes yeux, le meilleur compliment qu'on puisse faire à son œuvre. Irène LANGLET Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Francis Valéry : Passeport pour les étoiles (liste parue en 2000) pour la série : Culture (Cycle de la) |
| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |