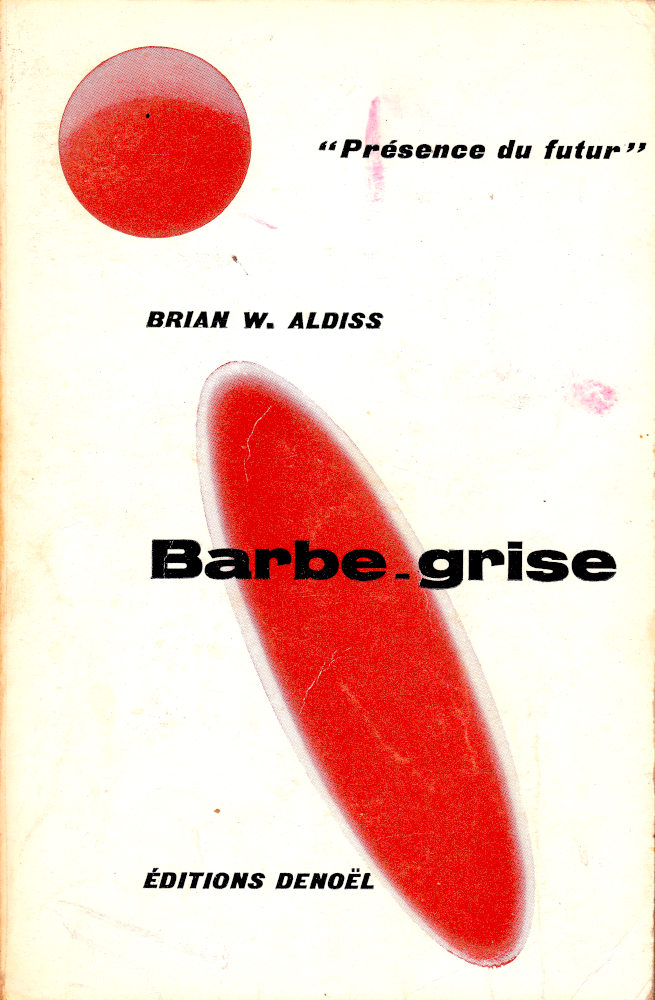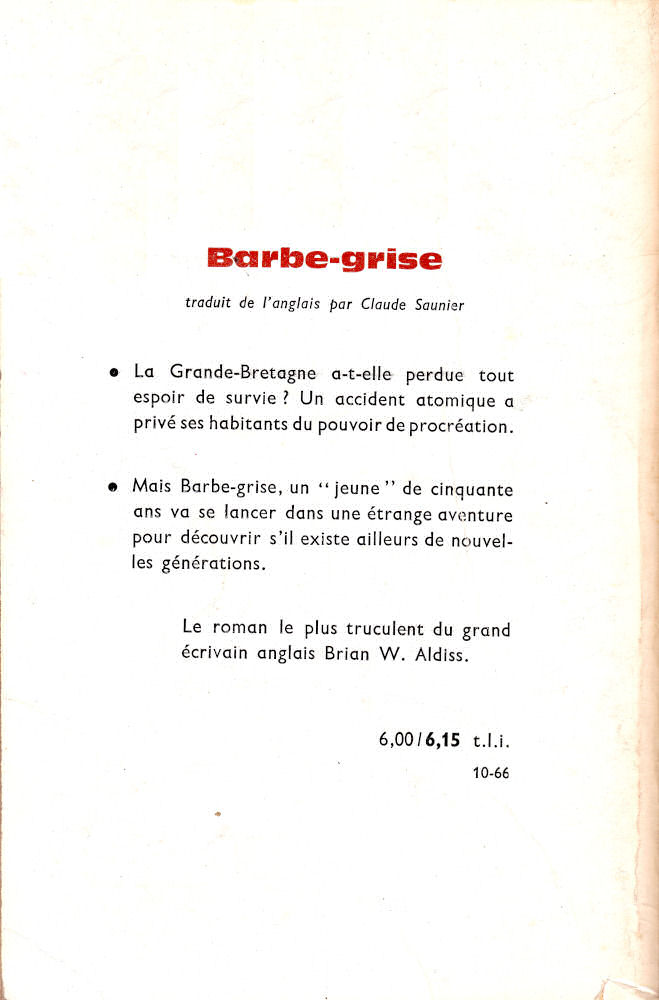|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Barbe-Grise
Brian ALDISS Titre original : Greybeard, 1964 Première parution : New York, USA : Harcourt, Brace & World, 1964 ISFDB Traduction de Claude SAUNIER DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 95 n° 95  Dépôt légal : 4ème trimestre 1966, Achevé d'imprimer : 20 septembre 1966 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : 6,15 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
• La Grande-Bretagne a-t-elle perdue tout espoir de survie ? Un accident atomique a privé ses habitants du pouvoir de procréation.
• Mais Barbe-grise, un « jeune » de cinquante ans va se lancer dans une étrange aventure pour découvrir s'il existe ailleurs de nouvelles générations.
Le roman le plus truculent du grand écrivain anglais Brian W. Aldiss.
Critiques
Ce livre porte le numéro 95 dans la collection dont il fait partie. La science-fiction anglo-saxonne se porte beaucoup mieux que ne le suggéreraient les ouvrages récents traduits dans cette collection Depuis Les seigneurs des sphères (numéro 87), la seule nouveauté américaine de la collection a été en effet L’ordinateur désordonné (numéro 93), roman qui ne donne pas une idée exacte du talent de son auteur. Keith Laumer. Ce n’est pas la première fois que la qualité moyenne des ouvrages publiés en un temps donné dans « Présence du Futur » inspire quelque inquiétude. Certes il faut équitablement souligner que l’on n’est pas du tout revenu aux abîmes des numéros 35 à 40 (auriez-vous oublié La république lunatique, numéro 35 ? Les faits d’Eiffel, numéro 37 ? Le règne du bonheur, numéro 40 ? Si oui, vous ne connaissez pas votre chance). La qualité du numéro 36 (Demain moisson d’étoiles, recueil de nouvelles d’Arthur Clarke) était largement contrebalancée par la médiocrité virulente de tels navets. Il serait temps, semble-t-il, de songer à remonter la pente (ce à quoi ne contribue guère cette Barbe-grise) et à faire une place à quelques-uns des auteurs que les lecteurs français connaissent encore mal : Roger Zelazny, Frank Herbert (aucun rapport avec Herbert W. Franke), H. Beam Piper, James White, d’autres encore ; si l’on hésite devant la nouveauté de tels noms, n’y a-t-il pas encore des recueils de nouvelles de Sturgeon, de van Vogt, de Sheckley ou de Chad Oliver, par exemple, auxquels on pourrait faire une place dans la collection ? Au lieu de cela, on nous offre un roman qui, avec The dark light-years (encore inédit en français, mais cela durera-t-il ?) représente indubitablement le niveau le plus bas atteint par un auteur habituellement très estimable. Sur la quatrième page de la couverture, on trouve résumé le fond devant lequel se déroule l’action : La Grande-Bretagne a-t-elle perdue (sic) tout espoir de survie ? Un accident atomique a privé ses habitants du pouvoir de procréation. On se trouve donc en présence d’un nouveau cataclysme à l’anglaise. L’attitude choisie par Aldiss diffère nettement de celle de ses compatriotes John Wyndham et James Ballard. Là où Wyndham présente les événements d’un point de vue assez détaché, et imprégné tout de même d’un optimisme qui se traduit généralement par un dénouement heureux, là où Ballard se fait le chantre convaincu de l’inefficience contemplative, Aldiss choisit de jouer au témoin objectif mais compatissant. L’objectivité lui réussit mieux, tout compte fait, que la compassion. Au XXIe siècle, donc, l’humanité (et pas seulement la Grande-Bretagne) est menacée d’épidémies, dans un chaos social à peu près complet. Les humains sont devenus stériles, apparemment (guerre et retombées nucléaires, la science mal employée, nous ne sommes que des apprentis sorciers, etc., etc.), et ils sont menacés par les invasions d’animaux retournés à l’état sauvage L’adverbe apparemment, quelques lignes plus haut, se justifie par la fin heureuse que l’auteur a cru devoir ajouter, malgré tout, à son roman : il révèle, en effet, à quelques pages de la fin, que la stérilité n’était pas universelle, et que des parents ont réussi à cacher et à nourrir leurs enfants, en marge des bouleversements sociaux. On se demande jusqu’à quel point une telle fin est vraisemblable, compte tenu de ce que l’auteur a dit auparavant. Dans un monde où les rares enfants vivants représentent, même mutilés, une sorte de miracle, et sont l’objet d’une vraie vénération, serait-il vraiment possible de les garder presque tous en cachette ? Le roman se développe sur deux plans : les retours en arrière, et l’action proprement dite. Le protagoniste de celle-ci est un quinquagénaire surnommé Barbe-grise (au fait, ce doit être là un surnom assez répandu dans une société de vieillards). Dans les retours en arrière, Brian Aldiss a apparemment tenté de refaire ce que Wells avait fait dans la Guerre des mondes : évoquer un cataclysme, un bouleversement universel, à travers ses conséquences dans la vie d’un individu. Mais le lecteur ne prend qu’un intérêt très modéré aux aventures de jeunesse de Barbe-grise, puisqu’il connaît, dès le départ, l’aboutissement des efforts politiques, scientifiques et militaires auxquels le protagoniste apporte sa contribution. Brian Aldiss a-t-il cherché le pathétique ? Il semble avoir réussi à le trouver, avec cependant une note de grotesque dans laquelle un élément grand-guignolesque amène un comique involontaire. Comment prendre au sérieux, par exemple, un passage tel que celui-ci (page 139) : « À dix-neuf ans, après la mort de ma mère, et comme une sorte de compensation, j’imagine, je me fiançai à une jeune fille nommée Peggy Lynn. Elle n’était pas en bonne santé et elle avait perdu tous ses cheveux, mais le l’aimais. Nous voulions donc nous marier. Nous subîmes naturellement un examen médical et l’on nous dit que nous avions été stérilisés pour la vie, comme tout le monde. Cela a mis fin à notre petite idylle. » Pour des raisons de longueur apparemment, on a supprimé, dans la version française, le dernier retour en arrière (il se placerait entre les chapitres VI et VII), lequel raconte l’enfance de Barbe-grise. Après tout, le roman ne s’en porte pas plus mal – ni mieux non plus, d’ailleurs. Cette Angleterre post-atomique laisse le lecteur indifférent : moins par l’abondance d’opportunistes et de fanatiques que l’on y rencontre (après tout, leur survivance est plausible dans un monde en désordre) que par le désaccord entre l’aspect physique et les actes des protagonistes. Ceux-ci font songer à des adolescents grimés (assez mal, d’ailleurs) en vieillards pour répondre aux exigences d’un scénario maladroit. Cette barbe grise donne en somme l’impression d’être fausse, et cela est d’autant plus regrettable que l’auteur s’est manifestement donné beaucoup de peine en préparant la cohésion et la vraisemblance de son décor. La traduction, par Claude Saunier, est scrupuleuse et attentive. L’effort est disproportionné à la valeur du livre, cependant. On peut en dire autant de l’effort du lecteur qui parvient à terminer ce roman. Demètre IOAKIMIDIS |
| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |