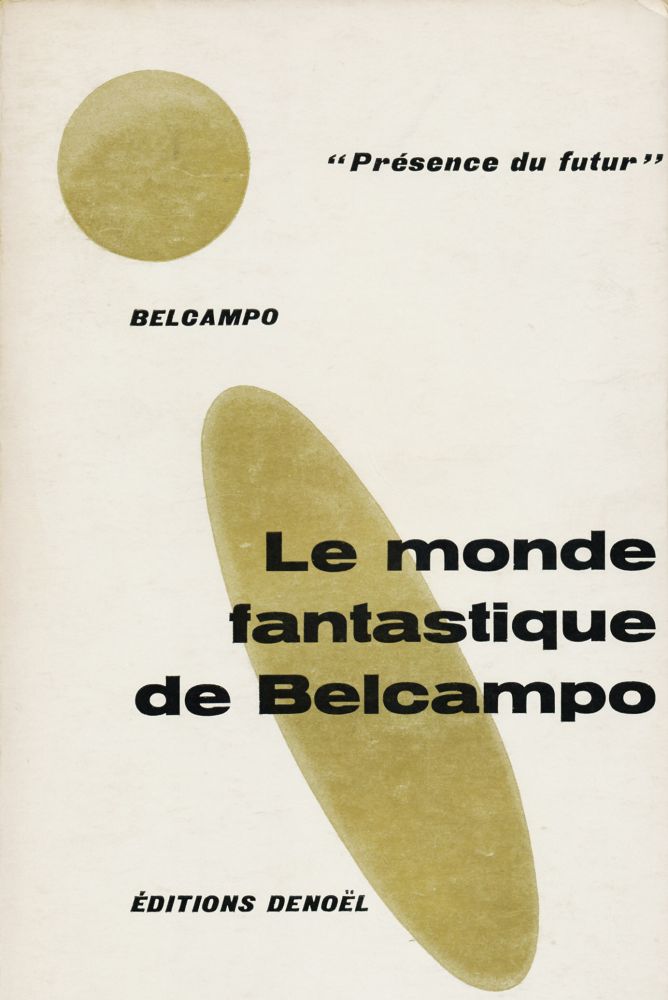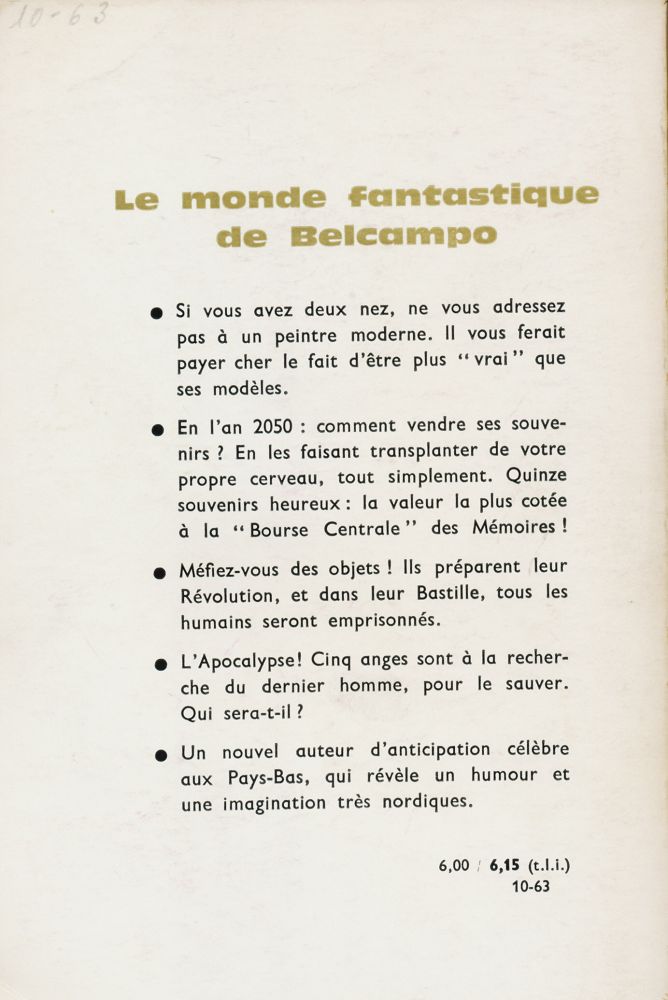|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Monde fantastique de Belcampo
BELCAMPO Titre original : De fantasieën van Belcampo, 1958 Première parution : Amsterdam, Pays-Bas : Edition Kosmos ISFDB Traduction de Maria Pia AMSBERG DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 67 n° 67  Dépôt légal : 3ème trimestre 1963, Achevé d'imprimer : 20 septembre 1963 Première édition Recueil de nouvelles, 224 pages, catégorie / prix : 6,15 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
• Si vous avez deux nez, ne vous adressez pas à un peintre moderne. Il vous ferait payer cher le fait d'être plus « vrai » que ses modèles.
• En l'an 2050 : comment vendre ses souvenirs ? En les faisant transplanter de votre propre cerveau, tout simplement. Quinze souvenirs heureux : la valeur la plus cotée à la « Bourse Centrale » des Mémoires !
• Méfiez-vous des objets ! Ils préparent leur Révolution, et dans leur Bastille, tous les humains seront emprisonnés.
• L'Apocalypse ! Cinq anges sont à la recherche du dernier homme, pour le sauver. Qui sera-t-il ?
• Un nouvel auteur d'anticipation célèbre aux Pays-Bas, qui révèle un humour et une imagination très nordiques.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - (non mentionné), Note de l'éditeur, pages 9 à 9, notes 2 - Les Choses au pouvoir (De dingen de baas), pages 11 à 68, nouvelle, trad. Maria Pia AMSBERG 3 - Le Désir acharné (Het hardnekkige verlangen), pages 69 à 107, nouvelle, trad. Maria Pia AMSBERG 4 - Le Récit d'Oosterhuis (Het verhal van Oosterhuis), pages 109 à 148, nouvelle, trad. Maria Pia AMSBERG 5 - Les Montagnes russes (De achtbaan), pages 149 à 178, nouvelle, trad. Maria Pia AMSBERG 6 - Le Grand événement (Het grote gebeuren), pages 179 à 218, nouvelle, trad. Maria Pia AMSBERG
Critiques
Curieuse impression que celle laissée par ce livre. En fait, on le referme en étant déçu. Les dix ou douze titres précédents de la collection comprenaient plusieurs ouvrages remarquables, dont Les sirènes de Titan, Les croisés du cosmos, Fantômes et Farfafouilles, Tous les pièges de la terre. Le lecteur pour lequel ces quatre livres étaient, à des titres divers, de bons exemples de science-fiction ne trouvera pas son compte chez Belcampo. Mais on ne peut s’empêcher de penser que ce Monde fantastique eût été moins décevant si on l’avait découvert dans une autre collection, dans une collection qui n’eût pas été consacrée au fantastique et à la science-fiction. La présentation joue son rôle dans l’impression qu’on en retire, par les promesses implicites qui s’y trouvent contenues. Telle qu’elle se montre dans les cinq nouvelles de ce recueil, l’imagination de Belcampo ne paraît pas se mouvoir à l’aise dans l’insolite. Une note de l’éditeur, placée au commencement du volume, ainsi que la prière d’insérer, permettent d’apprendre que Belcampo est le pseudonyme de Hermann Schonfeld Wichers, écrivain néerlandais né en 1902 ; que ledit Wichers a roulé sa bosse dans pas mal de professions et de pays avant de parvenir à son état actuel : médecin-psychiatre des étudiants de l’Université de Croningue, et écrivain… Il y a lieu de saluer son apparition au catalogue de « Présence du Futur », puisqu’il ajoute une note supplémentaire au registre international de la collection. On a, paraît-il, comparé Belcampo à Hieronymus Bosch. Ce rapprochement ne peut que surprendre, à la lumière du présent recueil. Il n’y a aucun rapport entre l’imagination que révèlent ces pages et celle qui anime Le Jardin des délices, le Jugement dernier ou les Tentations de Saint-Antoine, si ce n’est que Belcampo, compatriote de Bosch, tente lui aussi de parler du jugement dernier. Mais il n’a rien du souffle du grand peintre, et surtout pas son sens du fantastique, où le délire et l’abondance servent à désorienter, à effarer puis à emporter le sens critique du spectateur. En réalité, l’imagination de Belcampo fonctionne selon quatre phases – dans les récits de ce livre tout au moins – et Le grand événement, où il est précisément question du jugement dernier, offre une illustration particulièrement claire de ce fonctionnement. La première phase est concrétisée par l’apparition d’un événement insolite. Dans cette descente de démons et d’anges qui, dans le village de Rijsssen, vont faire leur travail de jugement dernier, l’insolite est évidemment assez clair par lui-même. Là-dessus se greffe une trouvaille affabulative destinée à lancer ou relancer l’action : ici, c’est le narrateur qui a l’idée – remarquablement brillante, il faut en convenir – de revêtir un costume de démon utilisé naguère au carnaval, ce qui lui permet de circuler en toute immunité à travers anges et démons. Notons au passage que les relations entre ceux-là et ceux-ci, pour être froides, n’en sont pas moins empreintes d’une sorte de courtoisie distante. Jusqu’ici, le mécanisme utilisé par Belcampo ne se distingue guère de celui dont usent de nombreux auteurs spécialisés dans l’insolite ; simplement, il est moins prodigue d’idées fantastiques ou scientifiques que ses confrères anglo-saxons. En troisième lieu, Belcampo fait son métier d’écrivain : c’est-à-dire qu’il conduit le récit vers sa conclusion, mais c’est là probablement que se manifeste le plus nettement son manque d’assurance dans le fantastique ou le merveilleux scientifique : il n’y a guère, dans ce développement, de coups de théâtre, d’idées ou d’allusions qui obligent le lecteur à reprendre conscience du fait que l’auteur se meut dans un univers qui n’est pas celui de notre existence quotidienne. Quatrièmement, enfin, l’auteur dénoue son intrigue par une conclusion anodine et souriante, dont l’arbitraire est une caractéristique majeure : il ne s’agit pas d’une fin rendue inévitable par ce qui a précédé, mais bien de ce que les anglo-saxons appellent une happy end. Cette expression de fin heureuse implique souvent une nuance péjorative, qu’on ne saurait rejeter dans le cas présent. Pour en revenir au jugement dernier ou Grand événement, le narrateur observe anges et démons au travail, sauve sa maîtresse de l’enfer, et s’aperçoit enfin qu’il est, lui aussi, destiné au Paradis. On peut s’en réjouir pour lui, mais avec un sourire las. Ce même schéma est décelé sans peine dans les autres récits du livre. On peut se borner à le retracer dans Le désir acharné par exemple. Une jeune fille possède deux nez. Elle tient à savoir si c’est là beauté ou laideur. Elle interroge dans ce but un certain nombre d’individus variés (théologien, biologiste, etc.) qui, comme par hasard, se retranchent derrière des phrases vides et pompeuses. Elle finit par se faire aimer d’un écrivain. Là aussi, on est bien content pour elle, sans toutefois que le récit ait rendu cette conclusion le moins du monde nécessaire. Quant aux sujets des autres histoires, ils se rattachent également à la science-fiction, en ce sens qu’ils ont à leur origine une idée scientifique ou pseudo-scientifique, mais leur développement manque en général d’imagination. Correcte, voire parfois un peu amusante, la narration de Belcampo est celle d’un travailleur appliqué qui s’essaie à un genre dont il n’a apparemment pas une idée bien claire. Ces sujets, les voici. Les choses au pouvoir est l’histoire d’une révolte, celle des objets inanimés : de la porte de la maison au slip du narrateur, les « choses » refusent de rester au service de l’homme. Mais le sujet est vaste, difficile à délimiter, délicat à traiter dans le vrai ton de la science-fiction (qui est celui choisi par l’auteur, puisqu’il juge nécessaire d’intercaler quelques explications pseudo-scientifiques dans son récit). Un Asimov ou un Heinlein eût cherché à faire apparaître la faiblesse de cette révolte, la brèche par laquelle l’homme regagnerait son pouvoir ; un Wyndham eût décrit avec réalisme la difficile situation nouvelle de l’humanité ; un Tenn eût sarcastiquement dépeint la dégénérescence finale de notre espèce. Que fait Belcampo ? Il réussit à placer ses personnages dans un climat de farce – la gravité de leur situation ne peut à aucun moment être prise au sérieux – et les tire d’affaire par l’intervention arbitraire et obligeante de la Terre (Sol III, notre bonne planète), qui impose son bon vouloir pour que tout rentre dans l’ordre. Le récit d’Oosterhuis est une variation sur le thème que James Hilton et Daphné Du Maurier avaient traité dans Lost horizon et Monte verità respectivement : celui d’une communauté qui vit dans un bonheur apparent, sans contact avec le reste du monde. Les montagnes russes, enfin, est un récit contenant une idée qui appartient, plus nettement que celles des autres récits, à la science-fiction contemporaine : par une technique dérivant de celle du lavage de cerveaux, les hommes du vingt-et-unième siècle sont à même de se débarrasser de leurs souvenirs, et de se faire de l’argent en les vendant. Un écrivain ayant la pratique de la science-fiction eût profité de l’occasion pour dépeindre une société bouleversée par une telle pratique. Évidemment, cela eût exigé un effort de construction et d’exploration méthodique des implications d’une telle pratique. Belcampo n’a pas voulu ou pas pu faire un tel effort ; il se contente d’un sentimentalisme à l’eau de rose en montrant un couple qui passe en revue les souvenirs qu’il est sur le point de vendre. Pour autant que l’on en puisse juger à travers la bonne version française de Maria Pia Amsberg, le style de Belcampo possède de la clarté et de la correction. Le métier de l’écrivain ne parait pas contestable, mais ses dons pour le fantastique et l’insolite n’éclatent guère à la lecture de ces récits. Comme nombre de ses confrères de divers pays, Belcampo montre clairement que ne s’improvise pas auteur de science-fiction qui veut. Demètre IOAKIMIDIS Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)
Grote gebeuren (Het) , 1975, Jaap Drupsteen (d'après le texte : Le Grand événement), (Telefilm) |
| Dans la nooSFere : 87298 livres, 112239 photos de couvertures, 83734 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |