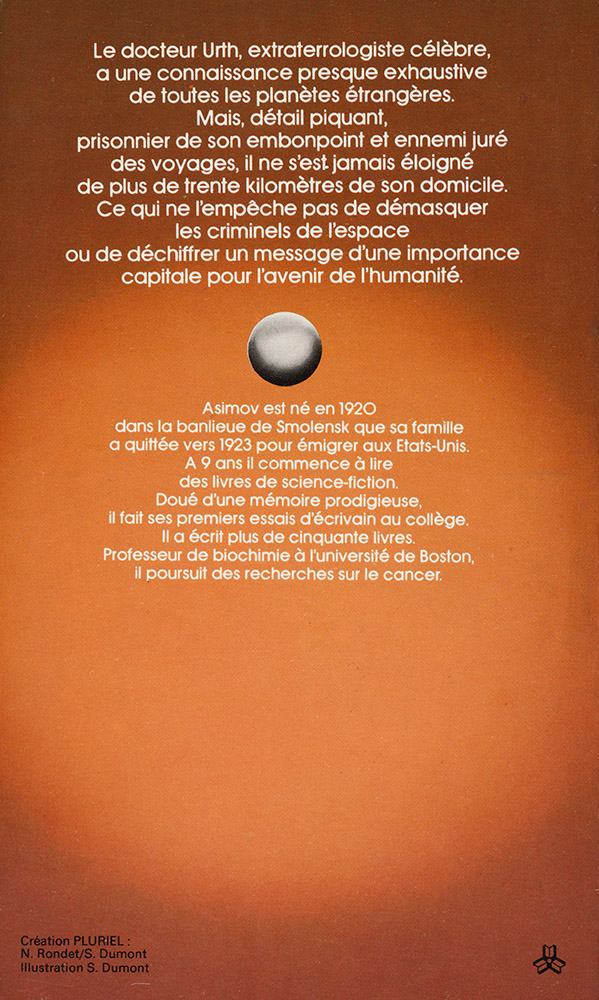|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Histoires mystérieuses - 2
Isaac ASIMOV Titre original : Asimov's Mysteries, 1968 Première parution : États-Unis, New York : Doubleday, 1968 (recueil coupé en deux pour l'édition française) ISFDB Cycle : Histoires mystérieuses  vol. 2 vol. 2Traduction de Michel DEUTSCH Illustration de Stéphane DUMONT DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 114 n° 114  Dépôt légal : 2ème trimestre 1976, Achevé d'imprimer : 4 juin 1976 Réédition Recueil de nouvelles, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 10,7 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : Création Pluriel : N. Rondet/S. Dumont.
Quatrième de couverture
Le docteur Urth, extraterrologiste célèbre,
a une connaissance presque exhaustive
de toutes les planètes étrangères.
Mais, détail piquant,
prisonnier de son embonpoint et ennemi juré
des voyages, il ne s'est jamais éloigné
de plus de trente kilomètres de son domicile.
Ce qui ne l'empêche pas de démasquer
les criminels de l'espace
ou de déchiffrer un message d'une importance
capitale pour l'avenir de l'humanité.
Asimov est né en 1920
dans la banlieue de Smolensk que sa famille
a quittée vers 1923 pour émigrer aux États-Unis.
À 9 ans il commence à lire
des livres de science-fiction.
Doué d'une mémoire prodigieuse,
il fait ses premiers essais d'écrivain au collège.
Il a écrit plus de cinquante livres.
Professeur de biochimie à l'université de Boston,
il poursuit des recherches sur le cancer.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Ante-scriptum ("Mortelle est la nuit") (Foreword (The Dying Night), 1968), pages 9 à 10, préface, trad. Michel DEUTSCH 2 - Mortelle est la nuit (The Dying night, 1968), pages 11 à 60, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 3 - Post-scriptum ("Mortelle est la nuit") (Afterword (The Dying Night), 1968), pages 61 à 61, postface, trad. Michel DEUTSCH 4 - Ante-scriptum ("La Poussière qui tue ") (Foreword (The Dust of Death), 1968), pages 64 à 64, préface, trad. Michel DEUTSCH 5 - La Poussière qui tue (The Dust of Death, 1957), pages 65 à 86, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 6 - Ante-scriptum ("Le Carnet noir") (Foreword (Obituary), 1968), pages 88 à 88, préface, trad. Michel DEUTSCH 7 - Le Carnet Noir (Obituary, 1959), pages 89 à 120, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 8 - La Bonne étoile (Star Light, 1965), pages 123 à 130, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 9 - Post-scriptum ("La Bonne étoile") (Afterword (Star Light), 1968), pages 130 à 130, postface, trad. Michel DEUTSCH 10 - Ante-scriptum ("La Clef") (Foreword (The Key), 1968), pages 132 à 132, préface, trad. Michel DEUTSCH 11 - La Clef (The Key, 1966), pages 133 à 189, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 12 - Ante-scriptum ("La Boule de billard") (Foreword (The Billiard Ball), 1968), pages 192 à 192, préface, trad. Michel DEUTSCH 13 - La Boule de billard (The Billiard Ball, 1967), pages 193 à 228, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 14 - Post-scriptum ("La Boule de billard") (Afterword (The Billiard Ball), 1968), pages 229 à 229, postface, trad. Michel DEUTSCH Critiques des autres éditions ou de la série
Paru peu après le premier (critiqué dans notre numéro de mai), voici le second tome de Histoires mystérieuses, qui rassemble les six nouvelles non encore traduites de Asimov’s mysteries. Cette célérité, ainsi que la fidélité au texte initial (toutes les nouvelles du recueil américain ont été traduites), doivent être saluées. Nous en félicitons les éditions Denoël, mais ces compliments ne s’appliquent pas au recueil lui-même, qui est d’une qualité très inférieure au tome 1. Il semble bien que l’union du policier et de la science-fiction ait une fâcheuse tendance à produire des mutants récessifs, sauf exception notable comme Les cavernes d’acier. Un des principaux intérêts de la science-fiction est la création d’univers imaginaires ou, tout au moins, l’étude de l’homme à travers des situations inhabituelles. Dans la science-fiction policière, rien de cela : nous sommes plutôt en présence d’une machinerie de précision où tout est agencé en vue de résoudre l’énigme, mais ce mécanisme parfait recèle habituellement autant d’âme qu’une montre suisse, ainsi par exemple Les joyaux de la couronne martienne de Poul Anderson dans Fiction n° 99. Alors, la plupart de ces nouvelles ne soulèvent qu’un intérêt poli ; ce sont de petites choses, des amuse-gueules. On lit ces récits sans désagrément, mais bientôt on préfère se rabattre sur quelque chose de plus consistant. Ceux que le mélange policier-science-fiction attire pourront trouver dans Worlds of Tomorrow de janvier et mars 1966 deux intéressantes études de Sam Moskowitz, le biographiste attitré du C.L.A., sur ce sujet : The sleuth in SF et The super-sleuth of SF. Une des réussites complètes dans ce domaine est une nouvelle de Daniel F. Galouye, Le pantomorphe, parue dans Fiction n° 41, et qui contient d’ailleurs plus de science-fiction que de policier, raison peut-être pour laquelle elle est si bonne. Le pantomorphe est un organisme capable de prendre n’importe quelle forme et de faire n’importe quelle action sous l’influence d’un esprit humain ; il peut devenir ainsi l’arme d’un crime parfait, puisque par personne interposée, sans que l’on puisse savoir qui commande ce docile serviteur. Mais le tempérament d’Isaac Asimov est assez éloigné de celui de Daniel Galouye, nous allons le voir tout au long de ces six nouvelles. Il est déjà triste de constater que trois de celles-ci ont antérieurement été traduites en français, il est encore plus triste de voir que deux de ces dernières sont les meilleures du livre ; il s’agit de Mortelle est la nuit, parue dans Fiction n° 43 sous le titre La nuit mortelle, et Le carnet noir, traduite dans Fiction n° 74 avec pour titre Rubrique nécrologique. La troisième est La poussière qui tue (Poussière de mort, Fiction n° 64). Que reste-t-il ? Pas grand-chose sur le plan de la qualité ; c’est-à-dire deux petits néants nommés La clef et La bonne étoile et une novelette assez réussie : La boule de billard. Cette fois-ci, nous avons droit à deux enquêtes de Wendel Urth, l’extraterrestiologue allergique aux voyages et qui ne verra donc les autres planètes que si l’on invente le transmetteur de matière. C’est autour de ce transmetteur de matière que tourne Mortelle est la nuit ; le savant responsable de cette invention est assassiné avant d’avoir pu la divulguer. Alors le but de Wendel Urth sera non seulement de découvrir l’assassin, mais encore de retrouver le principe du transmetteur de matière. Pour une fois, Isaac Asimov a donné vie à ses personnages, un corps à ses intellects, et c’est pourquoi Mortelle est la nuit est une novelette tout à fait excellente. On ne peut en dire autant de La clef. En octobre 1966, le Magazine of Fantasy and SF publia un numéro spécial Isaac Asimov ; la couverture s’ornait d’un portrait de l’auteur par Emsh ; à l’intérieur, outre une bibliographie, on pouvait lire deux articles sur Asimov qui ont été traduits dans Fiction n° 159, un poème de l’écrivain, The prime of lite, et une novelette, La clef. Cette clef était une histoire écrite spécialement pour le numéro et cela se sentait. Si l’on pouvait accepter une novelette à moitié bâclée dans un magazine, en considérant qu’Asimov avait perdu la main en s’occupant trop de vulgarisation scientifique, il n’en est plus de même ici. La clef est une salade de calembours, pouvoirs psi, policier et extrapolations simili-sociologiques pour former un mélange peu appétissant. Deux sélénologues trouvent une « arme psychique » extra-terrestre, mais l’un d’eux est un membre d’une confrérie qui « prépare la destruction des quatre cinquièmes de l’humanité » ; heureusement le gentil prospecteur parviendra à s’échapper et enfouir l’objet étranger, en laissant pour trace un rébus que seul Wendel Urth pourra déchiffrer ! Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur ! De la science-fiction pour ceux qui ont régressé au stade oral. La poussière qui tue et La bonne étoile ne sont certainement pas des exemples de science-fiction enfantine, mais là s’arrête leur dissemblance avec La clef. La première est une petite histoire somnifère où la science est héroïne et la seconde recèle une chute tellement invraisemblable qu’elle en perd tout intérêt. Ce sont visiblement des récits qu’lsaac Asimov a écrits pour se distraire et rien de plus, aussi éviterons-nous de trop en parler. Le carnet noir est cet amusant récit du premier homme à avoir pu lire son éloge funèbre dans le journal et du premier meurtre véritablement parfait. Tous les anciens lecteurs de Fiction le connaissent déjà ; Asimov y démontre qu’il est un excellent humoriste, qualité qu’il avait tendance à réserver à ses articles (voir Portrait de l’auteur entant dans Fiction n° 159). La boule de billard, enfin, est parue dans le numéro de mars 1967 de If. C’était un numéro très spécial ; If venait de recevoir son premier Hugo à la convention de Cleveland en 1966, aussi son rédacteur en chef Frederik Pohl pensa commémorer l’événement en publiant un numéro ne contenant que des nouvelles des auteurs primés cette année-là. Isaac Asimov, qui avait justement reçu un Hugo pour Fondation : « Le meilleur cycle de récits de SF de tous les temps », écrivit donc La boule de billard. Le conte est intéressant, en ce sens qu’il utilise de manière ingénieuse la théorie de la relativité généralisée d’Einstein, tout en l’intégrant dans une histoire policière acceptable. La théorie scientifique présentée étant assez excitante (que se passera-t-il si vous poussez une boule de billard dans un champ agravifique ?) et le conflit entre les deux principaux personnages bien rendu, on peut dire que La boule de billard est la meilleure nouvelle qu’Asimov ait écrite depuis longtemps, ce qui ne veut pas dire que c’est une œuvre exceptionnelle, mais bien plutôt que l’auteur du Livre des robots n’avait plus rien produit de bon ces dernières années. Que penser de ce second tome des Histoires mystérieuses ? Tout d’abord que c’est un des rares livres d’Isaac Asimov que nous nous empresserons d’oublier ; mais d’abord il faut essayer de comprendre le pourquoi de cet échec. Il semble qu’Asimov confonde trop souvent science et science-fiction. Dans la plupart des cas, la science-fiction n’est qu’à l’état de traces dans une gangue de science et de policier. Dans La poussière qui tue, par exemple, Asimov fait reposer toute son énigme sur les différences entre les réactions chimiques sur Titan et sur Terre (le récit se passe sur Terre, malheureusement). En même temps, dans ces nouvelles équations, les personnages ne vivent pas ; ce sont des idées destinées à disparaître dès le récit terminé, et si l’on ajoute que les « chutes » de ces nouvelles ne sont souvent pas convaincantes, on comprendra que le livre d’Asimov n’est pas spécialement mémorable. Enfin, notons que le meilleur du recueil se trouve non seulement dans les présentations de l’auteur, comme je l’ai dit dans une critique précédente, mais aussi dans l’humour qui imprègne quelques-uns des récits, bien que cette imprégnation ne soit pas très en profondeur. L’ouvrage ne s’en serait que mieux porté si le ton général avait été plus léger. Marcel THAON |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |