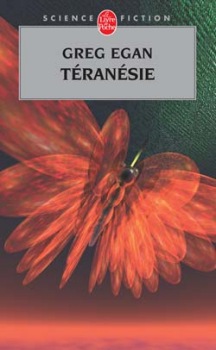|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Téranésie
Greg EGAN Titre original : Teranesia, 1999 Première parution : Angleterre, Londres : Gollancz, 19 août 1999 ISFDB Traduction de Pierre-Paul DURASTANTI Illustration de Jackie PATERNOSTER LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 7280 n° 7280  Dépôt légal : février 2006 Roman, 352 pages, catégorie / prix : 6.95 € ISBN : 2- 253-11481-2 ✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
Le jeune Prabir, neuf ans, enfant surdoué, vit avec ses parents, biologistes indiens, sur une île vierge et paradisiaque du Pacifique. Ces chercheurs étudient une espèce nouvelle de papillons, splendides et mystérieux, qui ne devrait pas exister selon les lois de l'évolution darwinienne. Mais lorsque la guerre s'abat sur l'île et que ses parents sont tués, Prabir doit fuir avec sa petite sœur, Madhusree. Depuis l'autre bout du monde, le destin le ramènera vingt ans plus tard sur cette île où des espèces entières semblent surgir du néant pour, peut-être, menacer l'humanité. Greg Egan, l'un des meilleurs écrivains actuels de science-fiction, raconte ici la vie tourmentée d'un homme qui devient le porteur d'une prodigieuse énigme scientifique.
Critiques
Le jeune Prabir n’a jamais connu que cette île des Moluques où il vit avec ses parents, des biologistes indiens, et sa petite sœur Madhusree. Surdoué mais atteint d’un léger souci génétique, Prabir n’a pas le droit d’interagir avec les papillons que ses parents étudient. Des papillons étranges, dont le génome ne respecte pas les lois de l’évolution. La nuit où Prabir désobéit et pénètre dans la serre aux papillons, l’île est bombardée : le conflit qui faisait rage au loin vient de rattraper brutalement ce coin de paradis. Leurs parents étant décédés dans le bombardement, les deux enfants sont envoyés chez de la famille au Canada. Vingt ans plus tard, l’un et l’autre n’auront de cesse de tenter de retourner sur cette île, à laquelle Prabir avait donné, pour s’amuser, le nom de Téranésie. C’est d’abord Madhusree, devenue biologiste, qui s’y rend ; désireux de veiller en toutes circonstances sur sa sœur, au risque de l’étouffer, Prabir fait tout pour la retrouver, et arpente la mer des Moluques en compagnie d’une scientifique. Mais la situation politique demeure compliquée en Indonésie. Surtout, des espèces mutantes apparaissent régulièrement, représentant peut-être un danger pour le reste du monde… Téranésie a pour faiblesse de suivre deux récits ambitieux. Délaissant la physique pure et dure, Egan a cependant le mérite d’aborder d’autres thématiques : la biologie est en position de force dans ce récit. La sexualité aussi : si Andrew Worth tombait amoureux d’un asexe dans L’Énigme de l’univers, Prabir est ouvertement homosexuel (pas le premier ni le dernier protagoniste à l’être dans l’œuvre d’Egan). Préfigurant Zendegi, la politique y fait aussi irruption, évoquant la situation compliquée des Moluques-du-Sud, les visées impérialistes de l’Indonésie et la réponse calamiteuse de l’Australie face à la question des réfugiés. Néanmoins, les tentatives d’humaniser et de rendre attachants les personnages tournent ici court : le parcours de Prabir n’émeut guère, pas plus que son sentiment de culpabilité. Autres motifs de déception : l’aspect accessoire de la thématique (téra-) biologique, et l’intrigue qui louvoie durant la moitié du roman, sans oublier une résolution en queue de poisson. Téranésie s’avère cependant d’un accès plus simple que les autres romans d’Egan, le lecteur n’étant jamais perdu sous le déluge de notions scientifiques — celles-ci se faisant plus rares ici. Mais de la part d’Egan, qui a habitué à l’excellence, on en attend juste davantage côté spéculation et vertige. Un récit mineur dans l’œuvre du maître. Erwann PERCHOC En 2012, Prabir Suresh est âgé de neuf ans, doté d'une intelligence précoce et débordant d'imagination. Il est le fils de deux savants indiens venus sur une île vierge (que Prabir va bientôt baptiser « Téranésie ») située au milieu de la mer de Banda, vers le sud-est de l'archipel indonésien. Son père et sa mère étudient sur place une espèce de papillons qui présentent des anomalies étranges. Au lieu d'être le fruit d'une mutation aléatoire, leurs caractéristiques semblent être le résultat d'un très long processus d'évolution isolée du reste de la Terre. Mais avant d'arriver à percer ce mystère, la guerre éclate dans la région et les parents de Prabir disparaissent. Le jeune garçon doit traverser la mer dans un petit bateau, avec sa petite sœur, Madhusree, pour seule compagnie. Après un passage dans un camp de réfugiés en Australie, les deux enfants finiront à Toronto au Canada, où ils seront élevés par un parent lointain. Vingt ans plus tard, Madhusree devient biologiste à son tour. Contre l'avis de son frère aîné, toujours traumatisé par ses souvenirs, elle se joint à une expédition scientifique qui va justement revenir dans les parages de Téranésie. D'autres anomalies viennent d'être repérées, mais celles-ci se répandent désormais à d'autres espèces, et sur d'autres îles. Prabir, saisi d'un instinct protecteur plus fort que lui, prend la décision de la suivre jusqu'à l'autre bout du monde. Curieusement, l'auteur australien Greg Egan, pourtant réputé pour privilégier les idées aux dépens de ses personnages, donne une place ample dans ce roman à l'élément humain. Le récit, en première partie, des événements arrivés à Prabir pendant son enfance et lors de sa fuite de l'île, est émouvant, voire déchirant. Et il révèle aussi un sens de l'humour assez mordant en décrivant les réactions de Prabir et de sa sœur au charabia des milieux académiques, mélange du mysticisme « New Age » et d'une « critical theory » vidée de tout sens. Mais même quand l'énigme scientifique reprend le dessus dans la deuxième moitié du livre — et les fans d'Isolation ou de La cité des permutants ne risquent pas d'être déçus, car elle est bizarre à souhait — , sa résolution dépendra étroitement des passions qui animent les personnages, Prabir en tête. Une démonstration fort impressionnante du rôle de l'observateur dans un univers qui, sans lui, ne serait qu'un ramassis de mécanismes aveugles et indifférents. Tom CLEGG (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série
Après trois romans et un quinzaine de nouvelles, Greg Egan s'est imposé comme l'auteur le plus important des années 90. Et avec des textes tels que « Cocons » (in CyberDreams 04), « Océanique » (in Bifrost 20), « Les Tapis de Wang » (Galaxies n°6) ou Vif Argent (Bifrost 11), sont talent de nouvelliste n'est plus à prouver. En revanche, les romans sont davantage controversés. Leur sont reprochés froideur, complexité et manque de force narrative, et ce en dépit de spéculations scientifiques et éthiques de très haut vol. Leur public semble devoir rester partagé. Avec Téranésie, on revient sur l'idée centrale de L'Échelle de Darwin de Greg Bear — paru l'été passé dans la même collection. D'étranges événements génétiques adviennent soudain, sans être ni fortuits ni aléatoires. Où Bear nous propose une modification de l'Homme, Egan met en scène des évolutions spontanées au sein de la faune de certaines îles du Sud. La première moitié du roman n'a que peu à voir avec la S-F. La vie d'un garçon de neuf ans sur une île déserte ; la guerre ethnique en Indonésie ; la rencontre forcée du jeune garçon en question avec la cousine de sa mère, intellectuelle extrémiste new age et politiquement correcte ; quelques années plus tard, son homosexualité ; et en toile de fond la présence de sa petite sœur, Madhusree... Rien d'ardu là dedans, ni de très passionnant. Ça se laisse plutôt bien lire, mais on en vient vite à ronger son frein. Ce n'est pas parce que le lecteur du XXIe siècle ne se satisfait plus de la S-F en fer blanc de grand papa, de ses personnages stéréotypés, qu'il faut se payer du travers inverse. La moitié du roman rien que pour camper le personnage, c'est un peu lourd, surtout qu'avec la réputation de l'auteur, on est en droit d'attendre un minimum de spéculation. On nous l'a promis, mais ça ne vient guère... Madhusree, devenue étudiante en biologie, à la suite de ses parents, décide de retourner dans l'archipel de son enfance où les plus étranges espèces continuent d'émerger. Prabir, en parfait pot de colle, l'y suit. Ou plutôt retourne en Téranésie affronter les fantômes de son passé. Après avoir noté l'importance prise par la biologie dans la S-F contemporaine, où s'inscrit Téranésie, il faudra admettre que ce roman n'a rien de génial. Greg Egan n'a ici ni le souffle d'un véritable romancier, ni la force dont il fait preuve en tant que nouvelliste. Si son écriture froide et distanciée est tout à fait propice à la mise en relief de problématiques socio-affectives engendrées par les progrès de la technologie, elle ne convient guère aux ambitions mainstream qui président à Téranésie. Le roman tourne autour du lien à la sœur, aux parents, à la guerre, à la culpabilité. Mais l'aspect biologique n'y relève que de l'épiphénomène. Finissant en queue de poisson, mais plus accessible et facile à lire que l'on pouvait s'y attendre, on se demande si, finalement, on n'a pas placé la barre de nos attentes trop haut pour que Téranésie ne déçoive pas quelque peu. Jean-Pierre LION
Dans les années 2010, un couple de scientifiques membres de l’IRA – Association des Rationalistes Indiens! – étudient de curieux papillons sur une île déserte que leur fils Prabir baptise Téranésie, l’île des monstres. La guerre qui déchire alors l’Indonésie fait de Prabir un orphelin de neuf ans, seul responsable de sa petite sœur…
Vingt ans plus tard, bien d’autres « monstres » ont envahi la région, à commencer par des cacatoès aux becs pourvus de dents. On y découvre des mutations inattendues, des mimétismes originaux, des symbioses insolites, et même des adaptations aberrantes de plantes ou d’animaux qui acquièrent des protections inutiles en l’absence des prédateurs correspondants…
D’où provient cette épidémie de monstres? Un mutagène chimique? Un virus? Le recouvrement de gènes archaïques? L’irruption de créatures en provenance d’un univers parallèle? La résolution de cette énigme scientifique est évidemment au cœur de l’intrigue et on peut faire confiance à Egan pour sortir des sentiers battus… Sans dévoiler la nature même de cet incroyable phénomène, on peut noter que l’auteur l’utilise pour s’interroger sur le sens de l’évolution : «Ce qui lui importe, c’est la reproduction. Ce qui nous importe, à nous, l’amour, l’honnêteté, l’intelligence, la raison, résulte d’accidents» (p.289).
L’habileté avec laquelle Egan jongle avec des théories scientifiques extrêmes nous est familière et Téranésie, bien que plus simple que ses précédents romans, ne fait pas exception. Ce qui surprendra davantage, c’est l’importance accordée aux personnages, moins habituelle chez l’auteur. Émouvant, le parcours de Prabir est tout entier construit autour de son dévouement à sa sœur, à la mesure de la culpabilité ressentie. Le garçon, pourtant particulièrement précoce et calculateur, en gâche sa vie et devient un terne employé de banque, craintif et suicidaire : «Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas ne fait que me bousiller un peu plus» (p.122).
Prabir est homosexuel. Loin d’être un détail, cette sexualité permet encore à Egan de discuter du déterminisme évolutif : pourquoi notre patrimoine génétique tolère-t-il une apparente impasse reproductive, la conséquence la plus immédiate de l’homosexualité étant l’infertilité? Posée en ces termes, la question pourrait choquer par ses divers sous-entendus, mais si Egan apporte plusieurs réponses possibles – l’homosexualité est-elle analogue au «bras mort» d’une rivière, ou un «butin volé» à l’évolution, ou encore profitable à l’espèce en conférant aux homosexuels d’autres tâches que la reproduction? (p.101-102) –, c’est pour mieux ironiser sur la recherche absolue d’une causalité.
L’autre surprise du roman est la satire féroce des universitaires à laquelle se livre l’auteur, vilipendant les «discours transgressifs» et les «discussions toutes en bons gros néologismes et en fulminations recopiées sur le dictionnaire des synonymes» (p.138). Egan s’amuse même à imaginer une théorie du complot où la CIA aurait conçu ce jargon comme une arme, inventant «une façon incroyablement compliquée de parler de la politique, qui ne voulait rien dire, mais qui s’est répandu dans les universités du monde entier parce qu’elle en jetait» (p.116).
Pour appuyer ce propos, Egan brosse de la tante de Prabir un portrait particulièrement sévère, dénonçant à travers elle les intellectuels qui réinterprètent le monde avec une grille unique de pensée – ici un féminisme outrancier qui s’oppose à « une démarche intellectuelle séparée de l’intérêt personnel, l’idée même de la recherche sincère de la vérité » (p.83). Egan n’hésite pas à pousser la caricature jusqu’à l’absurde : cette femme milite pour que l’on inverse le fonctionnement machiste des ordinateurs en faisant de chaque 1 mâle un 0 femelle et inversement (p.82) !
Si Téranésie n’a pas la densité de L’Énigme de l’univers ni ne provoque un frisson métaphysique comme Isolation, ce roman montre qu’Egan est bel et bien un grand romancier, capable de changer de registre, d’animer des personnages forts et de manier une ironie grinçante, sans prendre trop au sérieux l’idée scientifique pourtant vertigineuse qui sous-tend le récit. Le fantastique processus évolutif décrit sera soudainement et dérisoirement enrayé par un simple leurre, comme quoi l’évolution tient à peu de choses. Exit le déterminisme, la morale est clairement précisée par la dernière phrase du roman : «La vie n’a aucun sens» (p. 296). À l’inverse des romans d’Egan!
Pascal PATOZ (lui écrire) |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |